ACTIONS SPECIFIQUES de l’OFFICE DES SPORTS de BREST en 98 & 99
Au-delà des fonctions dévolues à un Office des Sports (gestion des clubs, infos, promotion par le biais du Journal « Contact Sport »), l’Office des Sports de Brest élargit son champ de compétence par des initiatives spécifiques en cohérence avec la politique socio-sportive menée par la Ville.
Partenaire ou initiateur, l’Office est présent dans différentes opérations.
C’est ainsi qu’il a été ou est :
Partenaire de l’opération « Critères d’utilité sociale » 98 & 99.
Initiateur de l’enquête - questionnaire à l’intention des clubs brestois.
Intervenant sur le modèle sportif brestois lors de l’Assemblée Générale de la F.N.O.M.S. à Rennes en juin 99.
Partenaire et coordonateur, avec la F.S.G.T., des activités sportives mises en place pendant toutes les vacances pour le public jeunes des quartiers,
Gestionnaire du « Fonds d’aide au démarrage de projets sportifs » sur les territoires ‘contrat de ville’,
Organisateur et coordonateur des différents tournois de football (cité foot, stage Amoros)
Co-organisateur du tournoi des grandes Villes de l’Ouest 98 & 99
Co-organisateur d’Atout sport 98 & 99.
Initiateur de la manifestation Eurobjectif Sport qui a rassemblé 250 jeunes sportifs issus des clubs, des structures de quartiers, des villes de Kiel, Cadix et Bejaïa.
Promotion du sport haut niveau par mise à disposition d’invitations en direction des jeunes aux matchs
Sensibilisé par le rôle social que peut jouer le sport, l’Office des Sports de Brest continuera à être partenaire ou initiateur d’actions envers les publics « sensibles » en cohérence avec la politique locale.
Objectif de la manifestation
Célébrer les 70 bougies du plus ancien office des Sports français dans une ambiance conviviale, sportive et décontractée.
« Officiellement créé en 1930, l’Office des Sports de la Ville de Brest souffle ses 70 bougies cette année.
Cette longévité en ferait un des plus anciens, voire même le plus ancien de France. Aucune gloire bien sûr, notre objectif étant de proposer une politique sportive humaniste au service des citoyens responsables.
Notre rôle de rassembleur, de coordonateur, d’interlocuteur privilégié de la Ville est reconnu par l’ensemble des structures affiliées à l’Office, qu’elles soient fédérales affinitaires, dans des Centres Sociaux, ou des maisons Pour Tous. Il nous paraît essentiel de promouvoir l’accès pour tous en dépit des inégalités économiques et sociales. En accord avec la Ville de Brest, nous avons élaboré des Critères d’Utilité Sociale, afin d’aider les associations qui accueillent des publics en difficultés.
Toute cette philosophie va se retrouver dans les manifestations que nous organisons le samedi 13 mai après-midi et le dimanche 14 mai matin.
Pas de spectacle grandiose, pas de vedette médiatique, mais un programme alliant activités sportives, exposition sur le sport en Bretagne, démonstration de danses, concert, informations sur le Sida, la violence, la drogue ...
Un point commun, l’accès gratuit à tous et une participation maximale pour voir, essayer, pratiquer. »
Claude PIERRON
Présidentcette occasion, l’Office des Sports ouvre le « grand livre d’Histoire du Sport » à Brest.
A travers sa propre histoire, de Noël KERDRAON, à Claude PIERRON, Président actuel, du plateau de Kéroriou à l’avenue Foch, en passant par les sportifs qui ont marqué cette période, l’Office des Sports de Brest du 09 au 14 mai 2000, rendra hommage à tous les sportifs et militants qui ont fait et font encore de la ville de Brest un haut lieu de la vie sportive.
Films, exposition, manifestations sportives et culturelles témoigneront de l’évolution des pratiques d’un sport ‘balloté’ par les vents et marées au gré de contextes politiques et sociaux, entraînant dans son sillage un Office municipal d’Education Physique et des Sports qui viendra s’ancrer avenue Foch pour être actuellement l’Office des Sports de la Ville de Brest.
Représentant de la vie sportive locale, l’Office des Sports a forgé son identité tout au long de son histoire et renforcé son rôle de partenaire, d’organisme de concertation au sein de la collectivité.
Les manifestations débuteront par un temps fort le samedi 13 à 9 heures au salon Richelieu à l’Hôtel de Ville : l’Assemblée Générale des Clubs à A.G. particulière à connotation « 70è ».
Anniversaire de l’Office des Sports, mais aussi des clubs du mouvement sportif associatif, dans son ensemble qui de tous temps, développent les valeurs humaines et citoyennes qui fondent notre société.
A bientôt, à tous. » Jo ROBERT Secrétaire Générale.
La célébration des 70 ans de l’office a pour but d’attirer :
- l’ensemble des adhérents des clubs sportifs brestois, régionaux, nationaux et voir internationaux
- les associations sportives membres de l’office des sports
- le grand public
- les personnes désireuses de découvrir un sport représenté lors de ce week-end sportif
Présentation générale
Soirée « ciné cabaret »
Une soirée « ciné cabaret » sera organisée, par la cinémathèque de Bretagne au Vauban, le mardi 9 mai 2000 à 17 heures et à 20 heures. L’objectif de cette projection est de se remémorer l’histoire sportive de la Cité du Ponant. Cette rétrospective du sport à Brest retracera l’histoire de 5 disciplines sportives, que sont le football, le cyclisme, l’haltérophilie, la natation, l’athlétisme depuis 1930.
Exposition d’archives
Semaine du lundi 08 mai au dimanche 14 mai
:Exposition permanente de 9H à 18 Heures.
Une exposition d’archives sportives réalisée par Jean René POULMARC’H, Claude ANDRE et la commission « Archives » de l’Office des Sports (coupures de journaux, revues de presse, photographies, affiches...) sera présentée au grand public dans le hall de la Mairie de Brest, à compter du 9 mai 2000.
Cette exposition retracera l’histoire de l’Office des Sports de la Ville de Brest, de 1930 à nos jours, ainsi que le passé des 5 disciplines sportives citées ci dessus.
A noter la participation de l’association A.P.B. (Artistes Peintres Brestois) qui agrémentera l’exposition de ses oeuvres.
Assemblée générale de l’Office des Sports
L’Assemblée Générale de l’Office des Sports de la Ville de Brest, se tiendra le samedi matin au salon Richelieu à la Mairie de Brest. A l’occasion de cette assemblée générale annuelle, qui réunira les membres de l’Office, aura lieu, par vote, le renouvellement du tiers sortant du comité directeur...
Cette assemblée sera suivi d’un pot qui sera servi à la Mairie de Brest.
Après-midi «activités» à la Place de la liberté de Brest
Cette après-midi multi-activités marquera, officiellement le début de la célébration des 70 printemps de l’Office de Sport de Brest.
Activités sportives et festives - Place de la Liberté de 14H à 18H :
å Démonstrations / initiations sportives :
. Roller
. Escalade
. GRS (G.R.S. du Ponant)
. Budokan (Budokan Brest)
. Gouren (Skol Gouren Brest)
. Planche à voile (bassin 10 x 8 m, Crocodiles de l’Elorn)
. Capoeïra (avec le champion du monde de Hip-Hop)
. Educ Gym
. Voitures radio commandées (Auto model club de l’Ouest)
. Parachutisme (Para Club du Nord Finistère)
. Escrime (La Rapière de Brest)
. Base Ball
å Festivités :. concert hip - hop (champion du monde)
. concert Mister X (prévention Santé)
. Amuse Gueules (maquillage)
SPORT ET SANTE
L’Office des Sports de la Ville de Brest a 70 ans en l’an 2000. Dans la volonté de développer son cadre SPORT & SANTE, l’Office des Sports a décidé, depuis 2 ans, de se lancer dans des opérations prévention avec le service Santé de la Ville. Diverses plaquettes d’information ont à ce jour été distribuées, un débat sur le dopage en 1998... et pour notre anniversaire, il nous semble important de ne pas oublier l’aspect Santé et préventif du Sport.
SCALP, séropositif depuis 15 ans vient de sauter à l'élastique pour savoir si la peur du vide est plus forte que la maladie. Il atterrit sur scène et s'apprête à faire la fête avec ses amis, mais c'est sans compter avec SIDEMAN qui fait irruption dans la salle pour régler ses comptes. Qui l'emportera ? Le virus et ses sbires : guerriers de l'impossible ou SCALP aidé par ses musiciens et le public qui ont déjà préparés leurs armes ?
Soirée rencontre sportive à la salle Marcel Cerdan de Brest
Cette soirée se tiendra le samedi soir de 19 heures à 22 heures 30, des matchs de football, handball et de basket-ball y seront organisés.
Une restauration sur place sera assurée : sandwichs et boissons.
18H45 : Ouverture de la fête en musique
19H00 : Basket (2 x 20’) Rive droite / Rive gauche
19H50 : Démonstration danse 10’
20H15 : Volley Ball (Etoile St Laurent)
21H15 : Musique
21H30 : Hockey / Salle (démonstration)
22H00 : Foot (match mixte ð les équipes seront constituées d’élus associatifs, d’élus municipaux, de divers partenaires, joueurs de différentes disciplines, acteurs du tissu social...)
22H45 : Musique (fin de la soirée)
L’animation musicale est organisée avec la station de radio NRJ et animée par le groupe musical Fanfare Zébaliz.
Randonnée pédestre en ville
Une Randonnée découverte de la Ville de Brest sera organisée le dimanche matin, de 9h à 11h30 . Cette randonnée aura pour objectif de se promener dans les rues et ruelles brestoises peu fréquentées (rue de Saint Malo...) afin de découvrir ou redécouvrir l’histoire du vieux Brest.
A ce jour, le parcours de la promenade n’est pas établi avec certitude.
Le départ aura lieu du cours d’ajot à Brest.
DIMANCHE MIDI :
Réception de clôture à l’hôtel de Ville
Date Du Mardi 9 au dimanche 14 Mai 2000
Ampleur
Difficile à chiffrer
Sports représentés
Basket ball, football, Volley ball, planche à voile, escalade,roller, GRS, Budokan, Base Ball, Gouren, Capoeïra, Educ Gym,Voitures radio commandées, Parachutisme, Escrime
Contacts
- Les permanents de l’Office des Sports
- Les membres du comité directeur de l’Office
Organisation en étroite collaboration avec :
- Les services techniques de la Ville de Brest
- Divers professionnels et responsables d’associations sportives qui nous apporteront leur savoir-faire tout au long de l’organisation de cette manifestation.
Moyens
Divers moyens sont et seront mis à notre disposition pour l’organisation des 70 ans de l’Office des Sports.
Moyens physiques
Les permanents de l’Office des Sports : Denise Huellou et Ronan Vigouroux.
Une équipe bénévole constituée des membres du Comité directeur de l’Office des Sports et des différents clubs sportifs brestois.
Différents services de la Ville de Brest. (Sport, Culture, CTM, Communication)
Moyens matériels
Les locaux de l’Office des Sports équipés de téléphones, télécopieur, matériel informatique (ordinateurs, imprimantes...), photocopieuse, relieuse, salles de réunion.
La mise à disposition de matériel par la Ville de Brest dans le domaine sportif et dans le domaine culturel.
Moyens publicitaires
Lancement d’une campagne publicitaire quelques semaines avant l’anniversaire
- Partenariat/ Sponsoring
- accord des partenaires suivants : La Ville de Brest
- Campagne d’affichage au niveau local
- des affiches de différents formats :
30 Affiches pour panneaux Decaux (120 x 176)
500 Affiches format A3
- affichage municipal
- affichage chez les différents partenaires (commerçants...)
- affichage dans les associations sportives, établissements scolaires...)
- Télévision
- TF1 Brest
- Partenariat avec FRANCE 3 Iroise
- Radio
Une station de radio a été contactée pour diffuser des messages publicitaires les semaines précédant la manifestation : NRJ BREST
- Presse
- Journaux locaux : Le Télégramme, Ouest-France
- Journaux gratuits locaux tels que Hebdo Pub ou Inter Service pour des encarts publicitaires (voir partenariat)
- Articles dans des revues tels que les magazines de quartier, Sillage...
- Tracts / Plaquettes
- Distribution de 10000 plaquettes de promotion auprès des clubs sportifs locaux, les licenciés des clubs, le grand public ...
- Invitations- Lancement d’invitations vers les élus (Ministre des Sports, Maire de Brest...), les représentants de notre fédération : la F.N.O.M.S., les partenaires, les sponsors, des personnalités régionales et locales.
Le partenariat
« Les 70 ans de l’Office des Sports de la Ville de Brest »
Le partenariat que nous recherchons serait d’ordre financier, afin que nous puissions financer en partie les dépenses d’une organisation telle que la célébration des 70 printemps de l’Office des Sports.
L’Office des Sports de Brest a 70 ans !!!!
Etre partenaire des 70 ans de l’Office, c’est une image jeune et dynamique pour votre entreprise.
Un moyen de présentation au grand public des différents produits de votre société.
Un partenariat, c’est une image, une publicité :
les différents lieux de manifestations (Place de la Liberté, Salle Cerdan...)
la campagne de publicité (affichages)
les médias (télévision, presse...)
 DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS DU FINISTÈRE
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS DU FINISTÈRE
Actes Colloque de Brest
Femmes et Sport
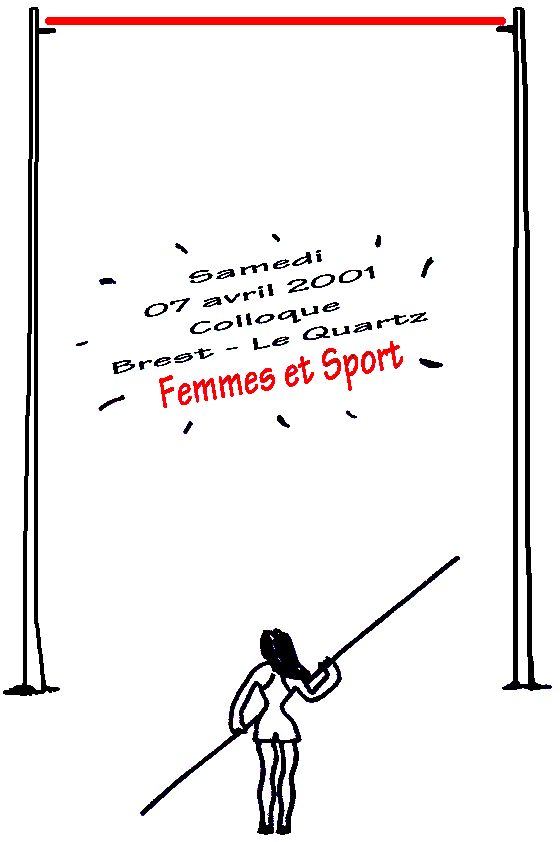
Aux partenaires,
’L idée d’organiser un colloque « Femmes et Sport » impulsée par la D.D.J.S. 29 et la D.R.J.S. Bretagne en partenariat avec la Ville de Brest, l’Office des Sports de Brest, le Conseil Général, le C.D.O.S. fait suite au programme mis en œuvre par Mme BUFFET, Ministre de la Jeunesse et des Sports et contribuant à l’action globale pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
Tout en poursuivant les objectifs définis dans ce programme :
å favoriser l’accès des femmes à toutes les pratiques sportives,
å démocratiser les instances et les modes de fonctionnement de l’encadrement sportif,
å aider à la reconnaissance médiatique des sportives et des pratiques sportives féminines.
Le colloque doit permettre de donner la parole au mouvement sportif breton et plus particulièrement finistérien et, surtout d’élaborer des projets d’actions futures en faveur du sport féminin régional.
Notre partenariat doit permettre, en mettant en commun nos compétences respectives, de donner au sport féminin toute la reconnaissance qu’il mérite.
Que cette journée soit une réussite totale !
la DDJS

C’est avec grand plaisir que je salue les participantes et les participants à ce colloque « femmes et sports » organisé à l’initiative de la Direction départementale Jeunesse et Sports du Finistère.
Comme vous le savez, le sport féminin est une priorité de mon Ministère.On compte en France quatre fois plus de licenciées qu’en 1975. Les femmes sont désormais présentes dans toutes les disciplines.
Les choses bougent aussi quant à leur représentation dans les instances de direction et l’encadrement sportif. De ce point de vue, il reste cependant beaucoup à faire. J’y travaille, en concertation avec le mouvement sportif. Mais pour amplifier les avancées, les initiatives comme celle à laquelle vous êtes aujourd’hui conviés sont particulièrement utiles.
La présence des femmes dans le mouvement sportif, à tous les niveaux, est une question de justice et de démocratie. C’est aussi une chance pour le sport, un atout pour son développement.
Je vous souhaite plein succès dans vos travaux.
Marie-George Buffet
Ministre de la Jeunesse et des Sports
Colloque « Femmes et Sport »
Présentation Gurvan
Le colloque organisé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et placé sous le haut patronage de Madame M.G. BUFFET, ministre de la Jeunesse et des Sports.
Merci aux élus qui nous font l’honneur de leur présence, merci à tous les dirigeants et dirigeantes de clubs, de CD, de ligues, de comités régionaux et merci bien sûr à toutes les sportives qui au fil de cette journée je l’espère vont nous faire partager leur expérience, leur ???? sportif.
Merci à tous aussi d’avoir répondu aussi nombreux à l’antenne brestoise de la Jeunesse et des Sports. Améliorer la place des femmes dans le monde du sport est une cause commune pour tous les acteurs du sport français, du monde sportif pour les dirigeants pour les entraîneurs pour nous les journalistes.
Ce colloque finistérien est la suite logique des Assises Nationales 1er acte d’importance du programme Femmes et Sport.
La parole au Maire – Monsieur François CUILLANDRE.
Mesdames, Messieurs, c’est avec un grand plaisir que j’ai répondu favorablement à votre invitation à ouvrir ce colloque sur le thème Femmes et sport. Je suis heureux d’apporter le soutien de la Ville de BREST à cette initiative dont l’intérêt ne vous pas échappé et j’en félicite les organisateurs notamment la Ministre de la Jeunesse et des Sports à travers sa direction départementale et l’Office des Sports de la Ville de BREST.
La parité qui a été voulue par le gouvernement et voté par le parlement trouve aujourd’hui à l’issue des élections municipales une traduction concrète dans nos communes. Je suis persuadé que cette réforme loin de se limiter à la seule sphère politique aura des répercussions pas mécaniques mais bien réelles dans les secteurs multiples de notre société et notamment dans les activités sportives, le sport n’était pas en dehors de la société et bien à son image. Le sport et le mouvement sportif transmettent des valeurs auxquelles nous sommes très attachés, effort, esprit d’équipe, respect de soi et des autres.
L’article 3 de la charte du sport adoptée en 1994 l’écrit.
Le sport est non seulement un moyen privilégié d’accomplissement personnel mais un levier des solidarités et des responsabilités – son utilité est indéniable. Il remplit des fonctions éducatives, culturelles, sanitaires, sociales, récréatives. C’est pourquoi la Ville de BREST est attentive à soutenir l’activité sportive par la mise à disposition d’équipements que nous voulons de qualité, le soutien aux associations et aux manifestations sportives – mais ce soutien ne serait se résumer à une relation marchande avec le mouvement sportif, déconnecté des valeurs que celui-ci peut véhiculer.L’existence de débat tel que celui qui vous réunit aujourd’hui est un encouragement quant à la qualité de la dynamique sportive qui existe à BREST.
L’ouverture de l’ensemble des pratiques sportives aux femmes, la place accordée aux sports féminins sont des questions importantes pour lesquelles les évolutions prendront sans doute du temps.Un rapport récent de la DATAR écrit ceci :
« Différentes raisons expliquent la persistance de l’exclusion de la pratique sportive de populations historiquement ne pratiquaient pas il s’agit en 1er lieu des femmes. En effet le monde du sport reproduit assez bien pour l’accès des femmes aux pratiques sportives les inégalités socioculturelles et socioéconomiques. Si les différentes pratiques hommes femmes tendent à se combler on est encore loin de l’égalité.
Les femmes ne peuvent pas encore accéder à tous les sports. Certains représentent encore de forts bastions masculins et si la population des pratiquantes rattrape progressivement celle des pratiquants la place des femmes dans les institutions sportives reste marginale surtout au plan national. A l’échelon des clubs, ligues et comités la situation semble sensiblement meilleure »
C’est ce que dit le rapport de la DATAR.
Ces constats ne sont pas nouveaux. On remonte loin dans le temps à la Grèce Antique, les femmes ont longtemps été exclues de l’enceinte sportive ou se déroulait les jeux olympiques ou seuls étaient admises les jeunes filles, cependant les femmes finirent par avoir leurs propres jeux et purent alors fouler la piste d’Olympie en septembre de l’année olympique.
Plus récemment aucune compétition féminine n’eut lieu aux 1er jeux modernes en 1896 et leur 1ère participation 1900 jeux de PARIS 1,8% des athlètes sont des femmes, en 1996 un siècle plus tard ATLANTA elles sont +34%.
Il s’agit d’un mouvement de fond même s’il peut apparaître très lent et régulièrement des signes encourageants viennent témoigner de la réalité de ses évolutions.
L’intérêt pour les équipes féminines sportives de Haut Niveau Hand Brestois par exemple (le BHB) ou pour des performances de sportives (voile) qui ont montré que les femmes pourraient faire jeu égal avec des hommes dans un sport réputé difficile. Intervenant récemment dans un colloque sur le même thème sur les relations femmes/sports M.G. BUFFET Ministre de la Jeunesse et des Sports a défini 3 axes majeurs d’action.
1er axe : Favoriser l’accès des femmes à toutes les pratiques
2ème axe : Travailler à la démocratisation des instances
3ème axe : Aider à la reconnaissance des sportives et des pratiques sportives féminins.
Ce sont aussi des questions que se posent aussi à BREST. Nos clubs représentent environ 33 000 licenciés/30% de femmes. Nous avons environ 250 clubs dont une douzaine présidée par une femme.
Le temps n’est plus où l’activité sportive était réservée aux jeunes hommes, les adultes, généralement hommes se consacrant à l’encadrement. Toutes les générations doivent pouvoir pratiquer.
Il reste que le développement de la pratique féminine en particulier au début de la vie active demande des adaptations en terme d’offre d’activités diversifiées, de créneaux horaires adaptés notamment pour les jeunes mères, ou d’installations spécifiques.
Je suis persuadé que la prise de responsabilité dans les clubs permettra de faire bouger les choses plus rapidement.
Voilà Mesdames et Messieurs quelques éléments de réflexion pour lancer vos débats que je souhaite riches et approfondis. Bons travaux à tous et bonne journée.
Gurvan
Arrivée de Gérard CABON Adjoint au sport de la nouvelle municipalité brestoise.
Claude PIERRON – Président de l’Office des Sports BREST
C’est avec enthousiasme que l’Office des Sports a répondu favorablement à la DDJS pour organiser conjointement le colloque d’aujourd’hui. C’est vrai qu’avec le Directeur et ses collaborateurs nous avons toujours des contacts constants et positifs et particulièrement avec Madame ROBERT conseillère technique et pédagogique de la Jeunesse et des Sports et également secrétaire générale de l’Office des Sports, cela permet de gommer les quelques écueils que l’on pourrait avoir.
Concernant les thèmes présentés aujourd’hui quelques remarques. La discrimination des femmes dans le sport s’est trouvée confirmée avec la rénovation des jeux du Baron de Coubertin ou les femmes étaient interdites ! On parlait à l’époque de rénovation et c’est vrai qu’un siècle de mentalité à combler, c’est long, surtout dans un domaine, le sport, ou si on nous dit qu’aujourd’hui c’est un modèle d’intégration, de tolérance, de démocratie, il ne faut pas oublier que pendant les millénaires précédents ce fut exactement l’inverse.
Concernant l’accès aux pratiques, c’est vrai que partant de rien, il est toujours facile de dire que cela s’est amélioré.
Je crois que je fais une petite différence, entre les activités « non mixtes » (les femmes/les hommes) et les activités communes. Il n’y en a pas beaucoup d’ailleurs.
Dans les disciplines dites séparées, il n’y a pas trop de concurrence : par exemple entre le hand masculin et le hand féminin, le basket féminin et le basket masculin. La seule différence est que les protagonistes se bousculent un petit peu moins sans doute du côté des femmes que du côté des hommes. Il faut signaler quand même pour les disciplines dites masculines, la création d’équipe féminine comme le rugby, le base-ball dont la déclinaison au féminin est le soft Ball me semble-t-il.
Il y a des disciplines exclusivement féminin. Ex : la GRS ou les garçons sont absents.
Dans les activités communes – le risque de voir les femmes dominer « les mâles » - c’est plus délicat.
Ex : le PARIS-DAKAR – Juta KLEINSCHMIDT a fait la pige à Jo SCHLESSER qui ne s’en est pas remis. C’est un bon exemple.
Dans le Vendée Globe « un sport pas
fait pour les minettes » (on ne citera pas le nom de l’homme brillant
qui a fait cette déclaration) – les femmes ont fait la pige aux hommes.
On accepte plus de se faire battre à
« Question pour un Champion » (ça pourrait être une championne) qu’au
volant d’un 4/4 ou à la barre d’un monocoque.
Les accès aux responsabilités.
Plus on monte dans la hiérarchie associative, plus le cas de femmes aux commandes est rarissime. Elles restent en général au niveau des sections. On trouve énormément de femmes secrétaires, c’est tout à fait normal direz-vous, des trésoriers également. A ce niveau on valorise l’activité et il faut du monde pour fonctionner.
Par contre plus on monte plus c’est valorisant pour l’individu et là ce n’est pas la peine d’avoir trop de monde, on n’a plus besoin des femmes. Localement sur les 250 associations, une quinzaine sont présidente.
A l’Office des Sports, structure modèle de démocratie et d’avant-gardisme – 5 femmes pour 32 hommes, on a aussi du travail à faire...
Aussi je vais suivre avec attention vos travaux pour essayer de découvrir quelques pistes pour améliorer la pratique des femmes et favoriser leur promotion.
Je vous remercie et bonne journée à tous.
Yvon CLEGUER – CDOS
L’amélioration de la place des femmes dans le monde du sport est une cause commune à laquelle le CDOS avec tous les autres partenaires œuvre dans l’intérêt du sport en général. Le mouvement sportif dans son ensemble est très attaché à l’engagement des femmes dans les pratiques et les responsabilités.
Toutefois bien du chemin a été parcouru dans ce sens, beaucoup de disciplines olympiques et autres sont ouvertes aux femmes des efforts ont été effectués quant à leur présence dans les différentes instances dirigeantes, j’en veux pour preuve l’article de hier sur Madame PILVEN qui je pense doit être un exemple mais on peut constater que beaucoup encore reste à faire.
Dans le Finistère 33% des pratiquants sont des femmes et des jeunes filles.
Sur les 66 CD du Finistère 11 ont une présidente et le taux de participation féminine dans les conseils d’administration n’est que de 22%.
Bien sûr plusieurs disciplines sont plus féminisées que d’autres et attirent plus les femmes.
Je crois qu’il nous appartient à tous aujourd’hui de faire évoluer les mentalités et toutes les habitudes. Nous devons aussi essayer de trouver des solutions à tout ce qui fait obstacle matériellement à la pratique et à la prise de responsabilités. Ce colloque, où on donne la parole à tout le monde et surtout aux femmes doit permettre tout d’abord un constat sur les expériences vécues puis d’en débattre et surtout d’établir des moyens d’action qu’il nous appartiendra du moins je l’espère de mettre tout en œuvre.
Ce colloque doit être le moyen d’attirer l’attention du public mais aussi des pouvoirs publics et des instances dirigeantes à tous les niveaux – département, région, national, international. Vous pouvez compter sur le mouvement sportif pour accompagner et favoriser la reconnaissance et la prise en compte de la pratique féminine dans le sport.
Le mouvement sportif sera très attentif à vos travaux de cette journée pour appliquer ensuite ce qui en suivra.
Madame Annick LE LOCH – Vice Présidente du Conseil Général du Finistère
Monsieur le Député Maire, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames Messieurs, je suis très heureuse d’être parmi vous ce matin, mais je l’étais à titre de conseillère générale membre de la commission enseignement, culture, sport du Conseil Général et représentante du CG au CDOS tout simplement et pas au titre de représentation très officielle du CG donc je n’avais pas du tout prévu d’intervenir ce matin devant vous.
En quelques mots, je suis venue à BREST sous la pluie, il faut un peu de courage pour venir à BREST ce matin. Je voudrai dire que c’est tout naturellement que le CG s’est associé à ce colloque « Femmes et Sport ».
Le Conseil Général n’a pas de compétences obligatoires en matière de sport mais depuis des années consacre un budget très important en direction de ses collèges finistériens 15-60 millions de francs. – consacre 17-18 millions de francs par an à la pratique sportive ; les clubs, les clubs de haut-niveau, les sportifs de Haut-Niveau et les animations sportives du département.
C’est tout naturellement que l’année dernière le C.G. a organisé les trophées du sport féminin avec la DDJS, cérémonie très conviviale et très intéressante. C’est aussi tout naturellement qu’il organise depuis des années les trophées Pen ar Bed, depuis des années avec tout le mouvement sportif finistérien. Au regard de son importance dans ce département 240 000 licenciés en Finistère sportif dans ce département, un vrai phénomène de société dans ce département.
La lettre du sport national donne le département du Finistère classé au 9ème rang des départements de France dans la pratique sportive.
30% des femmes qui pratiquent un sport en Finistère on ne….240 000 sportifs membres d’un club, d’une association
2 150 clubs et 66 CD sportifs dans ce département, c’est dire toute la place que consacre les collectivités que ce soit le CG, les communes sans lesquelles rien ne serait possible. A développer le sport finistérien qui a rôle social, fondamental, essentiel dans notre société et nous demandons qu’avec vous tous à le développer encore davantage, à développer la pratique féminine. Moi j’ai pour ma part jamais eu de problème. J’ai été lycéenne et dans un lycée bigouden avec un prof de gym favorable à la pratique féminine et il incitait toutes les jeunes filles à pratiquer un sport de manière très active et personnellement je lui dois beaucoup car j’ai fait un peu de compétition quand j’étais dans ce lycée et c’était un monsieur très bien, très offensif sur la pratique du sport féminin et à l’époque dans les années 60, les femmes qui pratiquaient notamment des disciplines comme les haies n’étaient pas très nombreuses en tout cas je voudrais rendre à travers ce colloque un grand coup de chapeau à tous les professeurs d’EPS qui oeuvrent dans ce sens et je vous souhaite aussi de très bons travaux aujourd’hui.
Merci
Mr le Député-Maire,Mmes et Mrs les Conseillers Régionaux et Conseillers Généraux,Mmes et Mrs les Maires et élus,
Mr le Président du CDOS,Mr le Président de l’office des sports de Brest,Mr le délégué femmes et sports de la DRJS de Bretagne,
Mmes et Mrs les Présidentes et Présidents et responsables d’associations ,Mmes, Melles , Mrs,
Le sujet qui nous rassemble aujourd’hui à Brest est bien un sujet d’actualité puisqu’il en est question dans tous les domaines de la vie sociale, et le sport n’y échappe pas.
En organisant cette journée d’échanges nous avons voulu à notre tour et à notre manière , et après d’autres initiatives nationales ou locales, marquer dans le département du Finistère notre préoccupation, pour valoriser la place des femmes dans le sport régional et départemental. Certes les femmes sont déjà bien présentes dans les organisations et dans la vie sportive et cet engagement ne fait que croître, et tant mieux. Mais néanmoins nous avons jugé utile de relayer le message de Mme Buffet Ministre de la JS, et donner à ce message un écho particulier en Finistère et en Bretagne , en réunissant les actrices et les acteurs du sport ,des élus ,des opérateurs institutionnels, et tout simplement les sportives et sportifs intéressés par cette question.».
Votre présence , nombreuse, est pour moi et toute l’équipe qui a préparé cette journée le signe prometteur qu’il est possible d’imaginer localement , dans le département , dans la région , des dispositions de nature à permettre aux femmes d’occuper une place plus conforme à leurs aspirations , à leurs compétences à leurs mérites , dans la gestion , l’organisation , l’animation du sport.
A Aragon qui avait écrit « la femme est l’avenir de l’homme »,le mouvement de libération de la femme avait répondu par un paradoxe assez méchant « l’homme est le passé de la femme ». Pardonnez moi cet emprunt, mais je crois avec beaucoup d’hommes présents ici—nous ne sommes pas tous frappés de gynéphobie —et , avec les participantes présentes aujourd’hui, qu’il est possible parfaitement de concevoir une meilleure organisation des activités sportives et de faire en sorte qu’à l’avenir, hommes et femmes, conçoivent de façon plus équilibrée l’articulation de leur coopération dans le domaine du sport.
Nous avons choisi de tenir cette rencontre le 7 avril. Or les superstitieux, comme les Kabbalistes accordent au chiffre 7 des vertus particulières, parcequ’il symboliserait la perfection. Je vous l’avoue, ce choix n’a rien de délibéré…quoique ?…En tout cas j’espère que notre rencontre d’aujourd’hui sera l’occasion d’illustrer cet aphorisme d’un auteur célèbre qui écrivit dans son « Livre de la déraison souriante » « L’homme et la femme sont deux êtres inégaux dont aucun n’est supérieur à l’autre » en dressant pour le sujet qui nous concerne les pistes ambitieuses d’une action concertée .
Merci Mr le maire pour votre accueil et l’appui de la ville sans lequel nous n’aurions pas pu mener notre projet dans les mêmes conditions
Merci à tous les partenaires qui s’y sont associés aussi spontanément qu’activement.Merci à toutes les personnes qui ont accepté de prendre une part à la préparation ou à l’animation de la journée. Jean-François Riou.
Philippe LACOMBE, Maître de Conférence en sociologie, UBO.
Il n’est jamais tout à fait neutre de donner la parole à un homme ou à une femme pour rendre compte des relations qui unissent les femmes et le sport. Je me réjouis de constater ici une présence masculine importante car bien souvent, -ce n’est pas une critique- ces temps de paroles se résument à des espaces de militantisme féminin. Je ne me positionne pas sur ce créneau là et il me semble que seuls des regards croisés permettent l’émergence d’une réflexion féconde.
« Peu d’hommes intéressés » disent-elles. Je penserais plutôt que peu d’hommes se voient autorisés à intervenir, à participer ou à réfléchir à ces questions d’inégalités sociales et sexuelles, évoquant comme principal argument qu’ « hommes et femmes ne peuvent pas se comprendre ». Plus qu’une oppositons sexuée, les décalages et contradictions proviennent de la confrontation de positions militantes et de celles de chercheurs comme P. Bourdieu dont l’un des récents ouvrages s’intitulait la « domination masculine ». J’en ai retenu une phrase qui vous interpellera certainement ; « les femmes ne sont pas à même de penser leur propre domination ». Professeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, sociologue, Pierre Bourdieu estime certainement nécessaire d’intervenir, de proposer une conception des formes que revêt la domination masculine, y compris dans les espaces que le sens commun pourrait croire « réservés » aux femmes et à la militance féminine. Dans son ouvrage fort intéressant et assez polémique, il ose ainsi affirmer que le militantisme féminin participe à la construction de la domination masculine.
En terme de posture, j’aborderai tout d’abord le sport. De manière schématique, il existe deux ensembles de discours qui le définissent. Il est perçu par certains comme quelque peu dé-contextualisé de la vie sociale ; le sport, dans son fonctionnement, évoluerait indépendamment des normes, des valeurs, des représentations et de la dynamique des rapports sociaux de sexes qui régissent le système social plus global. Il serait alors porteur de vertus intrinsèques. Les discours ordinaires, médiatiques, politiques, et même sportifs, vantent fréquemment les mérites et vertus intégratives du sport, qui représenterait un espace « à part » et privilégié.
A l’inverse, d’autres le définissent comme un miroir de la société, disent de lui qu’il est porteur de dérives variées que nous pourrions illustrer par de nombreux exemples. Le sport, comme tout autre univers social, se ferait l’écho des excès de la société en terme de dysfonctionnement, d’inégalités (sexuées et sociales), allant parfois jusqu’à les exacerber.
Alors mieux ou moins bien, plus ou moins intégrateur ou excluant, la question ne se situe pas forcément à ce niveau. Si nous adoptons le point de vue d’un sport hermétique à toute influence extérieure, nous éludons la question -essentielle pour une juste compréhension du fonctionnement du monde sportif- de la dynamique culturelle de construction, de transformation et/ou de reproduction sociales inter-dépendantes et réciproques entre le sport comme microcosme, et le social qui traverse constamment tout univers symbolique qui le compose. Je ne conforterai pas cette représentation du sport comme simple vecteur d’intégration, de parité, d’égalité... Nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire. Dans la Charte du sport de Brest, excellent outil de réflexion, l’article premier postule que le sport constitue un fait social total. Qu’est ce qu’un fait social total ? C’est rapidement un ensemble d’activités qui agissent et fonctionnent dans tous les champs de la vie sociale.
De ce point de vue le sport apparaît tout autant comme un puissant instrument de répression et de résistance à l’introduction des femmes dans des secteurs traditionnellement masculins (notamment lorsqu’il s’agit d’accéder à des responsabilités de toutes natures), qu’un mode particulier et complémentaire de promotion et d’émancipation féminines. A l’image de tout fait social total le sport peut donc porter en lui toutes les contradictions d’une société.
Il se pose également la question du décalage ; le sport anticipe -t- il les évolutions sociales et culturelles ou au contraire, se présente -t- il comme un espace hautement conservateur ? Il s’agit bien là de la dialectique entre les modes de vie, leurs évolutions et les appareillages juridiques, les textes de lois sportives ou plus généralement sociales. D’autres sociologues et historiens l’ont montré, je pense que ce sont avant tout les modes de vie qui infèrent sur les lois, qu’elles soient sportives ou sociales. Ce sont les transformations qui affectent les modes de vie qui s’expriment dans les législations sportive, sociale, juridique... Ainsi la question des femmes et du sport dépasse largement la seule relation des femmes au sport. Traiter de ce rapport des femmes au monde sportif revient à appréhender synchroniquement leur place dans la société, la relation qu’elles entretiennent avec la politique, le travail, et toute dimension de la vie sociale qui les amène à gérer, à participer à l’évolution des rapports entre les sexes et plus largement des modèles de genres. Cette question des femmes dans le sport ne constitue en rien un outil de culture surnuméraire, c’est au contraire une question très sérieuse. Alors que doit-on faire lorsque l’on est sociologue ?
Si les travaux des historiens nous intéressent car l’histoire des mentalités témoigne de ces évolutions et résistances culturelles, ils nous exposent très clairement d’où l’on vient et où nous en sommes. Les sociologues eux s’intéressent exclusivement et théoriquement au point de vue contemporain de la réalité sociale. Il s’agit pour nous de proposer des modèles explicatifs des fais sociaux qui caractérisent la société d’aujourd’hui. La sociologie ne se résume pas simplement à des analyses statistiques, et dans notre communication nous ne vous en proposerons que très peu. Il s’agit bien de comprendre quels peuvent être les facteurs de résistance et/ou de promotion de la pratique du sport par les femmes, et la manière dont ils se traduisent objectivement et symboliquement. Ma marge de manoeuvre en tant qu’homme reste extrêmement faible, car n’étant qu’un homme, pour traiter de la place des femmes dans le sport, « on » risque de me reprocher mon absence de militantisme pour la cause féministe...
Nous choisissons d’appréhender la question du rapport des femmes au sport par le biais d’une problématique spécifique car il nous est de toute manière impossible de prétendre traiter la totalité d’un fait social si complexe. De notre point de vue, le sport est avant tout une mise en jeu des corps. Il constitue un espace assez particulier permettant de lire la nature des rapports sociaux de sexes. Au moyen d’une lecture sociologique des relations entre hommes et femmes, des indicateurs culturels tels que les vêtements, les tenues, les styles, les techniques sportives féminines, nous pouvons analyser les normes qui imposent les bonnes manières d’être un homme ou une femme, dans le sport. Qu’est ce qui est autorisé et qu’interdit-on, insidieusement et/ou officiellement ? De façon encore plus simple qu’est ce qu’un bonhomme et qu’est ce qu’une bonne femme ? En le disant vous pré-sentez déjà que le masculin et le féminin ne se valent pas toujours.
Dans son dernier ouvrage, Florence Montreynaud nous propose de nombreux exemples sur le décalage des représentations liées à un même qualificatif selon qu’il s’applique à un homme ou à une femme ; « un homme à femmes est un séducteur, une femme à hommes est une pute. Un homme facile est un homme facile à vivre, une femme facile est une pute... ». Le bonhomme et la bonne femme renvoient à des connotations plus péjoratives pour l’un que pour l’autre... Revenons en à notre propos.
Nous ne traiterons pas ici des perspectives quantitatives quant aux mises en jeu des corps. Il me paraît difficile de lire une émancipation féminine à travers des indicateurs statistiques parce que les chiffres voilent souvent les dimensions implicites voire invisibles de ce même objet d’analyse, et nous tâcherons de mettre cet état de fait en évidence. Pierre Bourdieu nous dit également que la statistique est la science de l’erreur et que tout un chacun peut faire dire ce qu’il veut entendre à des chiffres, il suffit de savoir les manipuler.
Nous essaierons par contre de déconstruire le postulat selon lequel les pratiques sportives sont iso-sexuées. Nous pensons bien plus qu’une même pratique sportive ne renvoie pas à une même réalité, à de mêmes enjeux et mises en jeu corporelles et identitaires pour une femme et pour une homme. Nous n’avons jamais à faire à des autorisations, des interdits similaires ; le terme « autorisation » est à mettre en guillemets puisqu’il n’existe pas d’instance de censure officielle. Nous tenterons de discuter l’idée reçue qui veut qu’hommes et femmes peuvent pratiquer tous les sports puisque le monde sportif semble apparemment ouvert à tous et à toutes, qu’ « elles n’ont qu’à ».
Dans un premier temps il me semble nécessaire de vous proposer un bref rappel historique. Sans vous infliger un retour historique sur les lois sociales, rappelons que nous revenons de très loin. Il y a 20 ou 30 ans la question des femmes dans le sport n’aurait pas présenté une même pertinence parce que les évolutions législatives montraient qu’il n’existait pas la maturité nécessaire pour aborder cette question de parité, qu’il s’agisse du sport ou de tout autre secteur de la vie publique. Il faut attendre 1907 pour qu’une femme puisse disposer de son salaire sans le consentement de son mari, 1938 pour qu’elle ne soit plus tenue au devoir conjugal, 1944 pour qu’elle obtienne le droit de vote et soit éligible, et 1966 pour que la femme puisse enfin exercer une activité professionnelle sans le consentement de son époux. Voilà donc seulement un demi-siècle que les femmes sont reconnues comme des citoyennes à part entière. En 1789 l’article un de la déclaration des droits de l’Homme postulait que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et pourtant il nous aura fallu des siècles pour mettre véritablement en oeuvre cette égalité citoyenne. Dans le sport, vous vous en doutez, les résistances tout comme les changements sont synchrones. Dans le journal l’Auto (inventeur du tour de France en 1903) nous pouvons lire les propos d’Henri Desgranges ; « il n’est point d’être plus odieux que ce qu’on peut appeler la femme sportive ». Le Baron Pierre De Coubertin n’était pas en reste, à ses yeux une olympiade femelle est impensable parce qu’elle serait « incorrecte », « inesthétique », « impraticable »... Ne voyez pas en ces hommes des misogynes ou de hauts conservateurs, ils se font juste l’écho des moeurs de l’époque, et ces propos sont tout à fait révélateurs de l’air de ce temps. Il n’est pas concevable d’analyser des faits sans les re-contextualiser dans leur époque historique, sociale et culturelle. Nous ne pouvons pas juger des modes de vie, des représentations et des normes du début du siècle avec notre expérience d’une réalité sociale aujourd’hui toute autre.
Ce qui se jouait à l’aide de coopérations assez ordinaires entre médecins, des politiques, religieux, était le cantonnement de la femme à la sphère domestique ; « l’homme a pour fonction de produire et la femme de reproduire », je cite ici le Docteur Boiget dans son manuel d’éducation physique. La médecine a largement participé à la définition des modèles masculin et féminin orthodoxes. Le docteur Boiget nous dit encore ceci ; « la femme n’est point construite pour créer mais pour procréer » ou encore Marc Belin Du Coteau qui était promoteur d’une méthode sportive bien connue des étudiants qui préparent le CAPES ou l’agrégation d’EPS ; « la femme demeure anatomiquement inférieure à l’homme » et nous sommes quand même en 1927 !
Il ne s’effectue pas de réel changement avant la seconde guerre mondiale même si la sportivisation est en route et que la démocratisation du sport y compris pour les femmes se prépare entre les deux guerres. Nous assistons à la prolifération des « femmes phénomènes ». Ce sont des femmes qui vont promouvoir des aventures, des tenues, des droits (celui de vote, de fumer par exemple) et ces aventurières existent aussi dans le sport. Elles multiplient les exploits sportifs et jouent au football, courent, sautent, lancent dans les stades, au risque dit-on en 1920, de perdre leur âme. C’est alors dangereux pour une femme de faire du sport. Cette représentation du risque liée à la pratique sportive féminine perdure encore aujourd’hui sous d’autres formes. En Finistère, la promotion sportive des femmes s’est principalement heurté à des résistances cléricales. A l’inverse, les patronages laïques et catholiques vont représenter de puissants éléments de promotion du sport féminin, et ce surtout après la seconde guerre mondiale. Dans l’entre deux guerres le clergé refusera les sacrements à toute dame vêtue en cycliste. Le vélo est assez révélateur de ces promotions et résistances synchrones puisqu’il était interdit aux femmes de pratiquer cette activité. Nous retrouvons ainsi des prêches en presqu’île de Crozon qui définissent la pratique cycliste comme dangereuse pour les femmes, « lubrique, masturbatoire, nymphomaniaque ».
Ces interdits participent plus fondamentalement au contrôle social et collectif des femmes, dans les sociétés traditionnelles par les instances de régulation et plus précisément par les hommes. Nous pouvons donc définir le vélo -qualifié par les uns « d’instrument du diable »- comme un outil d’émancipation à la fois moyen de transport et d’accès à autrui, qui rompt avec ce contrôle social local.
D’un point de vue historique le sport peut prétendre assurer en même temps la promotion et la reproduction, et au regard de cette histoire des mentalités nous comprenons bien pourquoi les évolutions d’après guerre restent très lentes. Entre les années 60 et 90, les fédérations olympiques restent un haut lieu de la défense des prérogatives masculines. La présence des femmes dans ces fédérations olympiques ne passe que de 18% à 26% en 35 ans même si elles sont de plus en plus visibles et conquièrent toujours davantage de médailles. A la lecture de ces chiffres nous percevons assez clairement l’ambiguïté entre certaines résistances culturelles malgré des avancées objectives. Evidemment cette dialectique ne concerne pas tous les sports de la même manière, et il nous reste à nous interroger sur ce que sont les pratiques sportives, et comment filles et garçons, hommes et femmes construisent leurs inclinations pour ces activités sportives. Comment fabrique -t- on les « goûts », les affections pour tel ou tel sport ?
Madame la Conseillère Générale l’a dit tout à l’heure, les enseignants d’EPS participent largement à la promotion de l’éducation physique et sportive des garçons et des filles, et des fédérations affinitaires qu’elles soient scolaires comme l’USEP, l’UNSS, la FNSU ou des fédérations comme l’UFOLEP, la FSGT et d’autres ont toujours eu pour tradition de promouvoir le sport féminin. Cependant, cette genèse des goûts se révèle très particulière puisque tout se passe comme si au collège garçons et filles, dans une mixité largement partagée, participaient à l’Education Physique et Sportive, et qu’à partir du moment où les filles deviennent adultes il y avait une inflexion naturelle très forte vers l’abandon ou le désintérêt du sport. Aujourd’hui ce problème fait partie des préoccupations des fédérations sportives et scolaires qui s’interrogent sur les raisons de cette désaffection du sport par les filles dans les catégories cadettes, juniors et seniors.
Comment expliquer ce taux très important d’abandons ? Que se passe -t- il à cette étape de la vie des filles ? Nous ne pouvons qu’interroger et mettre en relation des inflexions similaires dans d’autres domaines. Comment se fait-il par exemple, que les filles soient progressivement réfractaires aux sciences et aux mathématiques et qu’elles développent davantage d’inclinations pour la littérature ? Au sortir du collège, la genèse des goûts féminins prend son essor. Alors comment fabrique -t- on les petites filles et les petits garçons ? Voilà la véritable question de fond qui se pose pour tout secteur de la vie sociale au sein desquels les enfants se socialisent ; le sport, l’école, les activités culturelles...
Evidemment je ne réduits pas les sciences à une inclination masculine, mais comment le système scolaire, les parents, hommes et femmes, participent-ils à la socialisation des goûts masculins et féminins ? Il s’agit bien d’une modélisation des comportements sexués et c’est ce dont nous souhaitons vous parler. Lorsqu’une institution autorise ou interdit des pratiques sportives, des modes de fonctionnement, elle définit les formes orthodoxes d’être au féminin et au masculin. Selon nous, la reproduction des modèles de genres constitue l’un des plus puissants facteurs de résistance à l’entrée des femmes dans le sport. Cette reproduction des modèles de genre est le fait des hommes et des femmes, le fait de la plupart d’entre nous. Jusqu’au collège tout se passe bien puis on s’aperçoit que l’institution et la société toute entière fabriquent des hommes et des femmes au destin contrasté. Et il ne suffit pas de dire qu’autrefois les hommes étaient des « machos », des « conservateurs », des « protectionnistes » et qu’aujourd’hui la domination masculine n’existe plus. Elle a simplement revêtu des formes ajustées aux transformations sociétales ; elle s’exprime de manière plus subtile donc plus difficile à déconstruire, parce que la loi, les valeurs clé de liberté, de parité, de respect d’autrui et de réalisation autonome de soi ne permettent plus l’exercice d’une domination explicite et identifiable.
Caroline MOULIN (Doctorante en sociologie, UBO).
Effectivement aujourd’hui la domination masculine ne peut plus se traduire aussi lisiblement et de manière aussi légitime qu’auparavant car elle est devenue officiellement et socialement condamnable. Depuis les années 70, les femmes ont revendiqué et partiellement obtenu des formes d’émancipation sociale, financière, professionnelle, sexuelle, mais cela ne revient pas à affirmer l’éradication de toute domination masculine. Oui, officiellement les femmes ont accès à la vie publique et politique mais rappelons aussi que leur présence reste encore minoritaire dans le sport et plus largement dans les sphères de responsabilité. Objectivement des inégalités sociales et sexuelles persistent, et nous allons le voir, le monde du sport n’échappe pas à cette réalité.
P. Lacombe a ébauché le problème de la domination masculine, et il me semble nécessaire d’insister sur le fait qu’elle ne se réduit sûrement pas à l’exercice d’une oppression consciente volontaire et permanente des hommes sur des femmes victimes et à qui n’incomberait aucune responsabilité quant à la pérennisation d’un tel rapport hiérarchique. La société ne se scinde pas en deux pôles dichotomés ; le côté des oppressés et celui des oppresseurs. Fondamentalement, nous participons tous à la persistance de ces inégalités entre hommes et femmes puisque nous adhérons le plus souvent à ces modèles de genres porteurs des limites d’une réelles émancipation féminine. Tout acteur social, homme ou femme, est socialisé à la différence dès son plus jeune âge, et la différenciation entre les sexes se situe au fondement de ce processus de socialisation. Le sentiment d’être fille ou garçon relève d’un long apprentissage qui est permanent, implicite et qui ne cesse qu’à la disparition de l‘individu.
La socialisation amène chaque acteur à intérioriser un ensemble de normes et de valeurs orientant les comportements, les attitudes, les pratiques, la construction sociale du corps -sous formes d’habitudes somatiques et de vécus émotionnels- de manière à ce que tout exprime son appartenance sociale et sexuée.
Les institutions, telles que la famille, l’école mais aussi le sport, participent de ce mécanisme de différenciation, accompagnent l’enfant dans la construction de son identité sexuée. Ces instances émettent des attentes et des réactions sexuellement orientées de manière à ce que l’individu intériorise ce qui relève ou non des manières d’être au masculin et au féminin.
Au regard d’une représentation admise et banalisée de la féminité, les petites filles sont socialisées à la retenue qui se traduit par des valeurs telles que la douceur, la fragilité, la sensibilité, l’émotivité, l’écoute de soi... Cette retenue s’exprime aussi et surtout à travers l’apprentissage d’un mise en jeu très codifiée du corps qui se présente alors comme un support expressif de ces « valeurs féminines ». La retenue s’affiche enfin à travers un rapport très euphémisé à la sexualité, mettant à distance toute dimension trop « violente » de la pratique tels que le désir biologique, la sexualité impulsive qui vont trop à l’encontre de cette image euphémisée et douce de la féminité. Les parents, l’école vont ainsi sanctionner davantage une hyperactivité féminine qu’une hypertonicité masculine. Ces institutions vont très vite favoriser chez le garçon, l’émergence d’un esprit compétitif, combatif au détriment d’une émotivité qui n’a qu’un droit d’existence et d’expression limité.
Ce processus de socialisation différentiel donne largement sens au phénomène d’inégalité d’accès aux pratiques sportives. Dans la mesure où chaque sport véhicule certains règles et principes particuliers, qu’ils induisent tous une mise en jeu et en forme des corps, ils ne répondent pas tous aux mêmes critères de féminité ou de masculinité. Cet usage nécessaire et réglementé du corps ne correspond pas forcément aux choix de possibles corporels dont filles ou garçons disposent pour se définir en tant que tels. L’accès des filles à certains sports tel que la boxe, le rugby peut leur poser problème en ce que cette mise en jeu du corps questionne leur féminité et le fonctionnement perçu comme ordinairement féminin du corps ainsi que de l’être dans son rapport compétitif à l’autre. Les parents orientent les filles et les garçons vers des sports qui permettent aux enfants d’appliquer les principes de masculinité (la virilité, la force musculaire, l’affrontement physique...) ou de féminité (la beauté, l’élégance...).
Nous sommes loin d’une entrée libre et indifférenciée des filles et garçons dans le sport tout simplement parce que cet univers culturel ne peut pas faire l’impasse et fonctionner en dehors d’une réalité sociale plus globale.
Bien évidemment, le fait que les femmes aient accédé à la sphère publique, à l’exercice de nouvelles responsabilités, leur permet une identification à des modèles plus hétérogènes. Cette évolution des mœurs n’a pu que transformer la nature des rapports sociaux de sexes et remettre en question le contenu des genres qui ne peut qu’être affecté par ces conquêtes féminines. Cette plus grande équité sociale et sexuelle amène certains sociologues à postuler de l’existence d’une « androgynie sociale », c’est à dire qu’hommes et femmes seraient amenés à se ré-approprier et à puiser dans les deux genres pour composer une identité sexuée beaucoup plus indifférenciée qu’auparavant, pour se construire en tant que femmes ou hommes. Nous assisterions alors à une féminisation des moeurs dans la mesure où les femmes participent maintenant à maintes activités sociales jusqu’alors investies par les hommes, et à une masculinisation de certaines pratiques féminines au nom d’une parité, d’un partage des tâches et des rôles.
La question que nous pouvons nous poser est de savoir si cette soit disant androgynie sociale permet l’expression d’un genre féminin libéré de toutes contraintes sociales trop coercitives d’être au féminin (puisque c’est aujourd’hui aux femmes que nous nous intéressons) ?Il faut rappeler que l’identité sexuée ne se définit jamais totalement par rapport à la seule pratique sexuelle puisqu’aujourd’hui la féminité et la masculinité se composent également dans le cadre de pratiques sexuelles minoritaires telle que l’homosexualité. Cette indifférenciation des genres s’il en est, peut-elle favoriser l’émergence d’un accès indifférencié des filles et des femmes à tous les sports ? Il semble que ce ne soit pas le cas car malgré la transformation des rapports sociaux de sexes et l’évolution des formes de la domination masculine, nous assistons synchroniquement à la pérennisation de résistances culturelles face à une réelle, totale et profonde recomposition des genres.
Il faut bien comprendre qu’au delà de l’aspect coercitif des attentes sociales stéréotypées, limitatives, les modèles de genre, les représentations construites de la féminité et de la masculinité représentent pour les acteurs des repères stables et intégrateurs, et nous avons tous besoin de normes nous permettant de nous situer et de trouver notre place au sein des groupes dans lesquels nous évoluons. Le sport est traversé par ces contradictions entre évolutions et reproductions dans la mesure où l’entrée des femmes dans le sport, la féminisation de certains attributs féminins tels que la musculature, ont contribué à ce bouleversement des catégories de repérage sexuées. Le sport comme espace d’intégration et de changement reste entravé par des stratégies plus ou moins conscientes et explicites de protection de ce que nous pourrions nommer la « masculinité en péril ». Ces résistances peuvent consister à sur-valoriser les exploits sportifs féminins, laissant entendre que la sportive est un être « d’exception », un être « rare » de manière à déconsidérer les pratiquantes ordinaires. En référence à une conception culturelle de la féminité invariablement rattachée à la beauté, d’autres nous diront qu’un excès de pratique physique s’avère dangereux pour les femmes dont le corps se déforme sous l’effet d’une musculature croissante, musculature qui se rattache plus facilement à la masculinité qu’à la féminité (valorisée et fantasmée).
Le sport est effectivement traversé par la société et ses attentes, et dans cet univers comme ailleurs les femmes sont soumises à des injonctions d’euphémisation et de beauté. La domination aujourd’hui comme hier s’est toujours exercée par un contrôle des femmes (et leur corps dans son fonctionnement et son modelage légitimes) par les hommes. Une sociologue comme Véronique Nahoum-Grappe vous dira que pour les femmes, la beauté reste la plus grande chance d’exister socialement.
Les messages publicitaires vantent continuellement les mérites des produits cosmétiques, des régimes alimentaires, de la chirurgie esthétique... Et à qui d’autres que les femmes s’adressent ces médias ? La culture s’est largement érotisée et la femme en est la principale actrice ou le principal objet, et le corps féminin n’a le droit d’exister qu’érotisé, qu’esthétisé, qu’hyper sexué.
De manière un peu schématique les femmes se retrouvent tiraillées entre deux grandes injonctions contradictoires ; on attend d’elles que la mise en jeu de leur corps réponde à cette attente d’accessibilité symbolique aux fantasmes masculins. Synchroniquement dans la mise en pratique des critères de féminité, tout doit exprimer l’euphémisation des expériences vécues car la frontière entre la femme sexuellement émancipée et la fille facile, la garce, reste ténue. Dans le monde du sport nous retrouvons cette attente de beauté.
Ces normes restrictives d’être au féminin ne laissent que peu de droit d’existence aux formes d’expression de sexualités minoritaires telle que l’homosexualité qui trouve très difficilement sa place dans l’univers sportif.
Prenons l’exemple d’Amélie Mauresmo, joueuse de tennis de haut niveau, elle est actuellement classée sixième mondiale. En 1999 la joueuse décide d’annoncer officiellement son homosexualité s’exposant aux condamnations les plus redoutables. Ces critiques ne visent pas directement sa pratique sexuelle parce que tout comme la domination masculine, la condamnation ouverte de l’homosexualité va à l’encontre des principes valorisés par notre société ; la liberté d’expression, le droit à l’épanouissement personnel... Les critiques qui atteignent Amélie Mauresmo visent son corps, ses postures et attitudes parce que le sport est un microcosme au sein duquel les acteurs s’expriment à travers l’usage de leur corps qui s’expose aux regards et devient le support privilégié d’une évaluation de soi pour soi et pour (par) autrui.
Rappelons que la joueuse mesure 1m75 pour 64 kg. Linsey Davenport (1m89 pour 79 kg) déclarait, pour justifier sa défaite contre Amélie Mauresmo, ceci ; « j’ai eu parfois l’impression de jouer contre un garçon, elle frappe dur et a de très fortes épaules ». La largeur des épaules de la joueuse a très souvent alimenté les polémiques laissant entendre qu’elle se dopait, ou insistant sur ses attributs masculins. Les guignols de l’info. nous présentent une marionnette très musclée à la voix grave, déclarant avec ironie que c’est la première fois qu’un homme se déclare lesbienne. Ainsi, même si le sport peut représenter un promoteur d’intégration, nous ne pouvons qu’ajouter à cela qu’il reste également un espace largement conservatoire d’identités prescrites. Plus fondamentalement, le sport se fait ici l’écho d’une société en mal de repères, en manque de mots et de valeurs nouvelles pour définir et accorder une place légitime à des formes diversifiées d’expression sexuelle et plus globalement sexuée. Tout ce qui ne relève pas de la féminité traditionnellement admise tombe immédiatement dans le registre de la masculinité, et tout ce qui ne relève pas de cette expression féminine normée est appréhendé et catégorisé dans une masculinité relativement marginalisée. Les résistances culturelles s’exercent alors peut être avec encore plus d’acuité dans le sport puisqu’elles se fondent sur le support privilégié de la domination masculine ; le corps (féminin).
La domination masculine se rattache toujours à une représentation de la sexualité, car le sens commun accorde volontier une fonction active à l’homme et un rôle passif à la femme. Le plaisir, la sexualité féminine n’existeraient pas indépendamment du pouvoir sexuel de l’homme, et dans le cas présenté les critiques portent aussi sur l’homosexualité comme forme particulière d’émancipation féminine vis à vis de cette soit disant dépendance à l’homme. Les critiques formulées quant à son style de jeu, son physique rappellent que la beauté relève d’un construit social. La beauté est définie comme objet de désir de l’autre sexe.
Quand cette féminisation des attributs traditionnellement masculins (la musculature par exemple) traduit une forme de revendication explicite d’une homosexualité, c’est à dire d’une volonté explicite d’orienter le beau corps féminin vers le même sexe, il n’est plus question que d’une beauté marginalisée voire d’un corps repoussoir.
Nous sommes donc loin d’un univers sportif dénué de toute attente d’être au féminin, et la démocratisation de l’accès des femmes au sport nécessite une réflexion plus profonde et systématique sur les contraintes sociales et culturelles qui limitent encore largement une libre expression des féminités. Philippe LACOMBE.
Vous voyez qu’il est difficile, non pas comme sociologue, mais comme homme d’intervenir parce que la question du brouillage identitaire et de la domination masculine n’est pas simple. Il est évidemment toujours plus compliqué d’évoquer l’homosexualité surtout dans le champ du sport où le sujet relève encore d’un tabou. Je fais à nouveau référence à Anne Davisse et Catherine Louveau dans leur ouvrage « sport école et société, la différence des sexes », sur 400 pages elles consacrent une demi-page à l’homosexualité des sportives et sportifs, ce qui veut dire qu’elle n’est pas visible au sein du sport et que l’on n’en parle pas. Nous n’aurions peut être pas dû prendre un exemple qui fait allusion à des violences symboliques et pourtant c’est de cela dont il s’agit. Je vous rappelle quand même qu’Amélie Mauresmo n’a alors que 19 ans. Que se joue -t- il en terme de responsabilités et de résistances ? Nous percevons bien une inclination vers l’orthodoxie des modèles masculins et féminins. Evidemment les hommes doivent assumer une part de responsabilité quant à ces violences symboliques exercées, dans la mesure où une majorité des journalistes, commentateurs sportifs et des entraîneurs sont encore aujourd’hui des hommes. Qu’un homme coache des équipes de femmes relève d’ailleurs de l’ordinaire, l’inverse se révèle extrêmement rare ! La question se pose déjà douloureusement dans le quotidien des enseignants d’éducation physique et sportive.
Les médias jouent leur rôle de conservation d’une orthodoxie sportive, et participent largement d’une pérennisation de la domination masculine. La Fédération sportive de Tennis demande à des jeunes comme Amélie Mauresmo d’être « discrets », l’intégration au sein du monde sportif nécessite une conformation entendue comme une adhésion au modèle pré-déterminé de féminité, de femme et de femme sportive, et la jeune joueuse semble inscrite dans ce mécanisme d’allégeance au système. En deux ans Amélie Mauresmo a quitté le débardeur noir et le short, qu’elle a remplacés par la traditionnelle jupette, et synchroniquement les médias n’évoquent plus que ses résultats sportifs. Le CIO a fortement contribué à cette transformation de la joueuse en convergeant vers des attentes similaires de conformation, en prenant part aux débats ce qui nous paraît très significatif car nous touchons là aux bastions d’un haut lieu du conservatisme. En fait cette restriction d’une réelle émancipation identitaire relève d’une responsabilité collective et les femmes y participent également. Par provocation je serais tenté de dire que les femmes, les mères, les épouses sont les premières résistantes à l’introduction des femmes dans le sport. Si vous voulez voir à quel point certaines femmes sportives peuvent condamner l’anti-conformisme féminin de leurs congénères, lisez l’ouvrage de Nathalie Tauziat ; « les dessous du tennis féminin ».
Elle nous apprend comment Martina Navratilova a évité le lynchage en usant du seul mode de légitimité d’une homosexualité socialement tolérable qui est de la définir comme une sexualité par défaut, compensant l’expérience du rejet par les hommes. Parlant d’Amélie Mauresmo, Nathalie Tauziat salue son courage mais regrette qu’elle ne fasse pas preuve de plus de discrétion, qu’elle se « donne en spectacle » selon ses propres termes.
Plus fondamentalement notre question est de comprendre dans quelle(s) mesure(s) il peut exister une compatibilité entre les critères et injonctions de féminité -douceur, altruisme, générosité...- et la pratique sportive qui requiert un esprit de compétition, le sport se présentant, dans sa définition traditionnelle comme un espace de performance. Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui les femmes pratiquent des activités sportives en dehors des du sport fédéré ou fédéraste comme le dirait Alain Loret qui fait allusion au sport institutionnalisé, en club, régi par des entraînements, de la compétition, des performances et du combat.
D’autres modalités et cadres de pratiques permettent aux femmes d’évoluer plus aisément dans cet univers sportif. Le maintien du capital corporel, le travail sur la forme et sur les formes, sont autant d’occasions de pratiquer du sport mais aussi de tisser des réseaux de relations sociales et en cela le sport favorise la sociabilité. L’intégration des femmes dans les sports jusqu’alors masculins, leur appropriation des modèles sportifs de combat et de compétition ne peuvent que bouleverser la définition de l’identité masculine. Sur des cartes postales pour la promotion du tennis féminin, datant de 1900/1905, vous pouvez voir une jeune femme tenir sa raquette par le milieu du manche. Le commentaire traduit une pratique dont le souci premier reste l’esthétisme ; « Alice, avec sa grâce, joue au low tennis ». Aujourd’hui les femmes transpirent, cognent fort, poussent des cris à chaque lancé de balle. Le corps sportif esthétisé et euphémisé ne suffit plus à la reconnaissance du statut de sportive. A chaque époque, une qualité physique a toujours été rattachée à une ou des vertus morales, et dans le sport il s’agit tout autant de s’entendre sur des traits psychologiques convenus que sur une simple mise en jeu corporelle. Une femme n’a pas le droit de se comporter comme une « guerrière », de transpirer, d’être musclée. Les amateurs de tennis se souviendront avec plaisir de John Mac Enroe, de Jimmy Connors, de Marcello Rios dont on adore le caractère affirmé parce que ce sont des hommes ! Une femme qui cracherait, qui interpellerait violemment l’arbitre insupporterait tout le monde. Amélie Mauresmo dans ses postures, son habitude de serrer le point en lâchant son cri de victoire, agace ou fait ironiquement sourire. Les médias l’ont systématiquement mise en scène dans des postures qui effectivement la désavantageaient alors que par tradition, les photographies de joueuses valorisent le plus souvent leur esthétisme, images de femmes sportives qui s’accommodent bien peu de toute mise en scène renvoyant de près ou de loin au genre masculin orthodoxe.
Nous aurions certes pu aborder la question des femmes dans le sport sous un autre angle, en faisant par exemple référence au taux de licenciées qui augmente et qui souligne que la question des femmes dans le sport ne doit pas uniquement se poser en terme de problèmes et d’inégalités. Effectivement, au regard des chiffres de plus en plus de femmes sont présentes dans des pratiques sportives de plus en plus diversifiées. Mais l’important nous semblait être de pointer les carences d’un système sportif et plus largement culturel et social qu’il s’agit d’interroger dans ce qu’il continue de produire comme inégalités. Les femmes agricultrices ou les ouvrières ont encore moins de probabilités que les femmes cadres ou cadres supérieures de pratiquer un sport, et quel sport ?
Nous avons donc choisi une entrée par l’anthropologie corporelle parce qu’elle pose la question fondamentale de la définition des genres ; qu’est ce qu’un homme et qu’est ce qu’une femme ? Est-ce possible pour une femme et un homme de pratiquer du sport de manière identique ? Clairement, nous avons répondu non.
DEBAT.
Tanguy PHULUP, fédération de lutte bretonne, Gouren.
Quelle est l’influence des autres pays quant à la participation féminine ? Je pense aux pays de l’est, aux Etats-Unis.
Philippe LACOMBE
A propos de cette logique de l’évidence d’un naturalisme des genres, on s’aperçoit qu’il existe des différences incroyables entre les sociétés. Nous passerions trop de temps à évoquer le cas du Maghreb où les femmes sont assignées à des rôles encore plus orthodoxes que ceux que nous critiquions précédemment. En ce qui concerne d’autres pays comme les Etats-Unis, en football par exemple le taux de licenciées oscille entre 25% et 35% alors qu’en France il est d’environ de 1%. Ces chiffres traduisent bien que la correspondance entre les représentations de genres et leurs modalités d’expression reste dépendante de cultures nationales. Nous avons beaucoup à apprendre de l’observation des pays étrangers. Nous ne devons pas construire un européocentrisme ordinaire, nous ne détenons certainement pas le monopole de la bonne définition de ce que sont une femme et un homme. Nous sommes à un stade de développement où certaines nations vont dans le sens d’une recomposition des genres avec une démocratisation des pratiques sexuées, des pratiques sportives, alors que d’autres nations restent incroyablement résistantes aux transformations culturelles y compris dans le sport. J’aurais eu plaisir à prendre d’autres exemples, dont celui de la lutte bretonne/Gouren qui m’intéresse. Il faut rappeler que dans la première moitié du siècle les luttes traditionnelles incarnent fortement la domination masculine. Le sportif incarne dans ce cadre l’homme fort, le héros de la paroisse qui rencontre les hommes des autres villages pour remporter le mouton qu’il ramène sur son dos. A ce moment là il est inconcevable que les jeunes garçons -dans la partie non sportivisée de la lutte bretonne- dominent les vieux, tout comme il l’est que les femmes -dans les jeux traditionnels- dominent voire simplement s’exercent avec les hommes.
Anne Marie Evennou, responsable des activités féminines à la fédération de Gouren.
(...)
Philippe LACOMBE
Je suis complètement d’accord avec vous, n’étant qu’un immigré en terre finistérienne, je ne vais pas jouter. Encore une fois, les exploits de quelques femmes sportives ne suffisent jamais à fonder l’idée que de réelles conquêtes sont intervenues et ont transformé les choses. L’exemple que vous défendez est tout à fait légitime et nous en retrouvons d’autres en natation ou dans le cyclisme. J’ai entendu parler d’une Amélie Le Gall qui gagnait toutes les courses cyclistes des pardons durant l’entre deux guerre, sportive à qui on a par la suite interdit de concourir contre les hommes lors des fêtes de pardons.
Il existe effectivement des avancées comparables aux conquêtes sociales intervenues dans la société ; les suffragettes, les promotrices de vêtements de mode, la lutte contre le corset, les femmes qui se sont accordées le droit de fumer... Oui elles y ont participé.
Mme Graziana(...)
Philippe LACOMBE
Vous avez raison de souligner la subtilité des pressions antinomiques qui peuvent exister à un moment donné. Dans notre propos nous n’avons pas fait dans la subtilité des différents mouvements dans l’histoire du militantisme féminin du secrétariat d’état et d’autres secteurs de la vie sociale. Sur cette question je vous renvoie à la lecture de la domination masculine de Pierre Bourdieu qui semble être un homme plus orthodoxe que moi...
Je souhaiterais évoquer un point sur l’esprit sociologique des lois. Je ne suis pas certain que les lois infèrent sur les moeurs et je crois que les exemples significatifs sont nombreux. Les conditions d’émergence du PACS doivent nous rappeler l’extrême importance du pouvoir de pression des groupes qui même s’ils sont qualifiés de minoritaires, constituent de véritables leviers d’évolution des modes de vies et plus tard des lois.
Qu’il s’agisse de la vie publique ou socio-politique, l’histoire du syndicalisme montre que ce sont bien des groupes minoritaires qui ont fait évoluer les lois sur le travail. En ce qui concerne la parité imposée, je pense que nous étions arrivés à une maturation générale dans la société française qui laissait entendre aussi aux hommes que ce monopole du pouvoir politique commençait à s’avérer plus que violent.
Mme LECLERC.
(...)
Philippe LACOMBE
On les voyait sous un aspect clownesque au même titre que les footballeuses lorsqu’elles ont fait leur apparition. S’il existe actuellement des footballeurs professionnels, il n’y pas d’équivalent pour les femmes. Je souhaite que ces deux disciplines soient marquées par une grande évolution des mentalités. Il serait bon que les lutteuses bretonnes tout comme les garçons qui pratiquent la GRS puissent élaborer leurs propres règlements et qu’ils s’imposent, soient reconnus dans leurs spécificités.
COLLOQUE « FEMMES ET SPORT »
Madame Arlette DELAMARCHE
Bonjour à tous.
Je vais vous parler du retentissement de la pratique sportive sur la physiologie et la santé de la femme. On l’a vu, la place des femmes dans le monde du sport n’est pas encore pleinement reconnue, néanmoins on peut dire que le 20ème siècle a vu un essor important de la pratique sportive chez les femmes et je vais essayer de vous montrer que cet essor doit être encouragé. Il contribue, vous le savez à l’épanouissement psychologique, social, physique également, de la femme et donc à l’amélioration de sa santé. Néanmoins cette pratique ne doit pas être conduite à l’aveugle. Si elle est excessive, inadaptée elle peut avoir des effets négatifs. A l’inverse si elle est bien conduite, elle peut avoir des effets tout à fait positifs. Je m’intéresserai tout particulièrement à deux fonctions dont une est plus spécifiquement féminine, c’est le retentissement de la pratique sportive sur la fonction de reproduction, et ensuite sur le métabolisme osseux.
Vous le savez un des facteurs essentiels qui contribuent à la différence inter sexe, entre l’homme et la femme, c’est bien sûr le climat hormonal.
De la puberté jusqu’à la ménopause, les ovaires chez la femme vont secréter les hormones sexuelles typiquement féminines : les oestrogènes et la progestérone, et ce en réponse à une stimulation par des structures que l’on trouve dans le cerveau, l’hypothalamus et l’hypophyse.
On peut montrer que lors de la pratique physique intensive différents facteurs multiples vont pouvoir, si cette pratique est excessive, perturber les fonctionnements de cet axe. C’est le volume et l’intensité de la pratique mais aussi tous les stress émotionnels qui sont liés à cette pratique ; le stress de la compétition, la pression des parents, de l’entraîneur, éventuellement l’éloignement familial pour les jeunes, la difficulté pour la femme de combiner vie professionnelle, vie familiale et vie sportive. Ils vont avoir pour effet de freiner les secrétions hormonales de ces deux structures au niveau du cerveau, de sorte que, en aval les secrétions des oestrogènes et de la progestérone par les ovaires vont être également diminuées. En outre dans certaines pratiques sportives ou la dépense énergétique est importante, mais aussi dans les pratiques, il y a un fort enjeu esthétique, on peut s’apercevoir qu’il y a bien souvent des carences nutritionnelles. Celles-ci vont altérer la synthèse des hormones secrétées à la fois par l’hypothalamus et l’hypophyse et des hormones secrétées par les ovaires. Tout ceci, va entraîner un effondrement des secrétions en oestrogènes et en progestérone par les ovaires, ce qu’on appelle dans notre langage une carence oestroprogestative.
Les répercussions en fonction de l’âge
Chez les jeunes filles tout ceci va se traduire par l’apparition éventuelle d’un retard de croissance staturale, d’un retard de maturation pubertaire, en particulier observe dans des disciplines où la pratique sportive est très intensive chez les jeunes et je pense plus particulièrement à la gymnastique, au patinage artistique, à la G.R.S.
Chez la femme plus âgée, ceci va entraîner simultanément l’apparition des troubles des règles, c’est-à-dire des règles très irrégulières, anarchiques, voire qui peuvent complètement disparaître pendant plusieurs mois. Simultanément les ovulations deviennent très rares voire disparaissent. Néanmoins, même si elles sont rares, les ovulations peuvent exister. En conséquence, il peut y avoir risque de grossesse chez une jeune fille ou une jeune femme sportive qui pratique à un haut niveau et qui ne prend pas de contraception. Parallèlement on assiste à une diminution de la fécondité, ce qui peut être ennuyeux chez une femme sportive qui désire avoir une grossesse. De l’avis des gynécologues, ces répercussions ne sont pas pour autant irréversibles. Les ovulations vont réapparaître, et en même temps la possibilité d’une grossesse si la femme diminue, voire arrête sa pratique. Néanmoins, cette carence oestroprogestative peut retentir également à un autre niveau, et en particulier au niveau du métabolisme osseux.
Je rappellerai ici, que l’os est un tissu vivant. Il est fait d’une matrice protéique, minéralisée, c’est-à-dire très riche notamment en phosphore et en calcium. Il est vivant parce qu’il se construit et se détruit en permanence. Il échange aussi du calcium avec le sang. Il fixe en permanence du calcium et il relargue en permanence du calcium. Chez le jeune, pendant la croissance la fixation du calcium est plus importante que le relargage – et on dit que le jeune va constituer son capital calcique. Mais ensuite avec l’âge (dès 25-30 ans) le relargage calcique est plus important que la fixation et ce phénomène va s’accentuer avec l’âge et plus particulièrement chez la femme après la ménopause, de sorte qu’il apparaît un risque de décalcification ou déminéralisation osseuse – c’est l’ostéoporose.
Sur ce transparent ici, on voit bien un squelette normal correctement minéralisé et sur cette image radiographique un squelette en voie de déminéralisation déjà ostéoporotique.
3 Facteurs vont jouer un rôle essentiel pour assurer la fixation correcte du calcium sur l’os.
Bien entendu il faut des apports nutritionnels corrects en phosphore, vitamine D et calcium et protéines.
Quand on effectue des enquêtes nutritionnelles dans certains milieux sportifs, comme la gymnastique, le patinage, la GRS chez les jeunes, mais aussi dans les activités à forte dépense énergétique, course à pied, triathlon, cyclisme on observe souvent des carences nutritionnelles et notamment des carences en protéines et en calcium, les deux substrats qui sont essentiels à une ossification normale.
2ème facteur – le facteur hormonal – Pour que la fixation calcique s’effectue correctement il faut bien sûr que les secrétions de toutes les hormones qui participent à la croissance soient normales et tout particulièrement les hormones sexuelles. Il faut une imprégnation normale en oestrogènes et progestérone.
3ème facteur : les facteurs mécaniques
On sait aujourd’hui que lors de la pratique physique, les charges mécaniques qui s’exercent sur l’os vont avoir pour effet de stimuler la fixation du calcium, mais à la condition qu’elles ne dépassent pas un certain seuil. Au-delà de ce seuil, c’est l’effet inverse qui va se produire, de sorte que la répercussion de la pratique sportive sur l’os peut être négative ou positive.
Si on se trouve dans un cas de figure où les apports nutritionnels sont insuffisants, s’il y a carence oestroprogestative si les charges mécaniques sont excessives on va assister à une déminéralisation osseuse et éventuellement à court terme chez la sportive de haut niveau à l’apparition de fractures de fatigue.
Cette figure ici montre bien l’importance du climat hormonal pour la densité osseuse.
Les deux groupes où la densité osseuse est la plus élevée sont des femmes normalement réglées.
Les deux groupes où la densité osseuse est la plus faible sont tous les deux des groupes où les femmes présentent un arrêt total de règles, avec ici des femmes sédentaires (il s’agit ici de femmes qui présentent des anorexies mentales) ici des femmes sportives mais qui présentent un arrêt de règles important.
Dès l’instant où les règles sont perturbées il y a perturbation de la fonction hormonale ; la densité osseuse est compromise et il y a un risque de déminéralisation osseuse.
Mais si cette pratique physique est conduite sans charge excessive, si elle est également accompagnée d’un bon apport nutritionnel suffisant, correct et s’il n’y a pas de carence ostroprogestative, dans ces conditions la pratique physique et sportive au contraire va stimuler la minéralisation osseuse et prévenir l’ostéoporose – que l’on peut constater à un âge avancé.
Je m’appuie ici sur une vaste étude américaine qui a été entreprise par TALMESH en 1985 et qui porte sur plus de mille femmes de 18 à 98 ans. Schématiquement cette étude montre que déjà à l’âge de 25 ans, ce sont les femmes les plus actives qui ont la densité osseuse la plus élevée.
D’autre part la densité osseuse va diminuer systématiquement avec l’âge chez les femmes inactives, et sur les 1200 qui ont été testées il y en avait 1105 – donc une très large proportion.
A l’inverse chez les 10% de femmes actives, la densité osseuse reste stable. Il s’agit de femmes qui pratiquent environ 1 heure par séance, 3 séances par semaine et très régulièrement au moins depuis 5 ans.
Cette étude et d’autres ont également montré que dans la prévention de l’ostéoporose se sont exclusivement les activités dites en charge qui exercent l’effet le plus efficace. Les activités en charge sont les activités dans lesquelles on soulève un poids (ce peut être le poids du corps évidemment) mais en particulier les activités qui sont entreprises dans les associations, les clubs, les clubs de remise en forme, toutes les activités de renforcement musculaire qui utilisent des marches (le step test) des petites charges ont un effet favorable sur la densité osseuse. Viennent ensuite la course à pied puisqu’on soulève le poids du corps, puis le vélo et enfin la natation.
En conséquence, une pratique physique régulière à condition qu’elle soit progressive, parfaitement adaptée à l’individu et accompagnée d’une hygiène de vie correcte va, chez la femme comme chez l’homme, exercer des effets tout à fait favorables sur la santé.
Comment ? Elle va améliorer la condition physique c’est à dire la souplesse, la force musculaire, l’endurance, la puissance musculaire. Elle va améliorer les fonctions métaboliques, en particulier l’utilisation des sucres et des graisses, elle va améliorer les capacités cardio respiratoires. Elle va stimuler les mécanismes de défenses immunitaires et elle va stimuler la fixation calcique.
Grâce à ces différents effets la pratique physique va limiter l’ankylose articulaire et l’enraidissement, va contribuer à prévenir un grand nombre de maladies cardio-vasculaires.
Elle va limiter le risque d’hypertension, de maladies coronariennes (l’angine de poitrine, l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux). Elle va limiter un phénomène qui prend de plus en plus d’importance dans nos sociétés occidentales, la surcharge pondérale et l’obésité. Elle limite le risque de diabète. En stimulant les mécanismes de défense, elle contribue aussi à améliorer nos défenses contre les maladies infectieuses et à diminuer un petit peu la fréquence de certains cancers et enfin on l’a vu à prévenir l’ostéoporose.
Ainsi une pratique physique régulière bien conduite est un des principaux facteurs qui permet de lutter contre le vieillissement, d’améliorer l’espérance de vie et améliorer l’autonomie des personnes âgées. Je vous remercie
COLLOQUE « FEMMES ET SPORT »
Madame DECHAVANNE
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Je vais essayer de vous dresser un constat sur la place des femmes dans les postes de décision au niveau du sport. Le sport ne peut pas être isolé de l’évolution sociale, il est très représentatif de la culture et l’observation de l’évolution de la présence des femmes dans le monde est bien significatif du rapport entre culture société et place des femmes dans le sport.
Dans l’accès aux responsabilités, on retrouve la traditionnelle répartition des tâches. Les hommes sont plutôt routiers, les femmes assistantes maternelles. Donc les sphères de l’investissement masculin et féminin restent très traditionnelles dans notre culture. Plus on monte dans la hiérarchie des postes moins il y a de femmes.
Citation de Mme LAUFER Professeur à HEC au cours du dernier séminaire au CNOSF sur la question de la place des femmes en poste de décision dans le milieu de l’entreprise « la séduction l’influence, voilà plutôt les qualités reconnues aux femmes que la légitimité à exercer une position de pouvoir formel ».
Il paraît important aujourd’hui de réfléchir et d’agir. Il y a déjà 20 ans j’avais essayé de créer une association Femmes et Sport pour inciter les femmes à rentrer à la direction du sport. Nous étions 3 à avoir répondu, aujourd’hui nous sommes 64.
Il y a en maturation et au moment du débat sur la parité, cette question devient centrale dans tous les domaines de la vie publique, et elle devient aussi centrale pour l’avenir du sport. La femme va s’impliquer dans tous les sports, les sports agressifs, combatifs et développer le sport mais elle va aussi en s’introduisant dans le sport, changer le sport.
Je vous propose de :
1) Faire un constat – où sont les femmes dans la direction du sport.
2) Analyser des grandes causes explicatives très schématiques
3) Proposer des solutions, en m’appuyant sur les idées émises lors des différents colloques auxquels j’ai participé.
Le constat
Dans le travail réalisé par le groupe parité au niveau du ministère, un point a été fait en 1989. Il y avait une présidente de Fédération : l’équitation. Aucune femme au comité directeur CNOSF sur les 36 membres élus.
Dominique PETIT a fait une étude au niveau de CROS aucune femme présidente au niveau des CROS et au niveau des CDOS 6 femmes présidentes sur 96.
Au niveau des directions techniques la situation est semblable. 3 femmes étaient directeurs techniques (danse, gymnastique volontaire et sport adapté), là il y a une justification de la forte présence des femmes compte tenu de la forte présence des pratiquantes. 12 entraîneurs nationaux sur 78 et une femme ministre. 3 femmes ont été ministres des Sports, il faut se poser la question pourquoi des femmes ministres au ministère de la J. et des Sport ? car il n’y a aucun chef de service au ministère des sports.
Une étude précise portant sur 9 activités montre un décollage important entre le nombre de licenciés (statistiques consultables) et la présence des femmes aux comités directeurs.
Particulièrement en gymnastique et au volley Ball : plus de 30% d’écart.
La situation des femmes dans le pouvoir sportif en France est peut être pire que celle que l’on trouve en politique, elle ressemble à celle qu’on trouve en ce moment au niveau des grandes entreprises
En effet Mme LAUFER notait 7% des femmes dans les équipes dirigeantes des grandes entreprises et 4,8% dans les entreprises de + de 500 personnes.
Des changements s’amorcent, car depuis cette étude 1 femme a été nommée présidente à la course d’orientation, une autre à la FFEPMM. En même temps « on a perdu » une femme dans un poste de DTN. Voilà la situation.
Les résultats attendus des élections dans les fédérations et au CNOSF vont peut être montrer un changement.
Les raisons
Les raisons sont multiples, celle qu’on évoque souvent sans s’y attarder est le retard au niveau de l’accès des femmes à la pratique sportive. Donc il est un peu normal qu’au niveau du pouvoir il y ait un retard plus important, mais ce retard est accentué parce que le milieu sportif apparaît comme très conservateur, très traditionaliste, marqué par une organisation fonctionnant en réseau et très hiérarchisée.
Ainsi le temps du sport est un temps masculin. Les réunions se poursuivent tard le soir, elles occupent le week-end, elles concurrencent la vie de famille; On trouve plus d’implication de femmes au niveau local. A BREST monsieur le Maire nous précisait que des femmes étaient présidentes – 12 sur 250 ! Plus on s’élève dans la hiérarchie moins elles sont présentes.
A partir du moment où il faut se libérer longtemps… les femmes sont moins présentes. J’avais fait une enquête il y a une dizaine d’années quand on posait la question à des femmes qui étaient au niveau région pourquoi elles ne se présentaient pas au niveau national, les réponses étaient que : si elles avaient l’autorisation du mari pour assister à une réunion locale, pour découcher une nuit c’était beaucoup plus difficile. Et çà c’était il y a 15 ans.
Historiquement des étapes restent à franchir. La féminisation des pratiques est récente, la féminisation du pouvoir va être plus longue compte tenu du fonctionnement du milieu. La 2ème cause, c’est le poids des stéréotypes et des représentations des rôles féminins et masculins.
La sphère privée traditionnellement réservée aux femmes
La sphère publique aux hommes.
Les femmes ont toujours en charge malgré les changements, l’essentiel des tâches familiales et ceci est d’autant plus vrai dans les classes populaires et les classes très aisées, la classe moyenne peut provoquer le changement, là les rôles sociaux s’échangent.
J’ai noté au moment des élections municipales dans le journal « Le Monde » : une majorité de français souhaitait que leur maire soit une femme. Et majoritairement les personnes estiment que la gestion des femmes améliorait la politique menée dans la quasi-totalité des secteurs d’intervention municipale : l’environnement, la culture, le budget, la sécurité à l’exception des transports et des sports dernière chasse gardée masculine. J’ai entendu qu’ici à BREST, il y avait une adjointe de l’adjoint…
Donc le sport reste dans les mentalités un domaine traditionnellement réservé aux hommes.
On ne voit pas l’adjointe aux sport, aller le dimanche par un dimanche pluvieux sur un terrain de football pour féliciter l’équipe dans le cadre du championnat.
De plus dans ce marquage des rôles féminins et masculins l’implication des femmes dépend de l’homme va décider de s’engager dans tel secteur d’activité, dans tel syndicat, de se faire élire à la présidence d’un club, une femme quand elle veut s’engager dans la vie associative doit en général être soutenue par son partenaire sinon c’est le divorce. Le problème ne se pose pas de la même façon pour les hommes et pour les femmes au moment d’une prise de pouvoir. Et donc moi je me souviens au moment de quitter la présidence de l’EPGV avoir sollicité quelques femmes pour me remplacer et avoir pris soin avant de les solliciter, pour ne pas créer trop de problèmes de demander l’accord de leur mari. Remarquez avec moi ils étaient toujours d’accord. Je ne sais pas ce qui se passait à l’intérieur du couple. Mais je dirai que l’engagement féminin dans la vie associative est plus dépendant de la relation du couple que l’engagement masculin.
3ème point. La dévalorisation des capacités féminines – cette dévalorisation n’est pas uniquement le fait des hommes, les hommes reconnaissent des qualités importantes aux femmes, et souvent c’est elles-mêmes qui ne se sentent pas capables d’assumer certaines responsabilités. La culture les a tellement persuadées qu’elles n’étaient pas faites pour assurer le pouvoir qu’elles en prennent un peu l’habitude. Reportez-vous au bouquin d’ESTABLET « Allez les filles ». Si les filles ont de très bons résultats scolaires, au moment de l’orientation elles ne vont pas aller vers des carrières qui correspondent à leurs résultats scolaires. Aussi bien, elles prennent des orientations d’identité sexuée dans les pratiques et l’orientation vers des tâches de prise de décision leur apparaît comme une caractéristique masculine. Alors aujourd’hui il est vrai qu’après les élections municipales et les campagnes qui ont été faites, le milieu politique offre de nouveaux modèles qui peuvent intéresser les femmes, mais ces nouveaux modèles n’ont pas encore émergés dans le milieu sportif. Il y a un changement, si des obstacles temps et famille sont relativement résolus, les candidates potentielles refusent à se confronter à une relation de pouvoir…manque de confiance en soi, mais aussi chez les femmes soucis de préserver un équilibre personnel qui n’est pas compensé en général par la réussite sociale. La même chose se rencontre dans l’entreprise, les femmes cherchent à maintenir une certaine disponibilité pour assurer leur rôle familial parce qu’elles pensent que c’est un équilibre personnel et un style de vie qu’il faut préserver.
Dernier point dans cette dévalorisation féminine et qu’on entend très régulièrement quand on interroge des femmes qui ont pris des grandes responsabilités elles doivent assumer et prouver continuellement leurs compétences pour assurer leur légitimité. Et donc cet investissement est encore plus important que lorsqu’un homme prend un poste de décision.
Autre aspect, le cas de poste technique Des entraîneurs hommes pour les femmes mais très peu d’entraîneurs femmes pour des masculins.
Là, on se heurte en plus de la traditionnelle répartition des tâches et des stéréotypes de la représentation, du féminin et du masculin, la représentation traditionnelle de la place du muscle dans le sport et de la force ne va pas au féminin On a interrogé une femme directrice aux Glénans elle disait que les familles elles-mêmes ne faisaient pas confiance pour une sortie en voile, pour un « baptême de l’air » à de si frêles apparences. Donc, l’idée qu’une femme puisse assurer la sécurité avec des apparences moins musculaires que l’homme, fait qu’au niveau des postes techniques, en plus de problème du temps, de l’organisation etc… se pose des problèmes de confiance. Le muscle est une caractéristique masculine et faut continuellement faire ses preuves pour créer la confiance. De plus au niveau des postes de DTN et d’entraîneurs nationaux il y a une concurrence masculine assez forte, parce que le poste est prestigieux. Même une championne olympique a du mal à faire sa place et à se faire reconnaître et on craint souvent que la femme n’ait pas la disponibilité réclamée par ce poste là. Le problème des postes à responsabilité dans l’encadrement technique est encore plus important que le problème des élus.
Alors les solutions
C’est le résultat de différentes discussions avec des hommes et des femmes. Pour le problème des cadres techniques il faudrait envisager une autre forme d’encadrement technique, des équipes nationales de façon à ce que toute la tâche ne repose pas sur une personne et remplacer l’unique entraîneur par un encadrement collectif aux responsabilités partagées. S’inspirer des centres médicaux, il n’y a pas qu’un seul médecin mais plusieurs afin que chacun puisse répondre à une demande, être toujours présent mais qu’on se répartisse les tâches différemment. Et là je pense que les épouses de techniciens seraient tout à fait d’accord et peut-être qu’elles trouveraient leur mari plus souvent à la maison. Il y a peut être une collaboration à avoir de ce côté là.
Au niveau des élus beaucoup de solutions sont proposées, des solutions qui concernent les hommes et les femmes, car on constate aujourd’hui que le bénévolat est en crise et qu’on a du mal souvent à quelque niveau que ce soit même de trouver des remplaçants. La pression sociale est forte, l’esprit de consommation et l’individualisme entraînent une désaffection du bénévolat, le chômage, la baisse du niveau de vie poussent les gens quand ils ont du temps libre plutôt à rechercher des revenus complémentaires qu’à s’investir dans des tâches associatives. En plus les fonctions d’élus deviennent de plus en plus exigeantes. Il faut avoir de la disponibilité et faire preuve de compétences.
Donc il y a une véritable crise du bénévolat et la solution proposée par le CNOSF de trouver les moyens de reconnaître les actions des bénévoles et élaborer un statut du dirigeant sportif. Proposer des aménagements d’horaires dans le travail, proposer des aides pour la garde des enfants, pour aller aux réunions etc… et amorcer une réorganisation pour que chacun ait du temps à consacrer à la tâche.
D’autres solutions plus spécifiques au mouvement sportif associatif, ont été préconisées par Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports, il s’agit de mettre en place à tous les niveaux de l’institution des responsables chargés du sport féminin qui doivent coordonner des actions menées en direction des femmes. Depuis les Assises Nationales de 1999 le réseau de correspondantes régionales fonctionne bien. Beaucoup de séminaires de ce type sont organisés et les subventionnements du sport, le prix média créent une sensibilisation au niveau de l’investissement des femmes. Le gros problème qui se pose aujourd’hui c’est le problème des quotas et donc le problème de la parité débat national qui rebondit sur le monde sportif. Au niveau du CNOSF il y a eu une proposition de réserver 5 places pour les femmes au niveau du comité directeur. Il semblerait que cette décision votée par le CNSOF soit remise en cause parce qu’il n’y a pas de réponse du conseil constitutionnel sur cette proposition. Il sera dommage que cette année on ne puisse pas appliquer ce texte de modification des statuts du CNOSF qui a été voté au mois de décembre par le conseil d’administration. Le CIO a mené une campagne et mis en place depuis 3 ans une commission féminine et a demandé que d’ici le 31 décembre 2000, des postes soient réservés aux femmes dans toutes les structures de décision des comités olympiques et ce pourcentage de 10% serait porté à 20% en 2005, mais que faire si ce pourcentage n’est pas atteint ?
Autres solutions
Aménager le milieu sportif (des horaires masculins, des réseaux masculins ! lorsqu’on interroge des femmes qui se sont investies dans différents postes, rapidement elles abandonnent, parce qu’en fait elles s’y sentent mal, et n’ont pas envie d’y rester.
Donc il y a des efforts à faire pour mieux organiser le travail du dirigeant, exploiter les formes de communications modernes (internet) et pour participer d’une autre façon à la vie associative.
Dernier aspect : attirer les femmes vers ces fonctions. Constituer des réseaux, aider les femmes à faire les premiers pas, leur donner des soutiens de formation, en particulier sur la prise de parole. Ne se sentant pas écoutées elles se replient sur elles-mêmes et on beaucoup de difficultés à prendre la parole. Il serait intéressant de montrer aux femmes que l’implication dans une association sportive n’est pas seulement une tâche difficile mais favorise l’épanouissement personnel, crée de la camaraderie, vous pousse au progrès, vous permet de sortir de votre secteur habituel. Ce sont des moments d’enrichissement personnel très important.
Alors qu’on médiatise des championnes, il serait temps de médiatiser des réussites personnelles et que les femmes elles-mêmes expliquent comment elles s’organisent pour assumer leurs missions. Comment le sport au niveau de la direction peut être un apport pour elles.
« Il existe des dirigeantes dynamiques, heureuses, équilibrées, reconnues chez elles comme dans la société et qu’il faudrait montrer »
Ce changement ne peut pas se faire sans la participation des hommes. La participation des femmes dans des lieux de décisions à égalité avec les hommes est une revendication qui doit être aussi importante pour les hommes pour les femmes parce que c’est un idéal partagé. Les hommes qui sont actuellement au pouvoir doivent collaborer à mon avis à ce changement de société.
L’association que nous avons créée pour faire un réseau femmes et sport nous l’avons appelée « Femmes-Mixité-Sport » pour que les hommes puissent participer (PUB !) afin que ce ne soit pas un réseau de femmes mais un réseau mixte.
Personnellement, si j’ai été présidente de FFEPGV c’est parce qu’un homme m’a sollicitée Monsieur Bernard PARIS, et m’a dit, je m’en vais, j’ai fait deux mandats, il serait bien que ce soit une femme qui se présente. Je n’aurais jamais pensé de moi-même à me présenter à la présidence. J’étais au comité directeur, j’étais très satisfaite et je n’aurais pas pensé à me présenter s’il n’avait pas fait cette démarche. Je me suis renseignée et je me suis lancée. De la même façon au moment ou il y a eu une réforme au CNOSF, j’ai pris position pour Monsieur PAILLOUX. ayant pris très nettement une position pour les changements de statuts du CNOSF, Monsieur PAILLOUX m’a sollicitée pour rentrer dans le bureau du CNOSF.
Je ne me suis pas bagarré, c’était une conception du fonctionnement, j’étais dans le réseau peut être la femme alibi, mais il y a bien une étape où il faut être la femme alibi et il faut surtout répondre oui. Pour répondre oui, il faut montrer que c’est un lieu très attirant, et pour que ce soit attirant il faut que l’on collabore tous ensemble, l’un et l’autre sexe.
Merci
Atelier A
ACCES AUX PRATIQUES SPORTIVES
Invités témoins
Madame Hélène ANDRE « coach" de Raphaëlla LE GOURVELLO
*Madame Raphaëlla LE GOURVELLO – Athlète de Haut Niveau – traversée de l’Atlantique en planche à voile
Madame Katarin QUELENNEC – Athlète de Haut Niveau Natation (Club Nautique Brestois)
Madame Morgane PETIT – Basketteuse N2 – Formatrice arbitres
Monsieur Claude JADE – Professeur EPS – créateur de la section féminine de rugby à BREST (BUC)
Avec la participation :
Monsieur Gérard CABON – Adjoint aux sports de la ville de BREST
Monsieur Hervé COUDRAY – chargé de mission régional « Femmes et Sport » à la DRJS de RENNES
Animateur
Monsieur Gérard ABGRALL – Professeur EPS -Directeur Départemental de l’UNSS
Animateur : Sur la forme les témoins vont parler de leur aventure, de leur expérience puis dialoguer avec la salle.
Katarin si tu veux commencer, parler de ton expérience du haut niveau et des aspects peut-être positifs et négatifs ?
Katarin QUELENNEC - En fait j'ai commencé à l'occasion d'une fête scolaire ; j'ai été au collège et j'ai suivi la filière sport étude ; on s'entraînait le matin et le soir.
Après ça s'est poursuivi au lycée. Je voudrais insister sur le fait que cela m'a permis de suivre une scolarité normale quand bien même on avait au lycée 22 heures d'entraînement par semaine.
Du point de vue des avantages il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est un emploi du temps plus chargé, ce qui ne m'a toutefois pas empêchée de m'organiser durant toute ma scolarité. Cette année je suis entrée à la Fac et je bénéficie d'aménagements en tant qu'athlète de haut niveau. A savoir que je peux me placer dans des groupes compatibles avec les horaires d'entraînement et les périodes de compétition ; cela vaut également pour les "partiels". Voilà du point de vue des avantages
* A l’heure où nous écrivons Raphaëlla se prépare à partir pour la traversée du Pacifique
A - Et l'accès au haut niveau ? Comment cela se passe-t-il ? Comment as-tu ressenti l'accès à une élite ? Comment à ton avis arrive-t-on à haut niveau et quelles raisons font que certains y accèdent et d'autres pas ? Par exemple tu as pu voir des camarades d'entraînement qui eux n'ont pas eu accès à ce niveau-là. Quelles explications peut-tu avancer ?
KQ - A la base on repère les nageurs sur leurs qualités physiques. Mais il faut aussi prendre en compte l'entraînement, tant du point de vue volume que de la qualité. On peut voir que ce n'est pas forcément en faisant des longueurs et des longueurs qu'on arrive à haut niveau mais qu'il faut aussi prendre en compte l'aspect technique.
Ceux qui n'y arrivent pas manquent peut-être d'assiduité. Il y a également une hygiène de vie à suivre. Il y a en fait plein de choses qui font que certaines personnes ne peuvent pas atteindre le haut niveau par rapport à d'autres. A la base ce sont peut-être des personnes qui ne sont pas forcément faites pour ce sport, qui n'ont pas la morphologie ou l'état de forme d'un athlète de haut niveau.
A - Au niveau des entraînements êtes-vous préparés psychologiquement ? Et quand arrivent les compétitions avez-vous une préparation spéciale que l'on pourrait étendre éventuellement à d'autres disciplines ?
KQ - Nous avons été suivis un moment par un psychologue ; on discutait avec lui de nos objectifs de la saison et il essayait de nous maintenir le plus possible dans cette voie spécifique et d'éviter la dispersion. Avant les compétitions c'est une période d'affûtage qui dure deux semaines avant l'échéance. On ne pense qu'à ça et à tous les détails. L'entraînement est basé là-dessus. C'est une période assez tendue
A - La natation est un sport individuel mais quand vous vous entraînez en groupe est-ce qu'il y a une différence entre la préparation, masculine et féminine dans le processus d'entraînement ?
KQ - Contrairement à ce que l'on pourrait penser les entraînements des garçons et des filles sont exactement les mêmes. Il y a même des garçons qui vont moins vite que des filles. Il n'y a aucune différence là-dessus entre filles et garçons pour l'accès au haut niveau. Par exemple dans le club où je suis, les meilleurs résultats sont obtenus par les filles qui sont par ailleurs plus nombreuses.
A - On arrive peut-être plus facilement à avoir des résultats immédiats avec les filles ? Les garçons obtiennent peut-être plus tardivement des résultats que les filles ?
KQ - Oui en fait les filles ont un "bon" poids plutôt que les garçons. Les garçons sont plus musclés. En fait ça dépend de l'âge : les garçons sont plus lourds, les filles arrêtent plus tôt.
A - Des questions dans la salle peut-être ?
Salle - J'ai une première question ; tu viens de dire qu'il y a davantage de filles que de garçons dans ton club ; moi je fais du cyclotourisme, ce qui n'a rien à voir, mais il y a zéro filles et nous sommes quarante hommes. Pourquoi y a-t-il davantage de filles que de garçons dans le cas particulier qui est le tien ? Est-ce dû au type de sport, est-ce historique ou est-ce quelque chose qui a évolué ces dernières années ?
KQ - Je pense que c'est plus un sport masculin mais qu’au fur et à mesure les filles s'y sont mises.
S - Je crois qu'historiquement les femmes ont toujours été très attirées par l'eau, aiment les sports d'eau. Dans les collèges on amène plus facilement je pense les filles à la piscine que sur un terrain de foot.
S (Gérard Cabon) - Je connais un peu la situation pour avoir été au club. On amène ses gamins à la piscine et les maîtres nageurs repèrent dans ceux qui apprennent à nager les enfants qui ont des qualités aquatiques
S - Mais pourquoi plus de filles ?
S(gc) - Il me semble que les garçons sont plus inspirés par les sports collectifs. Mais le CNB a eu son heure de gloire avec les garçons pendant longtemps ; ensuite vient la période "Astruc" avec les filles et maintenant encore c'est plutôt les filles, Marianne Leverge, Katarin, mais on vient de voir deux garçons brestois qui aujourd'hui sont partis pour être au top.
S - Je ne voulais pas parler du top mais du nombre de licenciés
S (gc) - Il y a 8OO licenciés et le C.N.B. est le 2° club français C'est vrai qu'il y a une pyramide : le pôle France, le pôle régional, le pôle départemental mais il y a aussi ce qui fait la base.
Je pense que c'est le contre exemple type aux grands débats qui opposent la masse et le haut niveau. Le CNB d'il y a 15 ans avait150 licenciés. Quand Kasimir Klimec* est arrivé à Brest on a remonté le niveau et en même temps qu'on a remonté le niveau, il y a aujourd'hui 800 licenciés ; comme quoi c'est possible !
S - Un point m'interpelle un peu ; il s'agit du volume d'entraînement. Ce matin quand le médecin du sport a parlé des problèmes physiologiques que pouvait poser le nombre d'heures d'entraînement dans la pratique sportive intensive où l'on demandait beaucoup aux filles, il n'a cité que la gymnastique, la GRS et le patinage artistique. Il me semble pourtant que, en natation 22h d'entraînement par semaine c'est pas mal aussi. Est-ce que cela pose des problèmes aux femmes ? 22 heures !! Ca n'a pas du tout été cité ce matin. Mais quel volume ! J'aimerais que vous en parliez un peu ; j'imagine qu'il y a des exercices en plus à côté.
KQ - Nous avons deux voir trois heures par semaine de musculation, comprises dans les 22 heures. C'est un rythme qu'il faut prendre et je pense qu'il faut ça pour arriver à haut niveau
A - Comment se passait une journée au lycée ?
* Entraîneur CNB
KQ - Au Lycée, à l'âge de 16 ans et jusqu'à 17/18 ans, on va à l'entraînement à 6 heures 30 / 7 heures, on est dans l'eau jusqu'à 9 heures moins 20 en gros ; ensuite il y a un minibus qui nous emmène au lycée puis on a la matinée normale jusqu'à midi ; on reprend quelques fois les cours à 13 heures, parce qu'il faut bien caser les heures, et ce jusqu'à 17 heures ; à 17 heures 20 on se met dans l'eau et on nage jusqu'à 19 heures ; ensuite on rentre, on mange jusqu'à 20 heures 30, après on se met au travail et on ne se couche jamais avant 22heures 30.
S - Vous faites des semaines de 60 heures alors que tout le monde réclame les 35 heures !
S (Hervé Coudray DRDJS) - Je ne pense pas que ce soit une spécificité du sport féminin ; c'est une spécificité du sport de haut niveau ; si on veut atteindre le haut niveau il faut s'entraîner de nombreuses fois
Il m'intéresserait par contre de savoir s'il y a, en terme de récupération, des différences entre les hommes et les filles ou est-ce le même programme du début à la fin ? Quand je dis récupération il peut aussi s'agir d'un allègement du nombre d'heures d'entraînement ?
KQ – Ce sont les mêmes programmes d'entraînement et pour ce qui est de la récupération c'est la même chose. On a des diminutions d'horaires quand quelqu'un est peut-être plus fatigué; mais on ne fait pas de différence entre filles et garçons
S - Vous avez des périodes de stage qui en fait correspondent en gros aux vacances scolaires et là, de 22 heures par semaine, vous passez à 40 ou quelque chose comme ça ?
KQ - Là généralement c'est 6h/jour d'entraînement dimanche compris.
S - Existe-t-il une différence entre les entraînements en club, lorsque l'on est arrivé à haut niveau, et les entraînements fédéraux lors de préparation aux compétitions internationales ?
KQ - Je n'en ai pas vu énormément ; quand j'étais arrivée en équipe de France les entraînements étaient peut-être un peu plus spécifiques, mais les horaires, le nombre d'heures, le volume étaient exactement les mêmes. Mais oui un peu plus spécifique : par exemple il y avait un entraîneur qui regroupait la spécialité brasse et là il y avait des hommes et des femmes qui nageaient ensemble.
A - Est-ce que cet entraînement, qui concerne apparemment garçons et filles de haut niveau est cogéré par des entraîneurs masculins et féminins ou bien est-ce que l'entraîneur est unisexe entre guillemets ?
KQ - C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'entraîneurs féminins. Je n'ai eu que des entraîneurs masculins sauf pendant ma préparation olympique où je me suis retrouvée avec une femme et je n'ai pas vu énormément de différence. C'était la première fois pour moi, il s'agissait d'un essai et les résultats ont été bons. C'est vrai que le nombre d'entraîneurs femmes reste quand même trop petit par rapport à la présence masculine.
S - Pourtant tu disais que dans ton club il y avait plus de nageuses que de nageurs et en fait, tu n'as toujours eu que des entraîneurs masculins ?
KQ - Oui
A - Est-ce que tu aimerais être entraîneur ?
KQ - Je pense que ça me conviendrait pendant un période mais que je finirais par en avoir assez. Parce qu'avoir baigné si longtemps dans ce milieu amène une saturation ; mais ça me plairait bien quand même.
S - Une question d'ordre général : visiblement on s'intéresse aux femmes, c'est un à priori que je vous donne, uniquement quand elles sont bonnes. Je m'explique : tout à l'heure vous nous disiez qu'il y avait à peu près 800 personnes dans le club, c'est ça ? Ma question est la suivante : s'intéresse-t-on autant aux femmes quand elles sont en devenir que quand elles ont déjà réussi ? Et là la différenciation sexuelle s'exprime, c'est à dire est-ce qu'on n'attend pas des femmes qu'elles manifestent une compétence avant de s'y intéresser ? Il n'y a pas de repérage à priori alors que chez les hommes le repérage est systématique. Chez les femmes c'est la masse qui donne lieu à l'élite
L’animateur à Hervé COUDRAY : Vous qui dirigez une équipe de jeunes en nationale, pouvez-vous nous dire s'il existe une différence de repérage entre les équipes de France de basket féminine et masculine ?
HC - A priori, je réponds pour le basket, la détection est identique pour les hommes et pour les femmes. Elle est faite de la même façon à savoir qu'à partir de la masse, des gens sont chargés d'essayer de détecter des potentialités des hommes aussi bien que des femmes.
Mais je voudrais revenir sur la question de l'entraîneur homme ou femme. Je ne sais pas s'il est très important que ce soit un homme ou une femme qui entraîne mais il me paraît primordial de savoir si la personne qui entraîne a la sensibilité pour s'occuper d'un groupe féminin ou d'un groupe masculin.
Je suis intimement persuadé qu'on perd énormément de sportives parce que certaines personnes qui s'occupent des filles n'ont pas réfléchi à la façon dont on intervient avec un groupe "femme" ; par exemple les gens qui font la formation" tronc commun" du brevet d'Etat ne disent pas un mot, n'écrivent pas une ligne de ce qui touche à la pédagogie ou à la psychologie féminine. Or cela me semble quelque chose d'important.
J'ai eu la chance de coacher l'équipe de France féminine de basket et je me suis occupé d'un groupe professionnel garçon. Aujourd'hui j'ai plutôt le sentiment, pourtant je suis un homme, d'avoir vécu des choses plus profondes, plus intimes avec les filles. Quand je dis intime cela se traduit par le fait que mon athlète est capable d'aller plus loin, de repousser la barrière de la fatigue ou la barrière du "c'est trop dur je ne peux pas". Pour toucher un homme j'avais plus de difficulté qu'avec une femme, peut-être parce que j'ai réussi à trouver cette sensibilité pour arriver à ce qu'elle aille un pas plus loin.
S - Peut-être qu'elles doivent tout le temps prouver quelque chose ?
S - C'est général ; à l'école aussi elles sont plus bosseuses ; c'est dans tout, pas uniquement dans le sport qu'elles doivent prouver constamment.
S - Peut être que les garçons dans ces cas là réussissent plus facilement entre guillemets que les filles. C'est une connotation. On dit : "ma fille il faut travailler plus pour réussir", alors que les garçons ça doit leur tomber tout cuit.
A - Donc là c'est plus difficile ?
KQ - Au club on repère les enfants quand ils sont en CM2 et le repérage est en fait le même ; on ne va pas faire de différence. Les garçons et les filles sont dans le même moule. Et quand tu n'es pas bon on te met forcément de côté. On ne te laisse pas continuer jusqu'au collège ce qui fait qu'en 6° certains abandonnent, d'autres continuent.
S - Est-ce qu'il n'y a pas un problème de maturité ? La fille est mature beaucoup plus jeune que le gars et on s'aperçoit que dans beaucoup de disciplines comme la gymnastique et autres, la carrière s'arrête à 20 ans pour les femmes. Or on voit quand même des gymnastes hommes à 25/26 ans qui sont au top, ce qu'on ne voit pas chez les filles.
KQ – Oui, il n'y a pas que le mental. Il y a aussi une maturité physiologique ; c'est le corps qui veut ça et il y a un moment où, en natation ou en gym, on ne peut plus aller plus loin.
A - Raphaëla est-ce que vous voulez nous faire part de votre expérience ?
Raphaëla Le Gouvello - J'ai l'impression d'être un cas totalement atypique dans cette assemblée et je veux juste mettre les choses au point. D'abord j'ai 40 ans, je suis installée dans la vie active, je travaille, je suis vétérinaire.
Mais je suis aussi une véliplanchiste. J'ai commencé la planche en 76, j'ai continué à pratiquer la planche quand j'étais étudiante, et j'ai même fait un peu de compétition en ligues et inter ligues sur les grandes planches open.
Ensuite j'ai arrêté : c'était tout simple il fallait que je travaille ; mais j'ai continué à pratiquer la planche comme quelqu'un qui est parfaitement amateur, en sortant dès qu'il y avait du vent. Mais il est vrai qu'en planche à voile quand on fait du "fun" il n'y a pas beaucoup de filles qui sortent.
Quand je me suis lancée dans ce projet de traverser l'Atlantique en planche à voile, je réalisai un rêve d'enfance et en même temps j'étais bien consciente que pour faire ce genre de pari un peu fou il fallait avoir une préparation physique sérieuse. Je suis donc allée voir les gens compétents autour de moi, pas très loin, du côté de La Baule. J'ai été mise en rapport avec le CHU de médecine du sport de Nantes. J'y ai passé des tests d'effort et alors là grosse déconvenue : parce que moi qui croyais que j'étais sportive je me suis rendue compte que j'avais un niveau très moyen. En conséquence il m'a gentiment été conseillé de mettre en rapport avec des entraîneurs professionnels.
J'ai alors travaillé avec le pôle de planche à voile de La Baule où j'ai été mise entre les mains de Françoise Le Courtois qui fait la préparation physique et l'entraînement technique des "sport études" en planche à voile. Avec elle on a commencé à construire un programme de préparation physique qui était loin de ce que faisaient ces petits jeunes à côté, mais qui était un programme adapté à mon état à moi, état de femme d'une quarantaine d'année pas très sportive et qui avait besoin d'avoir une condition physique correcte au moment du départ de la traversée de l'Atlantique.
Pour faire ce genre de truc il n'y a pas besoin d'être taillé comme pour partir pour faire les J.O. Il faut tout simplement avoir une condition qui fasse qu'il n'y ait pas d'accident. On a fait une préparation physique qui visait à préparer le fond, l'endurance et aussi à renforcer les muscles et les articulations de manière à éviter que je fasse par exemple une fracture de fatigue ou que j'aie une tendinite tout de suite après la première semaine de navigation.
Ce programme a été suivi avec aussi l'apport de médecins sportifs qui travaillent avec des navigateurs, et aussi avec celui d'un médecin nutritionniste sportif qui a pu me faire un programme, car il fallait aussi absolument que j'aie quelque chose de bien fait pour traverser. C'est donc grâce, je dirai vraiment grâce, à toute cette organisation que j'ai un peu progressé. Effectivement le jour du départ je crois que j'avais une condition physique qui était quand même largement supérieure à ce qu'elle était un an auparavant.
Je continue d'ailleurs en ce moment à me préparer physiquement avec toute cette équipe qui est formidable, je continue à faire les entraînements. Par exemple je vais nager avec les "sport étude" de La Baule ; je suis à côté et j'essaie tant bien que mal de faire à peu près ce que je peux faire alors qu'ils vont trois fois plus vite.
Mais en même temps, à mon petit niveau je me rends compte que je progresse et c'est très intéressant. A quelqu'un qui est complètement en dehors de ces circuits du sport de compétition je dirais que mis entre les mains de gens compétents on peut progresser, s'en rendre compte et en plus prendre carrément du plaisir à se voir progresser au fil de l'entraînement.
Je pense qu'il est dommage que beaucoup de femmes dans la vie quotidienne, dans la vie active, n'aient pas la possibilité de rentrer un peu plus dans la pratique d'un sport avec un soutien qui fait que l'on se voit progresser. Même à un niveau tout à fait amateur on peut trouver beaucoup de plaisir si l'entraînement est encadré par des gens qui sont bien compétents.
Je prends un exemple bête et méchant : dans mon petit village dans le Morbihan, mes amies du coup se sont remises à faire du sport et m'ont dit "Raphaëla on fait du jogging maintenant, à fond la caisse" et je leurs ai dit "oui mais comment vous faites ça ?" "Ben on court tous les jours et tout ça …".
J'ai commencé à leurs expliquer ce que j'avais appris l'année dernière, c'est à dire que l'entraînement n'est pas quelque chose de linéaire et qu'il faut se ménager des moments de récupération …. Elles m'ont écouté avec des grands yeux et elles étaient ravies.
Je pense que des femmes comme ça, installées dans la vie active, il y en a une multitude qui ne demanderait que ça en fait : avoir la possibilité de pratiquer un peu plus et de pratiquer avec des gens compétents, qui expliquent des choses mais simples voire simplissimes.
Cela est vrai aussi avec la musculation ; aller dans une salle de muscu il n'y a rien de plus casse-pieds. Mais si c'est pratiquer la musculation avec un objectif précis de progression, alors on se voit faire des progrès petit à petit, mais en faisant extrêmement attention à ce que l'on fait, c'est autrement plus motivant et ça donne énormément d'énergie ensuite.
J'ai eu la chance de pouvoir accéder à tout ça parce que les gens se sont passionnés pour mon projet, qu'ils se passionnent maintenant pour le projet que je sui sen train de préparer pour l'année prochaine* et que je bénéficie en quelque sorte d'un environnement Jeunesse et Sports de haut niveau. Je ne me considère pas du tout comme une athlète de haut niveau mais néanmoins j'ai eu accès à tout ça et j'estime que c'est formidable. Ce serait bien de pouvoir un peu démocratiser entre guillemets ce genre de possibilités. C'est à peu près ce que j'ai à dire et si vous avez des questions ……
S - Comment les portes se sont-elles entrouvertes ? Tu te présentes en effet comme quelqu'un qui ne pratiquait pas et qui a accédé à un pôle de haut niveau ; c'est le relationnel, le projet ?
RLG -C'est du relationnel et puis c'est effectivement un projet qui motive les gens. Lorsque je suis allé voir le médecin du sport au CHU de Nantes, il m'a indiqué qu'il avait déjà eu l'occasion de préparer des gens un peu cinglés à des projets de ce type. Il a eu envie de me donner des conseils et m'a suggéré d'aller voir untel ou untel.
Il y a aussi des gens qui sont rentrés complètement dans l'histoire. Il y a beaucoup de relationnel.
Cette année, pour préparer le futur projet, j'ai sollicité la ministre de la Jeunesse et des Sports pour avoir un parrainage disons officiel. C'est en train de se décider au niveau des instances à Paris. Précédemment j'avais bénéficié d'aides effectivement, mais de manière totalement informelle, de la part des gens de la Jeunesse et des Sports. Là ça va être un peu formalisé et c'est aussi bien, mais au départ c'est une suite de rencontres avec des gens qui trouvent que c'est sympa de rentrer dans une histoire comme ça.
S – (Patricia Le Goff EPMM) Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet de traversée l'Atlantique ? un défi personnel, un besoin d'être reconnue en tant que femme ?
RLG - C'est vraiment une longue histoire. J'ai une longue histoire avec la planche à voile. En 76 quand j'ai démarré ce sport, pour moi c'était une évidence que c'était mon sport. Il est vrai que j'avais toujours un peu cherché le sport que j'avais envie de pratiquer à un bon niveau et je suis rentrée dans la planche avec passion. Il y avait pour moi des objectifs et je me suis dit que ce serait formidable de pouvoir partir sur un océan en planche à voile. Comme c'était aussi formidable dans ma tête, parce que ça n'existait pas à l'époque, de faire des sauts périlleux en planche à voile ou de gagner.
Il n'y avait malheureusement pas de série olympique à cette époque mais si j'avais pu j'aurais suivi la préparation olympique avec passion. J'ai pratiqué la planche à voile toujours avec cette même passion.
J'ai arrêté la compétition parce que je ne pouvais pas, au niveau professionnel, continuer le sport et le boulot. J'ai arrêté la compétition aussi parce que j'ai un peu saturé d'un certain type de régates qui ne me convenait pas trop.
Mais j'ai quand même toujours eu envie d'aller le plus loin possible dans ce sport-là et pour moi cette traversée est une façon d'exprimer aussi le "jusqu'au bout" de cette passion. Là si je repars en mer en planche à voile c'est parce que je n'ai pas fini mon histoire avec la planche et que je continuerai je pense jusqu'à la fin de mes jours si je peux toujours pratiquer ce sport.
En revanche ce que je peux remarquer quand je vois les "sport étude" qui pratiquent la planche à voile à un niveau d'entraînement que moi je n'avais jamais eu à l'époque, c'est que le nombre de filles à l'entraînement s'est beaucoup réduit entre l'année dernière et cette année.
Je me suis rendue compte que certaines de ces filles avaient quelquefois une saturation. Parce que le rythme est très élevé que ce soit entre la préparation physique, les séances d'entraînement, les régates. Elles partent tous les week-end, elles s'embarquent dans des classements pas possibles et si je me mets à leur place, je pense que ça doit être un peu saturant.
Une chose m'a frappé lorsque j'ai participé à 2 ou 3 régates comme ça, pour m'amuser : j'ai vu ces filles naviguer et je me suis rendu compte qu'elles faisaient un parcours de régate, qu'elles étaient contentes si elles étaient bien classées et après terminé, plus envie d'aller sur l'eau. Et là je me suis dit c'est dommage…. Parce qu'il y avait des conditions d'enfer pour naviguer, et la seule chose que j'avais envie de faire après la régate c'était de sortir parce qu'il y avait du vent des vagues du soleil, il y avait tout ce qu'il fallait. J'ai l'impression que ces jeunes, ces ados, ces filles sont en train de saturer du sport et de perdre un peu le plaisir…Et ce n'est pas évident après de retrouver le désir de compétition.
J'en ai parlé avec mon entraîneur qui m'a expliqué qu'il fallait faire extrêmement attention à ne pas saturer le sportif. Par moment elle sentait que certaines commençaient à accuser le coup psychologiquement et il fallait alors lever le pied à l'entraînement parce que sinon on ne peut plus.
Au total entre les heures de navigation et d'entraînement je pense que l'année dernière je suis allée jusqu'à 8/10 h d'entraînement par semaine, ce qui est énorme pour quelqu'un qui habituellement ne pratique pas du tout de sport. Et je pense que les "sport études", entre la natation, les entraînements planche, les régates, doivent faire pas loin de 16 heures de sport par semaine, tout compris mais c'est déjà beaucoup. Surtout si dans une optique de classement il faut aller à Marseille ou je ne sais pas où …..
S - Est-ce qu'après un exploit comme le vôtre on peut vivre de sa passion ?
RLG - Pas du tout si vous parlez du plan financier parce que je pense que là on est très mal barré. L'année dernière quand j'ai mis de côté mon activité professionnelle, je dirai que, comme j'étais mon propre patron, j'ai pris le risque de prendre une année sabbatique non rémunérée. Cette situation n'a pas perduré très longtemps et par conséquent il faut, quand on en arrive à monter un projet comme ça, pouvoir y inclure aussi la partie financière qui fait que vous allez pouvoir au moins vous payer un peu dessus. Ce n'est pas évident et je pense que l'on passe beaucoup d'énergie à monter le projet et à chercher des sponsors. La partie entraînement physique, technique, la préparation de la planche, pour moi c'était du pur plaisir, de la pure détente à côté de la recherche de sponsors.
Je n'ai pas fait de préparation mentale pour partir sur l'Atlantique mais je pense que le mental je me le suis forgé par toutes ces déceptions, ces rendez-vous, ces machins, en allant défendre ce projet et le porter à bout de bras. Ca vous forge un certain mental que j'ai retrouvé après, quand j'étais en pleine mer, toute seule, dans les moments de découragement. Et la pensée aussi de tout ce chemin parcouru, de ce parcours du combattant, ne serait-ce que prendre le départ. Pour nous, pour moi, arriver à prendre le départ de la traversée, c'était déjà une récompense suprême.
A - Cette traversée avait déjà été faite au auparavant. Et est-ce que dans la recherche de sponsors c'est un handicap d'être une femme par rapport à un homme qui avait déjà fait cette traversée Avait-il récupéré des sponsors plus facilement que vous ?
RLG - Oui Stéphane Peyron dont j'avais la planche avait déjà fait cette traversée. En ce qui concerne les sponsors, le plus gros handicap pour moi c'est que je n'avais rien je n'avais pas de passé. Parce qu'avoir fait des régates dans les dans les années 80, c'est Mathusalem.
Par contre le fait que je sois une femme ça intéressait. Une histoire de femme justement ça intéresse bien, c'est dans l'air du temps, c'est assez porteur. Je pense qu'à égalité un sponsor potentiel va écouter d'une manière plus ouverte l'histoire d'une femme qui se lance dans un truc car il sait qu'il va y avoir déjà un impact médiatique relativement important voir plus parce que c'est un exploit féminin. Oui je pense que c'est vraiment un plus en ce moment.
A - Aucune femme n'avait tenté avant vous ?
RLG - Non
A - Il y a des raisons particulières ?
RLG - Je ne sais pas. Plusieurs femmes avaient sollicité Stéphane Peyron pour récupérer sa planche et puis ont en fait abandonné assez vite après. Peut-être parce que reprises par la vie. Par exemple une fille qui travaille à la fédé, une très bonne planchiste, avait voulu faire ça mais elle a sans doute été reprise par ses activités professionnelles. Je n'ai pas d'explication Mais je pense qu'il y a relativement peu de femmes qui pratiquent la planche à voile tout simplement.
S- Oui sur les nouvelles planches de pratiques de fun il n'y a pas de filles.
RLG – C'est vrai et en série olympique il y a un certain nombre de filles qui s'entraînent mais il y en a quand même beaucoup moins que d'hommes
Je pense que la planche à voile est vécue, à tort, comme un sport peu accessible aux femmes.
Elles n'osent pas s'y lancer ; et ça c'est aussi peut-être le problème de la communication du sport en lui-même. Je ne suis pas forcément d'accord avec les gens de la planche à voile qui ont présenté assez vite après le début de la planche à voile ce sport comme un sport extrême où l'on voit les gens faire des loopings dans les vagues. C'est sur que quand on voit ça les gens moyens se disent "je ne peux pas faire ça".
Mais j'ai un contre-exemple, celui de ma mère qui avait 54 ans quand elle a démarré la planche à voile. Après avoir eu 11 enfants, ce qui est quand même une vraie performance, elle y a pris beaucoup de plaisir
S - Le phénomène de la planche c'est qu'avant, dans les années 75/80, c'était un "sport loisir". La planche concernait monsieur tout le monde ; tout le monde avait la planche sur sa voiture ; très vite les industries ou les industriels ont compris le phénomène et ont fait des planches spécifiques qui étaient beaucoup plus techniques et beaucoup moins accessibles à monsieur et à madame tout le monde ; il ne reste plus de planche polyvalente sur lesquelles tout le monde se baladait. Il y avait une pratique. Maintenant on voit des spécialistes avec des planches techniques pour le saut, pour les vagues.
RLG - On revient un peut-être un peu de ça. L'industrie fait un petit peu machine arrière ; elle tente de relooker le sport et de le rendre plus accessible. Mais c'est vrai que c'est dommage. Pour moi c'est important de montrer que la planche à voile est accessible. On a dit que la planche avec laquelle je suis partie n'était pas une planche. Mais c'est quoi la planche à voile ? C'est n'importe quel type de flotteur avec un gréement articulé et c'est comme ça qu'on navigue.
S - Une question qui est peut-être un peu indiscrète : on examinait ce matin le sport féminin et on voyait que jusqu'à 13 /14 ans ça fonctionne. Après ça se complique et on constate qu'arrivé à l'âge de rentré dans la vie active, avec la vie familiale les enfants etc. c'est le moment où ça s'arrête. Mais les hommes peuvent éventuellement continuer en laissant une partie des charges à la partenaire
RLG - Oui c'est souvent le cas. Moi je ne suis pas célibataire. Je vis avec quelqu'un mais j'ai la chance que cette personne suive à fond ma passion. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
C'est dommage car je pense que c'est un peu la même chose pour une fille quand elle veut faire carrière entre guillemets. Le problème de la femme c'est qu'elle doit faire des choix, qu'elle est obligée de faire un choix alors que l'homme, je pense, se retrouve sans avoir à se poser de questions et fait sa carrière. Peut-être que çà ça peut évoluer, peut-être aussi que c'est une question personnelle de choix de vie. C'est aussi peut-être la question de savoir si on ne peut pas aménager le retour au sport pour les femmes qui sont toujours dans la vie active, qui ont des enfants.
C'est la question que je posai aux amies autour de moi. Ce sont des femmes entre 25 et 35 ans qui ont des enfants, qui commencent à s'organiser pour la garde de leurs enfants et qui ont envie de recommencer à pratiquer le sport. C'est très compliqué de retrouver la pratique d'un sport ; quels sont les moyens pour trouver par exemple une piscine, pour trouver un entraîneur ? Ca n'est pas facile du tout.
S - Vous disiez que ce n'est pas toujours évident de s'y mettre très tard et c'est vrai. Moi qui n'avais jamais fait de sport avant, j'ai commencé à 38 ans avec les enfants, en faisant le même sport que mes garçons ; c'est du hockey sur glace. J'ai 57 ans et je continue. Il y a des filles mais c'est très dur pour les filles. J'ai eu la chance de pouvoir le faire et de continuer mais ça n'est pas évident parce que les autres filles sont très jeunes, enfin très jeunes Elles ont 15 ans. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'entraîneur et qu'on est obligé de trouver un ancien joueur. C'est très difficile mais je ne pense pas à faire un truc comme vous.
RLG - Oui mais je ne parle pas de ça, mais du simple fait de pouvoir revenir dans le sport qui n'est pas facile.
S - Lorsqu'il y a concurrence entre une équipe masculine et une équipe féminine dans un club c'est souvent difficile de lier les deux. Les clubs donnent souvent priorité aux hommes, aux équipes de garçons. C'est souvent difficile pour les filles qui se sentent abandonnées dans le club parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens de réussite ou d'accès à la pratique.
S - Mais un entraîneur ne peut-il pas entraîner filles ? Il n'entraîne que les garçons ? Je m'occupe d'une école de hockey, je suis sur la glace avec les petits. Mais ils ne veulent pas prendre les filles à l'école de hockey. Tous les ans j'ai deux ou trois demandes pour des petites filles de 6 à 8 ans qui voudraient bien faire partie de l'équipe de hockey et on refuse catégoriquement. C'est dommage car le championnat est mixte jusqu'à benjamins mais ils ne veulent pas. Et il y a aussi les heures de glace : les petits et les tout petits ont plus d'heures que les filles ; on a une heure par semaine, 1H 30 quand l'équipe est en déplacement. Il y a une explication ?
S - Je pense que les filles sont acceptées parce qu'il n'y a pas trop le choix mais si on pouvait s'en passer on le ferait.
S (gc) - La terreur des clubs dans certains sports, dans certaines disciplines où il y a peu de pratiquants en France, par exemple en hockey sur glace où il y a peu de pratiquants féminins, c'est que très vite une équipe va monter à un niveau national et elle va coûter cher en déplacements. Il y a plein de sports comme ça ou les clubs disent "attention si on monte une équipe féminine on va se retrouver en championnat national très vite et on va aller un jour à Mont-de-Marsan ou à Montpellier et ça va coûter une fortune au club"
S - Oui mais pourquoi on accepte-t-on ça des hommes ?
S - Ca reprend un peu ce que l'on disait ce matin il y a des freins. Tout le monde freine des quatre fers.
A - Vous voulez peut-être compléter par tout ce qui est préparation ?
X - En ce qui me concerne il s'agissait plutôt des aspects suivi logistique, organisation et suivi psychologique de haut niveau. J'étais au PC course évidemment au moment de la traversée de Raphaëla. Nous étions deux personnes à occuper de ce poste-là, tous les jours en fait. C'est donc une expérience vécue de la terre, en plein centre ville puisqu'on avait été accueilli par la Maison de la Bretagne à Paris. Un lieu avait été aménagé pour pouvoir faire ce PC course durant la traversée.
Ce qui était intéressant dans cette expérience qui a duré deux mois, c'est à dire à peu près deux fois plus longtemps que ce qui était prévu, c'est qu'on a pu se rendre compte, en se trouvant à terre, de la façon dont les conditions de navigation étaient vécues par quelqu'un qui témoignait de ce qui s'était passé dans la journée et comment il envisageait la journée suivante.
On a aussi vite compris qu'il était important pour nous de pouvoir participer complètement à cette aventure pour pouvoir soutenir le moral parfois chancelant de Raphaëla, surtout quand les conditions de mer qui ont été particulièrement calmes le premier mois de traversée l'ont obligé à se mettre à réfléchir à des tas de choses alors que normalement elle aurait dû avancer, avancer. C'est vrai que de ce côté-là on a eu un rôle qui a dépassé le cadre du PC course et qui consistait tout simplement à faire le point sur la journée et à transmettre à l'extérieur et aux gens qui venaient ici, la position de Raphaëla, ce qu'elle avait fait dans les jours précédents etc. …
On a dû en fait intervenir auprès de Raphaëla pour pouvoir l'aider à avancer, même si elle savait qu'elle n'établirait pas le record de la traversée à ces moments-là. Et en même temps il fallait aussi gérer toute une relation avec les personnes extérieures et en particulier sa famille, gérer les interrogations, les questions et les inquiétudes sur le déroulement de cette traversée qui ne s'était pas du tout orientée vers ce qui était prévu initialement. Il a fallu s'adapter. C'était assez riche et intéressant et un peu fatigant. Au final ça c'est bien terminé, c'est un bon souvenir.
A - Est-ce que la logistique est primordiale ?
X - Je pense que oui. Une traversée comme ça, même si c'est un événement qui est fait par une personne à un moment donné, c'est en fait le résultat d'un travail d'équipe sur la durée. La mise en œuvre de la traversée de l'Atlantique a nécessité une année de préparation à divers niveaux : préparation sportive de Raphaëla, préparation de la planche, préparation de nouvelles demandes d'appui, de la communication à l'extérieur, ça n'est pas rien. Et bien sur tous les petits soucis quotidiens, les imprévus et les moments ou il faut prendre des décisions rapides et dont on sait qu'elles seront irréversibles. Il ne faut pas perdre la tête.
S - Est-ce qu'on vit la même chose que la personne qui est en mer ? Est-ce que dans cet échange, il y a une telle complicité, une telle symbiose que vous viviez la même chose ?
X - Il ne faut quand même peut être pas aller jusque là mais le problème c'est peut-être de ne pas manifester de symbiose. Quand on a une personne en face ou plutôt en mer, que cette personne est inquiète du fait des conditions météo qui ne sont pas du tout celles attendues, celles qui avaient d'ailleurs été préparées par une amie et qui avaient permis de déterminer la date à laquelle le départ pouvait se faire dans de bonnes conditions, il ne s'agit pas de se mettre à pleurer avec en disant que oui c'est terrible… Donc en fait on a joué un peu sur des actions/réactions. Quand on a quelqu'un en face de soi qui commence à manifester de grosses inquiétudes, charge à l'équipe à terre dont j'étais un peu la voix, mais il y avait là aussi derrière tout un tas de gens, d'alimenter la conversation et de redonner de la confiance et de l'espoir même si parfois on se demandait ce qui allait se passer le lendemain.
A - Et ce staff technique était exclusivement féminin ?
X - Il y avait deux ou trois moteurs dont l'architecte qui a fait toute la mise au point technique sur la planche. L'équipe était mixte, je pense qu'on peut le dire, puisque l'entraîneur sportif était une femme, le directeur technique un homme, au PC course c'était moi…..Mais c'est aussi le hasard qui a voulu ça. On n'a pas pris de décision à ce niveau, ce n'était pas un objectif d'avoir une équipe uniquement féminine.
S - Je suis venue dans cette salle pour l'inégalité d'accès aux pratiques sportives selon le niveau social, pour l'accès aux activités traditionnellement masculines, pour les normes de la féminité dans l'histoire et l'abandon des pratiques sportives par les filles à partir de 13 ans. Par rapport à cette dame qui, à 38 ans, a pu reprendre une activité sportive, moi j'en avais 28. Je suis d'une famille ouvrière très modeste et durant toute mon enfance je rêvai de faire de la gymnastique ou de la danse. Et comme on me l'a toujours refusé dès lors qu'il fallait payer quoique ce soit comme des cours, des chaussons ou des tenues, je me suis dit que quand je serai adulte je serai entraîneur, je serai professeur. J'ai obtenu les diplômes et décidé de travailler dans le monde associatif, ce que j'ai fait, puis de créer une association.
La création d'une association est assez simple mais ensuite cela se complique.
Pour la demande de subvention vous devez remplir un dossier puis aller frapper à la porte du Conseil Général. Vous entrez, on vous accueille derrière une vitre et déjà vous vous trouvez dans le dessin animé "Les douze travaux d'Astérix". Vous trouvez l'escalier B, la porte 24 au troisième étage et vous attendez dans le couloir assis sur une chaise ; c'est pire que dans la salle d'attente du médecin et.
Enfin la secrétaire du député vous fait entrer et :
-" euh ! Oui vous avez un projet …?"
Et quand vous avez rapidement et avec beaucoup de motivation exposé votre projet :
- "euh ! Oui vous avez un budget… ?"
Et quand enfin vous avez le papier que vous devez remplir pour avoir cette subvention dont on vous a tant parlé, et bien quand vous l'avez rendu, que trois mois plus tard vous n'avez pas de réponse et que vous retournez voir ce qui se passe, on vous dit que vous n'avez pas mis la croix dans la bonne case ou bien vous avez rendu votre dossier avec un jour de retard parce que la réunion a été avancée et patati et patata, chose dont bien sur on ne vous avait rien dit du tout.
En terme d'inégalités sociales là aussi c'est très très difficile, et j'admire les adultes hommes ou femmes, mais particulièrement les femmes, je les admire et je les encourage, qui veulent s'imposer dans la pratique sportive de leur choix.
C'est très difficile car on n'accepte pas encore les filles dans telle ou telle pratique sportive parce qu'on sait très bien qu'on va avoir beaucoup plus de mal à les garder ; mais quelquefois des parents, de la famille ou d'anciens enseignants viennent vers les enfants et d'autres espèrent et poussent ; c'est très difficile mais en tout cas il faut y aller.
Cette dame de trente huit ans qui s'est remise à faire du sport eh bien chapeau ! Mais elle rencontre des difficultés et je suis sure qu'elle n'a pas toujours eu connaissance des papiers à remplir pour être dans les temps ni de tout ce qu'il fallait non plus. Ce sont des obstacles incroyables qui sont placés au fur et à mesure de l'avancée dans le sport ou dans l'association. Les femmes ne son pas informées au départ de la même manière que les hommes ; et la difficulté pour mettre en place un club où il n'y a que des filles, ce qui a été mon cas, est réelle.
Les mentalités retardataires sont beaucoup plus vivantes encore en 2001 qu'on ne le croit. Quand vous arrivez dans une petite commune, les institutions traditionnelles ne sont pas plus évoluées que dans les films de Don Camillo. Il y a le maire, le curé, l'école, la kermesse et le club de foot. En dehors de ça si vous allez dire que vous allez faire quelque chose de complètement nouveau ça va être très très très difficile et si vous êtes une femme c'est pire.
Et puis il y a l'abandon des filles dès l'âge de 13 ans, un peu avant même, elles abandonnent et on les abandonne.
A - Peut-être que les gens peuvent parler, Madame, des difficultés rencontrées pour créer une association ?
S - Je pense qu'il y a une chose que l'on voit pas mal dans le monde sportif, c'est qu'arrivé à un certain âge, si on continue à pratiquer dans un club, on commence à rencontrer des gens qui influent, qui savent comment monter une association. Et justement les filles ont tendance à arrêter un petit peu tôt ce qui fait qu'elles ne font pas ces rencontres. Et généralement ça aide pas mal d'avoir ces connaissances-là pour monter une association.
Les jeunes filles arrêtent souvent le sport vers 15/18 ans alors que les garçons continuent et c'est là je crois que l'on peut créer une association.
S - J'aimerais savoir dans quelle proportion les filles de 13/14 ans arrêtent par rapport aux garçons ; il me semble que les adolescents arrêtent vers 14/15 ans parce qu'ils ont autre chose à faire que d'aller à l'entraînement; ça me semble lié au sexe.
A - Oui bien sur ; selon les gens qui témoigne il est évident qu'il y a un déchet important, filles et garçons avec plus de filles peut-être.
KQ - Entre 20 et25 ans il y a le couple qui s'installe, on a envie d'autre chose, c'est la nature. Un homme peut continuer parce qu'il n'y a pas ce coté physique. Lui c'est de 18 à 25 ans qu'il commence à prendre de l'ampleur dans son sport et à s'investir et à se sentir vraiment sportif et avoir des ambitions. A cet âge-là la femme s'arrête, met fin à sa carrière parce qu'elle a d'autres ambitions ; je pense que ce matin le débat avec les sociologues était vraiment très bien.
S - J'étais président d'une association de 500 adhérents garçons, filles, jeunes, adultes ; il y avait un amalgame et je me suis aperçu durant ces années de présidence qu'il y avait effectivement une évaporation des jeunes vers 14/15/16 ans. Mais le phénomène que l'on rencontrait chez les filles c'était que lorsqu'elles avaient quitté elles ne revenaient plus. Chez les gars on s'apercevait que vers 19/20 ans il y avait un retour, pas pour faire la même chose mais pour autre chose Donc il y avait quand même à ce moment là plus de facilité pour faire continuité dans l'encadrement que chez les filles qui avaient arrêté vers 15/16 ans parce qu'elles n'avaient plus le feu sacré. Comme le disait l'intervenante précédente, il y a le couple qui s'installe et je vais peut être faire crier mais arrivé à un certain âge on met un peu le sport de coté, on préfère la vie de famille et on se réfugie dans cet esprit de famille ce qui est une fausse sortie si l'on peut dire.
S - Cela dépend des sports ; dans la GRS par exemple les filles commencent tôt mais elles arrivent à un haut niveau assez tôt aussi de par leurs capacités physiques ; elles arrêtent plus tôt. Et je suis d'autant plus heureuse quand je vois d'anciennes gymnastes, qu'elles aient fait du haut niveau ou pas, être encore à 30 ans dans une salle pour pratiquer ou encadrer plutôt que de se barrer à 18 ans.
S - Dans le milieu que je fréquente je n'ai jamais vu des gens partir parce qu'ils n'étaient pas encadrés réellement mais plutôt dégoûtés par le fait qu'on les ait trop exploités.
A - Le mot n'est peut-être pas adéquat ; qu'est ce que vous voulez dire par exploitation ? Exploitation bénévole, des gens ?
S - Non exploitation de l'athlète en club, de la jeune fille en elle-même à qui on a expliqué que trente heures par semaine à 13 ans c'est très bien il fallait ça sinon elle n'aurait pas de titre etc.…. Elles disparaissent au bout de deux ou trois médailles et elles ne veulent surtout plus entendre parler de tout ça.
S - Oui mais c'est l'exigence de l'activité, c'est un problème interne à une fédération qui met des critères. Si vous ne recrutez pas des filles qui font moins d'1m60 qui pèsent tant et qui n'ont pas de poitrine, vous n'obtiendrez pas de résultats ; c'est vrai qu'on ne peut pas pratiquer la GRS à 25 ans sous une forme compétitive. C'est l'exigence de l'activité.
S - Moi j'ai évolué dans un milieu essentiellement masculin, disons à 98%. J'étais arbitre national de basket-ball ; j'ai fait mon petit bout de chemin dans ce milieu-là et c'est vrai que c'est un milieu assez macho. Dans le jeu les filles évoluent à leur niveau et les garçons évoluent séparément à leur niveau puisque les qualités physiques et le style de jeu sont différents.
Mais dans le monde de l'arbitrage on évolue au même niveau ; ce sont des filles et des gars qui arbitrent. Par rapport à ça, pour accéder au haut niveau vous arrivez à un stage où il y a 1OO personnes et où vous êtes la seule fille. Là on vous dit "tu seras jugée de la même façon que les autres sur tes qualités physiques, tes qualités de jeu, tes connaissances physiques, tes connaissances basket, tes connaissances culturelles".
Vous arrivez ensuite dans les locaux et on vous dit "tu t'installes" et vous vous dites "on n'est pas sur la même planète". Dans le dortoir il n'y a pas une porte, il n'y pas un rideau. Il y a quinze douches et on vous dit "tu prends ta douche quand tu as le temps". Je veux bien mais la porte ne ferme pas et ces messieurs…
Je pense qu'il faut avoir une sacré personnalité pour évoluer dans un monde arbitral surtout dans les sports collectifs et ça qu'on soit homme ou femme. L'évolution est telle que l'on a du mal, même au niveau masculin, à trouver des arbitres
A - Avez-vous fait observation de ces conditions d'accueil auprès des autorités compétentes ? Dans ce cas est-ce que vous avez obtenu une réponse ? Je peux vous dire que n'importe quelle colonie de vacance serait fermée dans ces conditions et que n'importe quelle entreprise privée sur le territoire français aurait injonction de se mettre aux normes ou de fermer boutique
Oui, j'ai écrit à la fédération, car c'est un stage fédéral, au président en le remerciant des locaux et de l'accueil mais le problème c'est que l'on et vraiment très peu de femmes à évoluer à ce niveau-là. Il n'y a qu'une femme qui arbitre aujourd'hui en pro A.
Quand vous allez arbitrer un match de mecs, vous entrez dans le vestiaire sachant que votre collègue y est déjà et que vous êtes la seule femme dans l'Ouest à arbitrer à ce niveau-là. Vous savez donc pertinemment que vous allez trouver un homme et non pas une femme. On rentre, on ne fait plus attention, on se connaît tellement bien les uns les autres.
Mais c'est vrai qu'en stage c'est gênant ; vous arrivez sur ce genre de stage où ils sont tous là, ils sont tous plus âgés, et là vraiment … Ce jour-là, honnêtement, si j'avais eu ma voiture et mon permis, je pense que j'aurais fait demi-tour. Il y a aussi le fait que vous soyez la seule fille à jouer au basket avec les gars et ce n'est pas du tout la même chose, on ne joue pas dans la même cour.
Mais quand bien même j'ai vécu une superbe expérience, ça c'est très bien passé, j'ai réussi à faire ma place. Ça n'a pas été plus difficile que pour les gars, j'ai été jugé de la même façon, j'ai réussi à sortir du trou et j'ai vécu une très grande expérience
Madame De Chavanne disait ce matin que c'est nous les femmes qui disons non, parce qu'on fait le choix de la vie de famille, ce qui est naturel. Mais je suis convaincue que nous les femmes avons une part de responsabilité dans le fait de ne pas avoir accès à certaines pratiques. On est tous des êtres humains, hommes, femmes, on a tous deux bras, deux jambes, on a une tête, il faut de la volonté, taper du poing sur la table ; il faut arrêter de se dire "j'ai mal vécu". Je ne suis pas du tout d'accord lorsque j'entends dire que tout est fermé aux femmes ; c'est faux.
S - Et il y a d'autres femmes maintenant ?
Non mais pourtant à la fédé ils appuient ; les conditions d'accueil sont meilleures maintenant, les locaux sont plus adaptés. Mais aujourd'hui il n'y a pas plus de filles ; c'est vrai pour le basket et il n'y a pas non plus beaucoup de filles dans le foot, dans le volley ; dans le hand je ne sais pas mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup ; mais c'est un rôle ingrat.
Mais si dans le monde du basket il y a peu de filles qui montent pour arbitrer en milieu semi pro ou pro c'est aussi parce que le milieu est très très macho. Et les gens qui encadrent, entre parenthèse on n'est pas pro du tout, on a tous des carrières à coté et ça demande du temps et des disponibilités, ces messieurs donc qui nous encadrent pour devenir arbitres semi pro c'est leurs places qu'on prend en France. Ils ne se sont pas encore mis dans la tête que c'était des filles qui allaient prendre leurs places. Ça n'est pas encore du tout dans les mœurs que ce soient des femmes qui viennent arbitrer les mecs en pro ; non pas du tout ; mais c'est valable dans toutes les instances, partout.
A - Est ce que les équipes d'hommes, lorsqu'ils sont dirigés par des femmes, changent d'attitude sur l'arbitrage lui-même ?
Oui ; il est plus facile d'arbitrer des équipes masculines en tant que femme que des équipes féminines. C'est la galère d'arbitrer un match de filles, il faut le dire ; ça n'est pas franc, ça vient chipoter.
Mais un gars ça a le respect, ça dit franchement. Quand il y a des fautes et c'est courant, ils ne discutent pas "faute - pas faute". Quand vous faites une erreur, ils vous disent "non" ou "OK c'est pour moi". Ils sont d'accord, ils vous respectent. Un gars il respectera plus une fille. Si un arbitre masculin commence à le titiller un peu, ce que l'on fait aussi, il y a en plus ce coté physique qui va arriver et le poing va partir plus vite. Tandis qu'avec une fille déjà il se retient, il a plus de recul. Mais souvent avant les matchs sur le terrain, 20 minutes avant la rencontre, les gars te voient arriver avec un sourire jusque là et ils se disent "oh ! merde on est où là…".
Mais par contre le premier coup de sifflet c'est le plus important de tout le match. Ce premier coup de sifflet ; il faut qu'il soit nickel, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Le premier coup de sifflet fait le match. Si le premier coup de sifflet est clair, net et que les joueurs sont d'accord, là il n'y aura pas de problème, ils n'iront pas chercher à te faire de souci.
Si le premier coup de sifflet est faux et qu'il y a une grosse bourde derrière c'est clair qu'alors là tu n'es qu'une fille et il y a des remarques pas imaginables tant dans les gradins que sur le terrain.
Au début il faut se dire "de toute façon "c'est moi qui suis là et ce sera comme ça". Je pense que ça marche mieux pour une fille qui arrive dans cette optique-là. Il faut être fort dans la tête et si on arrive à s'imposer directement les rapports seront plus faciles entre une fille et un garçon sur le terrain que de garçon à garçon.
Claude Jadé va nous faire un petit historique sur l'accès aux pratiques traditionnellement masculines
Claude Jadé - Je me suis occupé de rugby durant quelques années et d'une équipe de filles peut être pas très connue ce qui est dommage. Mais ça fait 15 ans que ce rugby se pratique dans un club étudiant qui s'appelle le BUC.
La caractéristique principale est, je crois, que depuis la création jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des entraîneurs masculins Ca me semble très important parce que forcément le modèle véhiculé c'est le modèle du rugby masculin. Quand on regarde un match de rugby on a toujours un peu derrière les images du rugby masculin. On est donc tenté de faire une comparaison avec le rugby masculin alors que le rugby féminin est totalement spécifique comme les autres sports masculins pratiqués par les femmes : le basket féminin n'est pas un basket masculin le hand-ball féminin ce n'est pas le hand-ball masculin. Il y a le même règlement, le même nombre de joueurs, les règles sont les mêmes c'est vrai mais ce qui est véhiculé, ce qui est donné à voir ce n'est pas la même chose. Donc je ne crois pas que la comparaison soit une bonne méthode pour analyser, apprécier ou juger du rugby féminin en tout cas. Je ne sais pas si c'est vrai du hand-ball, je ne sais pas si c'est vrai du basket mais il me semble qu'il y a une spécificité là aussi.
Au niveau de l'historique, en 85 il y a eu un match de rugby, brestoises contre quimpéroises, qui s'est déroulé à Quimper et puis pendant deux ans, plus rien.
En 87 un groupe de fille a décidé de faire une équipe et de chercher quelqu'un pour les encadrer. Et toutes ces filles, puisqu'on parle d'accès aux pratiques, toutes ces filles avaient un lien affectif soit avec des joueurs soit avec des dirigeants soit avec des proches du club. C 'est à dire que toutes étaient déjà dans la mouvance du rugby. Et quand on vit dans cette mouvance-là on voit bien quels sont les statuts féminins. Il y avait les fiancées, les supportrices, les promeneuses de landaus le long de la touche qui s'occupaient de leurs enfants et de ceux des autres, celles qui participaient à la fête le soir… Il y avait donc différents statuts de la femme par rapport au rugby.
Et puis elles ont voulu changer de statut ; pourquoi l'ont-elles voulu ? Je ne suis pas dans leur tête mais en discutant avec les premières, celles qui ont créé le club, il semblerait qu'elles aient voulu en quelque sorte défier, relever une sorte de défi : "ce sport-là il n'y a pas de raison pour qu'on ne le fasse pas même s'il n'y a que des garçons qui y jouent".
Il y avait aussi une espèce de recherche de connaissance et de compréhension d'une activité qui manifestement était passionnante pour les gens qu'elles côtoyaient. Je crois aussi qu'elles avaient envie d'être reconnues autrement au sein du club et d'avoir un rôle sans doute différent.
Une fois qu'on a décidé de créer le club c'est là que les problèmes commencent ; oui parce que c'est bien sympathique de dire on est une dizaine, on va s'entraîner ensemble. C'est bien mais au-delà on s'est heurté à ce que disait madame, au manque de terrains etc.
On a eu plein de problèmes et puis ce n'est pas un sport que beaucoup de gens du sexe féminin pratiquent.
Les premières difficultés touchent je crois
à la spécificité de l'activité c'est à dire que c'est un grand terrain, que
c'est du gazon et que l'on habite en Bretagne. Tomber là-dedans ça pose
problème ; tomber faire tomber sur un terrain en gazon l'hiver, aussi bête que
ça semble, ça pose problème pour les filles ; pour les garçons aussi au
début mais ça passe plus vite. Pour certaines filles c'est un blocage complet
qui les arrête et puis d'autre fois ça se passe très vite.
Spécifique encore, les contacts. Les contacts
pas seulement avec les adversaires mais contacts entre partenaires, contacts qui
sont différents des chocs et ça aussi c'est assez difficile à vivre quand on
n'a pas déjà des expériences avec ses frères etc.
Une autre difficulté spécifique au rugby, c'est de jouer au pied. C'est très difficile pour une fille de jouer avec ses pieds. Courir, prendre une balle dans les mains et taper c'est difficile.
S - C'est difficile pour tout le monde ; elles avaient quel âge ? 18 ans ? si elles avaient commencé à 5 ans, elles auraient tapé aussi bien que les garçons.
C'est vrai mais ce n'était pas le cas et toujours est-il que ça a posé un problème. Je crois que c'est vrai aussi pour les filles qui jouent au hand-ball, si elles commencent tard, c'est difficile, quand elles commencent petites c'est facile. Quand on arrive à un certain âge c'est plus difficile et nous avons donc été confrontés à ce problème.
Un autre problème a été de trouver des adversaires parce que pour la Bretagne … On a donc cherché où il pouvait y en avoir d'autres et on n'en a pas trouvé. Les premiers matchs ont donc été des matchs contre les garçons et ce qui a sans doute aussi aggravé nos problèmes parce qu'à ce moment-là on se trouve dans le système mixte. Et on s'est aperçu que pour faire jouer des filles avec ou contre les garçons, il faut sélectionner les garçons. Parce que les garçons ne sont pas tous aptes à jouer à un sport de contact et de combat avec ou contre des filles. Ca veut dire que les problèmes de la mixité ce ne sont pas des problèmes qui sont liés à la féminité mais qu'ils sont beaucoup plus liés aux garçons. Arriver à comprendre le jeu des filles c'était difficile, arriver à avoir des contacts avec des filles c'était difficile, se faire mettre sur les fesses par une fille parce qu'elle est bien placée ça peut faire réagir et il est difficile de se contrôler.
On a donc eu des tas de problèmes mais qui sont liés beaucoup plus à la mixité qu'au fait que ce soit des filles qui jouent. Si elles avaient joué ensemble je crois qu'il n'y aurait pas eu ces problèmes mais il n'y avait pas d'adversaires du moins jusqu'en 91 si je me souviens bien. En 91 on a commencé à descendre vers le sud-ouest et on est allé joue à La Test et dans ces coins-là. C'était du rugby féminin et on rencontrait des équipes uniquement féminines.
Ensuite s'est posée la question de savoir si l'on continuait ou non, mais l'envie était très forte et on s'est engagé en championnat. Pour arriver à s'inscrire en championnat au début on a été obligé de trouver des subterfuges. Il y a eu une entente avec Pontchâteau, puis il y a eu uniquement des brestoises, ensuite il y a eu une entente avec des rennaises l'année dernière ou il y a deux ans. Il y a donc des difficultés à avoir des adversaires et ça enchaîne tout le problème des finances etc.… Il y a même des équipes qui refusent de venir jusqu'à Brest parce que c'est trop loin ; vous savez que Brest n'est pas très au sud.
Voilà donc en gros les types de problèmes rencontrés.
Mais je crois qu'il y en a un autre : c'est qu'un match de rugby c'est un spectacle et que quand ce sont des filles qui jouent, qui le donnent, il y a des choses un peu différentes qui se passent. Le rugby féminin a ceci de particulier que beaucoup de gens qui sont sur la touche et autour connaissent les joueuses mais qu'il y a aussi ce que j'appelle les spectateurs non avertis dont les commentaires, c'est vrai qu'ils évoluent, sont vraiment placés sous le signe de l'esthétique et du sexuel. Mais ces commentaires évoluent quand même en direction du jeu, de la qualité du jeu et de la production.
Beaucoup de gens ont été très tôt étonnés de voir se faire ce jeu qui n'est pas tout à fait le jeu des hommes. Mais il est vrai qu'il y a une éducation des spectateurs à faire et les spectateurs c'est quand même nous tous car je pense que n'importe qui ne connaissant pas ce rugby aurait les mêmes réactions. Je dirai que la place des filles dans le rugby n'est pas encore acquise.
Par contre les filles voulaient avoir un rôle différent dans le club or à ma connaissance, à part une des joueuses qui s'est orientée vers l'encadrement des petits, je crois qu'aucune autre n'a pris le chemin de la technique ou celui menant à être entraîneur féminin. Il faudra beaucoup de temps. En revanche elles se sont chargées des rôles d'animation et des rôles d'organisation matérielle au niveau de l'ensemble du club ; ça allait aussi bien du coup de main à donner pour l'école de rugby, que déplacer les petits ou s'occuper des préparations des fêtes etc.…
Je voudrai dire un mot aussi de la parité puisque c'est un club où il y avait des sections "hommes" et "femmes", où les hommes recevaient des subventions municipales et les filles aussi parce qu'elles jouaient à haut niveau c'est à dire en nationale. Elles recevaient donc des subventions liées au haut niveau. Je ne suis pas sur que les subventions accordées aux filles aient été entièrement utilisées par celles-ci ; je ne suis pas sur du tout que, au passage, il n'y ait pas eu une évaporation des crédits alloués aux filles, pour l'ensemble du club quand même. Obtenir un jeu de maillots pour l'équipe féminine ça a été compliqué, malgré les subventions ; avoir des bons ballons, c'était compliqué aussi. Il y avait des vieux maillots mais il y avait aussi des vieux ballons.
Et pourquoi avoir des maillots neufs ? Parce que de toute façon on se trouvait dans un sport, le rugby où, comment dire, le vêtement ne met pas les gens en valeur ; Un maillot de rugby, un short, des grandes chaussettes au bout de dix minutes c'est plein de boue, les cheveux … On ne peut pas dire des joueuses qui sont sur le terrain qu'elles sont à la mode. Avant et après oui mais sur le terrain non, et donc va pour les vieux maillots.
Et il n'y a pas eu un poids de la fédération comme dans certaines fédérations, celle de volley en particulier, pour que le vêtement soit adapté à certains canons féminins.
S - Les horaires d'attribution de la pelouse pour les entraînements ont-ils posé problème ?
CJ - Non là il n'y a pas eu de problème. Au début on était sur un terrain et les garçons ailleurs et on s'entraînait le samedi après-midi parce que personnes n'avait besoin des installations ce jour-là. C'était au tout début donc. Et puis très vite les horaires ont été doublés avec les garçons de telle façon qu'il y ait une partie d'entraînement commune pour pouvoir faire travailler les filles et les garçons en même temps. Les filles quittaient le terrain suffisamment tôt pour pouvoir prendre leur douche et avoir leur vestiaire avant que les garçons n'arrivent. Il y a eu quelques petits problèmes quand même c'est vrai.
S - Je voudrai revenir sur ce que vous avez dit par rapport au sport spectacle parce qu'en fait le rugby est un très vieux sport qui ne s'est développé qu'avec des hommes On assiste actuellement à l'arrivée de femmes qui veulent pratiquer mais le problème c'est que le sport n'est pas en fait adapté aux femmes. Ce que je veux dire c'est que physiquement il faut tenir un match de rugby. En fait il faudrait refaire le rugby par rapport aux femmes.
CJ - Tu m'enlèves ma conclusion et j'en suis ravi.
S - La plupart des sports qui marchent à la télé par exemple le basket ou le hand-ball, on l'a vu pour la finale de la coupe du monde pour le hand, sont des sports qui sont très bien et très facilement adaptés à la pratique féminine. Il n'y a pas eu besoin de changements énormes, donc ça marche.
CJ - En fait ça n'a pas été changé du tout.
S – Si l'on prend le tennis, je me souviens très bien de l'époque où tout le monde disait que c'était une purge de regarder les matchs quand c'était les femmes qui jouaient. Maintenant le tennis féminin est devenu presque plus intéressant à regarder parce qu'on a le temps voir ce qui se passe sur le plan technique. Alors que quelquefois les hommes, c'est vrai surtout sur l'herbe, on ne voit plus rien.
Il me semble que le rugby féminin en Australie et en Nouvelle Zélande a peut-être un peu plus de bagage que nous en France. Chez nous les filles n'ont pas encore eu le temps d'atteindre un niveau intéressant pour pratiquer un rugby spécifique.
S - C'est exactement ce que je voulais dire ; il y aura une évolution.
CJ - C'est vrai pour la plupart des activités sportives. Le basket ça n'a pas été fait pour les femmes pas plus que le rugby, le handball, le hockey sur glace ou le foot. Dans ces sports collectifs les règlements sont exactement les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Tout le monde s'accorde à dire, d'après les études faites sur les comportements des garçons et des filles dans ces sports, que les productions, même si elles se ressemblent parce qu'il y a du mimétisme, ne véhiculent pas la même chose de la part des pratiquants. Il me semble que c'est très bien.
J'ai un plaisir fou avec les filles et tous les entraîneurs qui les ont eues, et je suppose que les entraîneurs actuels, ont autant de plaisir que nous en avons eu. Je ne suis pas pour changer le sport. Ce n'est pas à ça que je voudrais qu'on arrive mais à adapter des règlements sur certaines phases de jeu parce que faire des mêlées hein ! Est-ce qu'il ne faut pas changer un peu quelque chose ? Il n'y aurait sans doute pas beaucoup d'adaptations à faire. On sait bien que dans l'ensemble les filles préfèrent s'éviter, jouer dans les espaces, faire voltiger le ballon plutôt que de se renter dedans. Mais il y en a qui aiment se rentrer dedans.
Il y aurait sans doute certains points à valoriser ou à modifier d'une certaine façon mais non pas changer fondamentalement.
S - Je pense qu'il faut que la femme donne son identité au sport. Le problème est qu'il y a une identité masculine dans la plupart des sports pour ne pas dire tous. Il faut que cette identité change si elles veulent pouvoir arriver à un sport spectacle. Si je prends l'exemple du foot féminin, on commence à en voir la touche féminine justement, chose que dans certains sports on ne distingue pas encore.
CJ - Il semblerait que le foot ait un petit peu d'avance par rapport au rugby et ce n'est pas difficile parce qu'au niveau technique il y a des conseillers techniques régionaux qui s'occupent des filles. Au niveau de la fédération il y a des responsables féminins. Il y a quelques échelons qui se mettent en place, sans doute parce que le monde féminin du football commence à se faire entendre. Dans le rugby ça n'existe pas.
Si, il y a une responsable à la fédération, une dame responsable à la fédération. C'est drôle, c'est mieux que rien bien sûr mais je crois que ce n'est pas comme ça que l'on construit une activité. Ce n'est pas en mettant une là-haut mais plus probablement en donnant des moyens aux gens qui sont sur le terrain et en favorisant leur représentation. Cela illustre la difficulté pour des femmes à pratiquer une activité nouvelle et totalement masculine.
S - J'ai un exemple contradictoire ; il s'agit de la lutte bretonne qui est un sport traditionnel, culturellement très masculin parce c'est le sport des agriculteurs et des ouvriers. C'est un sport d'affrontement, c'est aussi un jeu breton. On voit maintenant une activité féminine qui se développe. Mais on n'a pas du tout adapté quoique ce soit à part la durée des combats.
Actuellement nous préparons les championnats d'Europe qui auront lieu la semaine prochaine. On a eu des entraînements auxquels ont participé les garçons et les filles ; les entraînements ont été collectifs, ont été mixtes. Il n'y a pas eu d'entraînement pour les filles, d'entraînements pour les garçons et tout le monde s'entraînait en même temps
On n'a pas peur d'aller lutter contre les mecs.
S - Vous avez commencé à quel âge ?
S - 8 ans
S - Oui voilà
S - Oui bien sûr mais il est possible d'aller vers des sports qui ne sont pas spécialement adaptés aux femmes ; il faut aller essayer. En rugby ça ne marche peut-être pas.
CJ - Si, si ça marche en rugby, avec des tas de difficultés mais ça marche.
S - Il y a des sports qui n'ont pas besoin d'être adaptés. Il faut juste tenter.
CJ - Par rapport aux filles et au Gouren il est vrai qu'il existe un obstacle culturel ; ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le franchir. C'est vrai aussi pour le rugby qui est un sport de combat ; il faut défendre ou gagner un ballon, il y a combat
S -Vous parliez d'esthétique. Le Gouren féminin je trouve ça esthétique, je trouve beau une envolée, une projection. je trouve ça aussi beau que chez les garçons.
CJ - C'est aussi beau que chez les garçons. Le rugby masculin et le rugby féminin sont aussi beau l'un que l'autre ; encore que dans le rugby masculin lorsqu'il y a une mêlée ouverte et que les joueurs se tombent dessus je ne vois pas……. Quand on regarde jouer les garçons et les filles on voit bien qu'elles n'ont aucun problème de contact avec les garçons. Elles courent, elles rentrent dedans, elles gardent la balle, elles jouent très bien. Par contre le s garçons hésitent se demande "pour la mettre par terre qu'est ce que je fais ?". Les petits, garçons et filles, ne posent aucun problème. C'est à l'adolescence qu'on trouve ces problèmes, puis arrivé à 17/18/19 ans ce problème-là aussi est réglé. Je crois que ça n'est pas le contact qui est important, c'est l'idée qu'on s'en fait.
Mais culturellement les filles qui font ça ont des difficultés parce que ce n'est pas dans leur quotidien, dans ce qu'on leurs a inculqué. La famille regarde de travers, c'est uniquement pour ça.
S - Oui une fille ça danse et ça joue pas au rugby et ça joue pas au hockey
S - Il faut tenir compte des mentalités. Je suis venue au Gourent grâce à mon frère. Je suis jeune encore mais quand j'aurai des enfants je ferai essayer à ma fille la lutte autant que le danse ou que la gym. Avant il y avait peut-être des à priori. Mon père qui n'est pas un mauvais père, a décidé des activités que ferait mon frère. Mon frère voulait faire du piano, mes parents lui ont demandé de faire du judo du karaté ou du rugby; finalement il fait du rugby.
A - Il est l'heure. Je vous remercie ainsi que les témoins qui ont apporté un éclairage sur leur pratique et sur leur expérience.
ATELIER B
L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES
INVITES TEMOINS
Mme DECHAVANNE Nicole,Mme SEVIN Michele,Mme LE GAD Fabienne,Mme LEBORGNE Lucile,Mr CLEGUER Yvon,
ANIMATEUR
Mr. ROCHER Patrick,
P. ROCHER
Mesdames-Messieurs, nous avons deux heures dans cet atelier pour essayer de donner des pistes d’actions locales par rapport au rôle et à la place de la femme dans les instances dirigeantes du sport.
Simplement, en introduction et c’est un homme qui le remarquait, à la DDJS du Finistère on compte 15 professeurs de Sport -dont 2 femmes – 7 administratifs -dont 6 femmes- et il y a 3 postes à la direction et ce sont 3 hommes.
Ces chiffres ne sont peut être pas représentatifs des pourcentages au niveau national mais on pourrait en discuter et peut être donner l’exemple au niveau de notre ministère – bien que nous ayons une ministre qui, comme vous l’avez dit, impose parfois des changements.
Aussi, je crois que pour une importante commission en cours de création, concernant les diplômes dans le domaine des Activités Physiques et Sportives, elle impose que le Président de cette commission soit une femme.
Une intervenante
Je crois également que le jury du professorat de sport est pratiquement mixte cette année.
P. ROCHER
Je vais reprendre quelques points auxquels faisaient référence Mme DECHAVANNE ce matin.
Mme DECHAVANNE
C’est le résultat de plusieurs rencontres.
P. ROCHER
On orientera les débats vers ces 3 pôles qui émergaient ce matin :
- le pôle politique,
le pôle administratif,
le pôle technique.
Sans aborder ces thèmes en 3 parties successives, nous les retrouvons globalement au cours de quelques témoignages intéressants, mais il serait important surtout que vous proposiez quelques types d’actions à mettre en place localement pour faire évoluer le sport au féminin.
Mme DECHAVANNE, ce matin, a parlé des freins d’accès des femmes aux postes de décision :
l’articulation vie familiale / vie associative,le poids des stéréotypes,l’auto dévalorisation,l’organisation du milieu sportif : réseau et fonctionnement.
Elle a donné des solutions envisageables sur le plan législatif, fonctionnel, médiatique ou de la formation.
Ces pistes d’actions sont issues de plusieurs colloques et réunions sur ce même thème, dont le dernier s’est tenu au CNOSF début février.
Il serait intéressant dans le Finistère, non pas de copier forcément ces solutions, mais d’avoir des idées propres et d’en dégager 3 ou 4.
Je demande donc aux témoins de se présenter, de donner leurs rôles et leurs places dans le sport, les problèmes qu’ils ont pu rencontrer, les obstacles qu’ils ont surmontés et peut être des pistes d’action pour le sport féminin dans le Finistère.
Yvon CLEGUER, Président du CDOS, peut nous donner quelques éléments propres au département sur ce thème.
Yvon CLEGUER
Je suis marié, père de 2 enfants, président depuis peu du CDOS et président depuis plus longtemps de la Ligue de Bretagne de Judo.
Dans cette ligue, on essaie d’intégrer les femmes, mais c’est très long. La fédération, suite aux directives ministérielles, met en place des postes réservés aux féminines, mais c’est encore insuffisant sur le plan des responsabilités et de la pratique sportive.
Il ne s’agit pas d’un sport exceptionnellement féminin mais celles-ci revendiquent une meilleure place et elles se « bagarrent » pour cela – c’est un sport de combat. Elles gagnent des places!
D’ailleurs, au niveau des Jeux Olympiques, il y a autant de femmes que d’hommes et dans les résultats il y a pratiquement égalité.
Je suis attentif à cette avancée des femmes dans le judo mais aussi avec le CDOS à une meilleure place pour elle dans le sport finistérien.
Il n’y a que 11 femmes présidentes sur les 66 comités départementaux. Il y a seulement 22% de participation féminine dans les C.A. C’est encore insuffisant.
Depuis les dernières élections, il y a 2 élues au CDOS -aucune auparavant-. L’une provient du canoë-kayak, l’autre des sports sous marins. Il y a peu de femmes, car il y a peu de candidatures.
Il faut qu’il y ait plus de femmes à la présidence des C.D. pour être élues au CDOS. C’est toute une longue démarche.
Si elles sont candidates au CDOS, elles sont élues.
Gisèle BILLON
De la même façon, au CROS, les 3 femmes candidates sur les 15 postes ont été élues.
Yvon CLEGUER
Dans certains sports, on a encore du mal à faire confiance aux femmes.Peut-être pas trop au niveau du club mais surtout au niveau des C.D.Par contre, il y a des sports plus féminins, l’équitation par exemple et depuis longtemps .
Michèle SEVIN Je suis présidente du C.D. handisport 35 ainsi que du club handisport de RENNES. Je suis toujours pratiquante sportive en tennis de table au sein de la FFTT handisport et j’ai participé aux derniers jeux para-olympiques de SYDNEY et obtenu 2 médailles.
Mon parcours est un peu particulier. Je suis originaire d’une famille rurale, dans une petite commune où le sport était très présent. Pendant toute ma scolarité, on m’a dispensée de sport… J’ai commencé la pratique sportive à plus de 20 ans quand j’ai commencé à travailler.
J’ai adhéré à Handisport et ensuite dans
un club de valides pour pratiquer ensuite en compétition.
J’ai été sollicitée par les dirigeants du
club handisport dans le milieu pongiste et assumé la présidence d’abord 3
ans. Après quelques années sabbatiques je suis à nouveau présidente de ce
club depuis 1989.
Le C.D.handisport a été créé en 1983 et j’en suis également présidente depuis 1989, en parallèle à mon activité professionnelle.
Handisport est une fédération multisport. En Ille et Vilaine, le C.D. comprend trois clubs dont un seul présidé par une femme. En Bretagne, sur 15 ou 20 clubs, je n’ai pas d’information précise mais je suis peut être la seule présidente.
une participante (en s’excusant)
Avez-vous une famille ?
Michèle SEVIN
Non je n’ai aucune contrainte particulière sur le plan familial. C’est un point important.
P. ROCHER
Justement Mme DECHEVANNE évoquait ce matin cette difficulté ou cette différence pour une femme de demander en quelque sorte l’autorisation de son mari avant de s’engager dans une responsabilité ou de s’absenter une soirée.
Est-ce que les hommes ont aussi aujourd’hui aussi cet « accord » à demander par rapport à la famille ? La nécessité d’en parler avant se fait-elle plus évidente?
Est-ce que Yvon CLEGUER, par exemple, qui a été confronté récemment au problème peut nous parler de ses démarches?
Yvon CLEGUER
J’ai connu ces problèmes de négociations avec mon épouse avant d’être candidat à la présidence de club, il y a déjà quelques années. On évolue avec l’âge et on est sans doute encore plus attentif à l’avis de la famille. Evidemment, quand on m’a proposé cette candidature à la présidence du CDOS, je n’ai pas répondu immédiatement et j’ai pris largement le temps de demander l’avis à mon épouse et à mes enfants. Cela a pris d’ailleurs un certain temps jusqu’à ce que le « non » initial évolue lentement vers une approbation. Ce n’est pas du tout évident de s’organiser entre la famille, le travail, la pratique du judo -que je poursuis- et ces responsabilités. C’est toute une organisation !
Un participant
J’ai eu des responsabilités dans le tennis de table pendant 30 ans environ avec carte blanche de mon épouse. J’ai lâché la présidence depuis 1 an et nous sommes beaucoup plus à la maison depuis. Pendant toutes, ces années nous avions l’occasion fréquente de rencontrer beaucoup d’amis. Mais mon épouse se plaint de ne presque plus les rencontrer depuis 1 an. Elle aimerait maintenant retrouver ces amis.
Mme DECHAVANNE
A ce niveau là, il y a eu évolution de la part des hommes qui tiennent plus compte de ces réseaux d’amis, mais aussi de la part des femmes. Celles-ci, en effet, se sont retranchées longtemps derrière leurs obligations familiales pour ne pas prendre de responsabilités. Avec les objectifs de parité, cela évolue mais il ne faut pas tout mettre sur le dos des hommes. Les femmes ont leur part de responsabilités dans le fait qu’à un moment donné, elles ne se sont pas impliquées.
Une (jeune) participante
Je voudrais juste rajouter que les temps changent. Je suis fraîchement mariée et j’ai un bébé depuis 4 mois. Mon mari est un footballeur qui évolue en CFA. Depuis le début de notre rencontre, à chaque fois qu’il y avait quelque chose, on en a toujours discuté, c’était naturel. J’avais moi aussi des activités sportives et professionnelles et cela nous prenait beaucoup de temps. Quand on n’arrivait pas à se voir, quelquefois on disait « stop ! on ne va pas là », mais on a toujours décidé ensemble. Je n’ai pas eu ce problème qu’avaient peut être nos parents.
Yvon CLEGUER
L’approche n’est peut être pas la même maintenant car les femmes travaillent. Elles sont amenées à prendre plus de décisions que les générations précédentes.
Moi, ma mère ne travaillait pas, ma belle-mère non plus. Je vois bien que les relations que je vis avec mon épouse ne sont pas du tout les mêmes qu’entretenaient mes parents ou mes beaux-parents en tant que mari et femme.
Une participante
Est-ce que le débat est de dire : « les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela » ou est-ce de parler des femmes et du sport ?
Je voudrais dire à la petite jeune femme que je suis plus âgée qu’elle mais que j’ai pu agir comme elle il y a 30 ou 40 ans. Le débat n’est pas nouveau mais les discussions existaient aussi à l’époque. Quand mon mari avait envie de faire quelque chose, il en parlait .Quand j’avais envie de faire quelque chose, j’en parlais .Ce n’est pas nouveau.
Le débat est : comment les femmes peuvent-elles accéder au sport en général et même au sport de haut niveau, tout en travaillant, tout en restant femme et tout en assumant leur vie de famille ? Il n’est pas de mettre en parallèle ou en opposition la vie des hommes et des femmes.
P. ROCHER
Le but final n’est pas de mettre en opposition « hommes et femmes », il est d’émettre des actions qui vont faire évoluer les choses.
Il y a des constats à faire pour ensuite proposer des actions.
Revenons sur certains mots : parité par exemple .
Le côté légal peut-il imposer certaines choses ?Quand certaines femmes ne prennent pas leurs responsabilités, que peut-on faire?
Ce matin on a souvent parlé de domination des hommes.
Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie que cela change. Est-ce que tout le monde a envie que la parité soit imposée ?
On est là pour que vous puissiez témoigner :« Moi, la situation me convient» ou « Moi, elle ne me convient pas » ou encore « Mon mari est parti tout le temps, j’aurai bien voulu faire autre chose mais les mœurs étaient ainsi » et peut être « Moi je pense que les femmes ont leur mot à dire pour que les choses changent ».
Me Dechavanne disait ce matin « J’étais d’autant plus acceptée que j’acceptais des fonctions que les autres refusaient » On peut comprendre ainsi « Je me suis trouvée de la sorte présidente de la FFEPGV (Gym. Volontaire).Qu’une femme dirige des femmes ne dérangeait pas les hommes ».
Aucun homme n’était vraiment intéressé pour être président de la FFEPGV.
A-t-on envie que cela change?
Une participante
Je pensais que le débat était plutôt «Comment devient-on dirigeant sportif et comment peut-on prendre plus de responsabilités dans le sport ? »
P. ROCHER
On peut faire avancer le débat dans le sens où vous le souhaitez. On fait le constat qu’il y a une domination actuelle des hommes dans le sport. Des témoignages sont les bienvenus : de la part de dirigeantes pour qu’elles nous donnent leur parcours, et d’autre part de candidates aux responsabilités pour donner leurs propositions pour l’avenir .
Mme DECHAVANNE
Je ne pense pas ce soit inutile d’avoir des témoignages parce que ce sont des personnes qui ont un itinéraire très différent . Ils peuvent nous permettre d’envisager des solutions mais aussi d’ identifier les résistances. On retombera donc dans le débat à un moment donné.
Mme LE GAD
J’ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants de 10 et 11 ans. J’ai un parcours un peu spécial au niveau de la prise des responsabilités dans le monde sportif.
J’étais coiffeuse auparavant -j’étais donc artisan- tout se passait très bien, mais au bout de 15 ans de métier,j’ai fait une allergie aux produits ! Ce fut le couperet : il fallait arrêter le métier : plus de 25 ans, pas d’ANPE, pas d’emploi… Mais je ne suis pas du tout de nature à me laisser aller !
Je pratique un sport qui n’est pas du tout féminin, c’est le motocross. J’ai commencé à 16 ans, cela a toujours été ma passion. Mon mari en faisait, mes enfants s’y mettent aussi.
J’ai intégré la commission régionale du sport éducatif de cette discipline qui était gérée par une dame de 70 ans. Elle menait très bien ses troupes – c’était la mamie de tout le monde – et quand elle n’a plus voulu se représenter, j’ai pris sa succession.
Je suis donc présidente de la commission du sport éducatif de la Ligue de Bretagne moto. Pour moi, ce n’était pas juste « gérer » des enfants. Je voulais apporter ce que j’avais connu en compétition. J’ai donc passé un brevet fédéral pour encadrer les enfants, avec l’accord de mon mari mais surtout son soutien, parce qu’à 35 ans ce n’est pas évident de refaire des études quand vous avez charge de famille.
J’ai passé ensuite le brevet fédéral 2ème degré – ce qui a demandé de lourdes contraintes au niveau familial car les examens avaient lieu au CREPS de BOULOURIS, c’est à dire à 3 000 Kms (aller-retour) de QUIMPER. J’ai dû faire 3 aller-retour dans le Sud et un à PARIS.
J’ai entrepris sur ma lancée de passer le tronc commun ,nouvelle expérience car j’ai arrêté l’école en 1ère, alors que le T.C. représente un BAC+1 dans certaines matières comme la physiologie.
Ceci a demandé des heures de travail. Une fois les petits couchés, je travaillais les cours et je me levais tôt le matin. Ce sont trois mois de cours et je vous assure que par moment on se prend la tête. J’étais parfois insupportable à la maison car certains jours rien ne rentre , on pense qu’on est trop vieux. Mais j’avais toujours le soutien de mon mari, et quand je partais dans le Sud il assumait les tâches ménagères et s’occupait des enfants à merveille. Ils m’ont beaucoup soutenue car c’était assez dur et en moto il y a très peu de femmes.
J’ai décroché mon brevet d’Etat en septembre dernier. Je suis la 3ème en France à avoir ce diplôme et la 1ère dans la discipline motocross. Pour moi c’était un challenge personnel très important, prouvant ainsi qu’il ne faut pas nécessairement être jeune pour décrocher les examens. Quand on a la volonté et quand on est passionné, on arrive à tout!
Aujourd’hui, je fais partie du Comité directeur de la Ligue de moto et également de la Fédération, dans le collège « pratique éducative ». De plus, je suis membre du comité départemental de moto.
Sans le soutien de ma famille, je pense que je n’y serais pas arrivée. C’est aussi un investissement financier : je n’ai trouvé aucun financement pour ce B.E. (j’ai plus de 25 ans, donc trop vieille, donc le droit à rien). On fait des sacrifices mais par ailleurs, avec les enfants tous les week-ends, c’est très motivant.
Ce soir, je pars sur RENNES pour des compétitions mais à aucun moment je ne suis fatiguée pour cela. Je le suis la semaine quand il y a des tâches ménagères à assumer, mais quand il faut aller sur un terrain avec eux, ils me donnent une grande énergie et me motivent. Il n’est pas incompatible d’être une femme et de gérer une activité plutôt masculine.
Je précise qu’en moto éducative, c’est à dire pour les 8-12 ans, j’ai actuellement 8 petites filles qui pratiquent cette discipline et il n’y a aucune moquerie entre garçons et filles. Tout le monde porte un casque et les petites filles sont sur le même pied d’égalité que les garçons. C’est très convivial.
Je n’ai jamais eu non plus de critique de la part de mes confrères brevetés d’état. On fait tous le même travail et il n’y a aucune remarque.
P. ROCHER
C’est un témoignage qui prouve qu’avec la passion ou la volonté, une femme peut accéder à des responsabilités dans un sport très masculin.
Est-ce que dans la formation, dans les réunions ou dans la manière d’encadrer vous avez eu des remarques ?
Mme LE GAD
Non ! Simplement au cours de stages de perfectionnement pour les petits, en tant que B.E , les parents me confient les enfants comme si j’étais leur maman. C’est très important. Au niveau de l’enseignement dans ma discipline il y a quelque chose qui passe mieux avec les enfants qu’avec les garçons. Les mamans me laissent leurs enfants sans aucune appréhension. Ça se passe très bien.
P. ROCHER
Dans le descriptif de vos activités apparaît une question déjà évoquée ce matin au sujet des activités que l’on dit féminines ou masculines. A l’école les activités sportives sont mixtes jusqu’à un certain âge. Dans le domaine fédéral, on observe que plus on avance en âge, moins on retrouve de filles.
Prenons la moto, vous êtes presque l’exception – quelqu’un parlait de femme phénomène ce matin.
Ce problème de retrouver peu de femmes dans les postes à responsabilités n’est-il pas lié au fait qu’en grandissant on retrouve de moins en moins de filles dans certaines activités.
En général, après la pratique sportive et la compétition, on passe à des tâches d’encadrement ou administratives, mais pour ces petites filles qui pratiquent la moto, est-ce qu’elles vont trouver facilement leur place dans les équipes dirigeantes ?
Mme LE GAD
Tant qu’elles sont adolescentes et que les parents peuvent les suivre (en particulier financièrement), il n’y a pas de soucis. Le problème se pose après, quant au conjoint qu’elles vont rencontrer. Une fille qui pratique la moto, ce n’est pas très fréquent. Si elle veut continuer il faudra qu’il accepte.
On avait une jeune par exemple en Bretagne qui marchait très très bien au niveau national. Elle roulait avec les garçons car elle était seule dans sa catégorie. On n’organise pas une course pour une personne. Elle est allée ainsi jusqu’aux Etats-Unis pour certaines courses. Le problème est qu’elle a rencontré un triathlète qui n’aimait pas la moto. Elle a lâché la moto. Mon mari lui est un crossman, il adore ce sport, mais en aucun cas je n’aurais arrêté la moto. Je suis passionnée depuis 30 ans, je n’aurais pas pu me marier à un footballeur. C’est impossible, c’est clair ! ! ! (rire général)
Je crois que si on veut une bonne harmonie dans un couple, c’est ainsi. Si chacun vit sa vie de son côté, autant être célibataire, moi je passe pratiquement tous les W.E. sur les terrains de motocross. Imaginez si mon conjoint faisait autre chose. Là, on a quelque chose en commun. On a des discussions. Si on faisait des choses diamétralement opposées, je ne vois pas la possibilité d’échanges. Ici on est en famille. On partage des moments très forts.
Yvon CLEGUER
C’est très bien que toute la famille puisse se retrouver autour de la pratique sportive, mais pour les réunions du soir ou les réunions du W.E. les enfants ne suivent pas.
Donc, il y a bien dans un couple quelqu’un qui doit se « sacrifier » à un moment donné, que ce soit l’homme ou la femme.
Madame LE GAD
Mon mari sait que je me bats pour une bonne cause et en aucun cas pour lui, c’est un sacrifice. Il ne le conçoit pas comme tel. Il sait que je suis passionnée et que l’on fait avancer les choses chacun dans notre discipline.
Gisèle BILLON
J’irai tout à fait dans le même sens que madame. Je suis venue à l’animation et à la gymnastique, dans une fédération -il s’agit de l’EPMM- qui a une femme comme Présidente et qui œuvre parallèlement à l’EPGV.
P. ROCHER
Après la présidence d’un homme jusqu’en 2000.
Gisèle BILLON
Oui, et c’est la 1ère fois aussi qu’il y a une femme à la présidence d’une fédération composée à 95% de femmes.
Je suis arrivée à l’EPMM car je faisais de la gymnastique auparavant et j’ai pris des responsabilités dans le club. J’ai été 12 ans présidente du Comité Départemental du Finistère. Je suis toujours actuellement trésorière du comité régional et j’ai été pendant 8 ans à la fédération nationale.
Mais c’est une chose que j’ai exercée en accord avec mon mari car il était lui aussi pratiquant. Il faisait partie, et il le fait encore, dans les 5% ... Quand le couple pratique la même activité c’est plus facile. Mon mari a trouvé tout à fait normal que je prenne des responsabilités. Lui-même était parti très souvent parce qu’il était militaire. Ce n’était donc pas un sacrifice pour lui que de me laisser partir 3 ou 4 jours à PARIS si nécessaire.
Madame DECHAVANNE
Je crois que votre témoignage nous offre une 1ère piste. Vous avez dit qu’à plus de 25 ans, vous n’avez trouvé aucun organisme pour vous soutenir dans votre démarche de passer le BE1.
Est-ce que l’on ne pourrait pas dans le Finistère avoir une structure qui pourrait recevoir ces dossiers et soutenir ceux de ce genre ?
Madame LE GAD
Il y a des subventions possibles au niveau de la région, mais l’exigence est d’appartenir à une formation au BE en continu.
Nous, on a 2 types de formations : Les brevets fédéraux et l’examen final au bout du compte. Cette démarche ne peut être aidée financièrement.
Il m’aurait fallu, pour être financée, partir 6 mois en formation continue dans le sud de la France, donc 6 mois loin de la maison.
Je ne vois pas du tout mon mari, pourtant très très sympa, rester 6 mois tout seul à la maison.
C’est pour cela que j’avais choisi une formation par étapes, par UF, car il est plus facile de partir 3 fois 15 jours qu’une fois 6 mois. Ils m’ont laissé m’inscrire à des formations et je n’ai eu une réponse (négative) sur le financement que la veille de mon départ pour une 1ère UF.
Gisèle BILLON
Pour les ASSEDIC, n’y a-t-il pas de possibilité de prise en charge d’une formation dans le cadre d’une reconversion ?
Madame LE GAD
Le problème c’est que ancienne artisan n’a aucun statut. J’aurais été salariée, il n’y aurait pas eu de soucis. L’artisanat c’est un peu la bête noire. On cotise mais le jour où on perd son emploi pour raison de santé comme moi, ou pour faillite ou pour x autres raisons, on est dans l’anonymat le plus complet, on ne s’occupe pas de vous.
P. ROCHER
Dans ce problème de la formation, il y a 2 choses que l’on vient d’évoquer :
l’aide générale à la formation car le problème pour 1 homme voulant passer le BE aurait été le même,
le soutien plus particulier à la formation des femmes qui s’impliquent dans le monde associatif, que ce soit pour encadrer ou pour diriger.
Gisèle BILLON
Je sais que notre fédération prend en charge, avec les comités, régional et départemental, la formation des futurs cadres formateurs.
P. ROCHER
Ça c’est sur le plan général, mais ma question est de savoir s’il y a des besoins plus spécifiques au niveau des femmes qui cherchent à s’impliquer.
Une intervenante
Des femmes qui ont fini d’élever leurs enfants ou qui ont arrêté leurs activités professionnelles pour élever leurs enfants mais qui aimeraient bien reprendre une activité associative par exemple.
Est-ce qu’il y a des pistes pour les aider à passer un BE ou des formations ?
P. ROCHER
La loi sur le Sport votée en 2000 fait une grande avancée par rapport à la prise en compte du bénévolat, mais peut-on aller plus loin vers un soutien plus grand au sport féminin ?
La question est donc d’apporter une attention particulière aux femmes qui veulent s’impliquer que ce soit dans l’encadrement ou au point de vue administratif ou responsabilité.
Madame LE BORGNE
Je suis enseignante. Je ne suis pas mariée, donc sans charge de famille. Je suis parvenue au sport par l’intermédiaire du foyer socio-éducatif où j’étais trésorière dans le collège où j’enseigne les maths.
Lors du pot de fin d’année, des profs d’EPS sont venus me voir en me disant « Tiens on aimerait bien monter une activité patin à roulettes. Est-ce que le foyer a des sous ? En rigolant, j’ai répondu « d’accord mais si vous m’apprenez à en faire ».
L’année suivante, on démarre l’activité avec surtout des professeurs féminins. La dominante était le patinage artistique en activité loisir, organisée par le foyer.
Puis quelques garçons sont arrivés. On a voulu monter un gala des activités du foyer en fin d’année, mais cela n’intéressait pas les garçons.Comme ceux-ci étaient déjà peu nombreux, j’ai décidé –personne n’étant volontaire- de prendre ce groupe en charge moi-même.
Je m’en suis occupée ainsi 1 an ou 2 puis le groupe s’est plus ou moins scindé car une partie des garçons voulait faire du hockey.
J’ai essayé de suivre des formations, d’apprendre à en faire moi-même. Je me suis rapprochée des clubs existants car il n’était pas question au départ de fonder un nouveau club.J’ai suivi des stages auxquels je n’avais normalement pas accès, car je ne suis pas professeur d’EPS, je suis prof de maths. Comme c’était par l’intermédiaire de l’amicale des professeurs d’EPS, c’était un peu plus souple. On m’a demandé d’y participer et je me suis formée comme cela. Pour moi, c’était du loisir. Il s’agissait d’occuper les élèves plutôt que d’être dans la cour. Ceci apporte également d’autres relations enseignants-enseignés qu’à travers sa seule discipline habituelle.
Au bout de 2 ou 3 ans, des élèves ayant quitté le collège m’ont demandé à plusieurs reprises de fonder un club, car ils ne pouvaient plus pratiquer dans le cadre scolaire. Je répondais non, mais sur leur insistance, j’ai cédé en leur posant mes conditions : si vos parents sont président, trésorier et secrétaire, moi je gère le reste.
Tout a démarré comme cela. Je faisais tout mais je n’avais aucune fonction officielle. Je me suis rapprochée de la fédé et on a créé un club.Les jeunes, déjà assez âgés, ont commencé la compétition. Par l’intermédiaire de l’amicale, je les ai accompagnés tout le temps. J’ai appris sur le tas. Les autres entraîneurs m’ont aidée, tout le monde surpris car c’était un sport masculin et c’était une fille qui entraînait.J’ai travaillé ainsi une équipe pendant 2 ou 3 ans. Puis il y a eu les frères plus jeunes qui voulaient jouer aussi et j’ai du étendre le club à d’autres équipes.
Mes responsabilités se sont un peu arrêtées là. Et puis quand j’ai voulu engager une équipe plus jeune en championnat, en plus de l’amicale, on m’a répondu lors d’une réunion du comité départemental : « c’est complet, il y a déjà 8 équipes, le calendrier est bouclé, il n’y a plus de place ». J’ai alors proposé de refaire tous les calendriers et que je les gèrerais. On a pu alors intégré le championnat.
Je me suis retrouvée responsable des classements et des calendriers.Un mois après, une équipe des Côtes d’Armor m’appelait en me disant « est ce vrai que tu as refait tous les calendriers du Finistère. Nous avons le même problème. Dans les Côtes d’Armor le calendrier est complet. Peux-tu nous engager dans le Finistère ?
Je ne les connaissais pas, j’étais débutante dans ce fonctionnement, mais tout ce que je voulais c’était faire jouer les gamins.
C’est ainsi que je me suis retrouvée avec un club des Côtes d’Armor dans le championnat du Finistère. Cela a duré un ou 2 ans, et j’étais obligée d’aller aux réunions régionales pour voir en observer le fonctionnement.Je m’y ennuyais un peu car le Finistère était peu important. On y parlait surtout des Côtes d’Armor qui étaient beaucoup plus structurées. J’étais plus ou moins secrétaire d’office mais comme on ne parlait que de ce département, j’ai menacé de ne plus payer de cotisations à la Région, de tout organiser et de tout gérer au niveau finistérien.Tous les clubs m’ont suivi sauf les plus anciens et ceux au plus haut niveau.C’était un mois avant les élections régionales.A la grande surprise des participants j’ai déclaré que pour que l’on n’ignore plus le Finistère, j’étais candidate au poste vacant de secrétaire générale du Rink Hockey.
Il faut préciser que comme disciplines en patin à roulettes, il y a :
le ring Hockey, presque exclusivement masculin avec plus de 300 garçons,
Le patinage artistique à 90% féminin,
La course où il y a moitié de garçons et moitié de filles.
J’ai donc été secrétaire de la ligue pendant 4 ans. J’ai été amenée ensuite à me présenter à la présidence. En effet, en tant que secrétaire, je poussais à la création d’emplois, mais la présidente de l’époque trouvait cela trop compliqué et y était opposée. Lors de la vacance de poste, il était donc normal pour les électeurs que je défende jusqu’au bout ce projet, en l’assurant complètement en tant que présidente.
Cela a duré 4 ans, et un peu malgré moi je reconduis ce mandat. C’est en me battant pour quelque chose que je me suis trouvée obligé d’assumer. J’avais en plus le secrétariat du hockey.
Je pense être reconnue pour mon engagement, et pour aller jusqu’au bout de mes idées, avec une efficacité dans le travail et dans un sport pourtant très masculin.
P. ROCHER
Vous êtes passionnée par votre sujet mais je vais devoir vous arrêter. Vous êtes donc actuellement présidente du Comité Départemental 29, présidente de la Ligue et secrétaire à la Fédération Nationale.. Mais au travers de cette passion, je ne ressens pas plus de problèmes pour les femmes qui ont voulu prendre des responsabilités, que pour des hommes.
Je remarque aussi qu’il faut, soit être célibataire, soit avoir un conjoint conciliant ou bien pour qui, comme le dit Yvon CLEGUER « il faut suivre ».
Mais dans ce cas, si tous les deux ont des passions différentes et demandent des responsabilités, comment fait-on alors « pour suivre ». Est-ce l’homme ou la femme ?
Y a t-il d’autres témoignages de femmes qui ont eu des problèmes pour prendre des responsabilités que ce soit au niveau :
encadrement,prise de responsabilité,rôle administratif, par exemple dans les municipalités. Il y a très peu de directrices de services des sports ou très peu d’adjointes aux sports.
Y a t-il des disciplines où l’accession est difficile pour une femme ? S’il n’y a pas de difficultés, le débat va s’arrêter là.
Mme DECHAVANNE
C’est bien là qu’est le débat. On a un retard historique. On voit bien qu’il faut y être, mais on a des disciplines où il y a très peu de pratiquantes – et ce sont bien les pratiquants qui font ensuite les dirigeants.
Mais le problème est qu’elles n’ont pas
envie d’y aller. La difficulté est de créer les conditions d’y venir.
Maintenant les conditions sont plus favorables, même avec les hommes, en
particulier dans la classe moyenne. Dans les classes populaires les rôles sont
plus répartis. Dans les classes très privilégiées, la femme a la fonction de
défendre le statut du mari par la représentation.
Le problème est de leur donner envie.
Une jeune participante
Est-ce que les élections sur 4 ans comme dans les comités olympiques, ce n’est pas un frein pour s’engager ? Comment une femme peut « goûter au plaisir de rentrer au comité olympique » si elle sait tout de suite qu’elle « en prend pour 4 ans » ? Cette durée du mandat n’est-elle pas un frein ?
P. ROCHER
Mme SEVIN tout à l’heure a évoqué la question. Vous avez dit que le mandat était de 2 ans, puis ensuite était passé à 4 ans.
Mme SEVIN
Disons que pour des raisons historiques, le club de RENNES n’avait pas fixé de limite de mandat pour le poste de Président.
Aussi, après sans doute quelques dérives, les membres ont arrêté une durée de 2 ans maximum. Or, 2 ans c’est très court, juste le temps d’apprendre.
Je suis arrivée en 78 et j’ai vu se succéder 2 ou 3 équipes tous les 2 ans. Les candidats ne se sont pas forcément impliqués auparavant. Or, un président doit avoir un minimum de compétence et d’information , même en tant que bénévole.
En effet l’association ressemble quelque part à une entreprise, il faut être très vigilant là-dessus.
La 1ère fois où je me suis trouvée Présidente, je pensais faire 2 ans comme les autres. Or, il y avait un problème pour trouver des volontaires et là on a changé les statuts. On a mis du temps à résoudre le problème. Il a fallu un moment, que ce soient des « anciens » de l’association, ayant déjà occupé des fonctions, qui acceptent de revenir. Les 4 ans, qui correspondent à une olympiade, me paraissent un temps minimum – sauf problème professionnel. Pour moi, 2 ans c’est trop court pour entreprendre quelque chose. Maintenant, derrière le président, il y a aussi toute une équipe sans qui les projets ne vont pas aboutir – ce sont surtout le secrétaire et le trésorier.
Une jeune participante, conseillère régionale
Je voudrais revenir sur l’idée « est-ce que les femmes veulent ou ne veulent pas prendre des responsabilités ? ». Je pense que ce n’est pas toujours une question de volonté mais de moyens.
La loi sur la parité a ouvert des places à un certain nombre de femmes. Elles les ont prises. Mais peut-être que les heures de réunions actuelles ne conviennent pas toujours. Il faut accepter d’y réfléchir.
Comment fait-on pour que les femmes soient à l’aise dans l’exercice de leurs responsabilités ?
Cela passe forcément par des périodes de formation.
Elles doivent également trouver les moyens au niveau familial pour faire garder leurs enfants. Peut-on les y aider ?
Je suis conseillère régionale et membre de
la commission formation. J’adhère complètement à votre proposition sur la
formation spécifique des jeunes dans le sport. Je trouve cette idée très
pertinente.
Autrefois, l’organisation et les moyens des
formations étaient définis en fonction de la présence quasiment exclusive des
hommes. Il faudrait changer cette vision d’ensemble.
P. ROCHER
Seriez-vous prête au niveau du conseil régional à relayer cette idée ?
LA CONSEILLERE REGIONALE
Oui, dans la mesure où je peux être utile.
Une participante
J’aimerai que les dames qui ont pris ou ont souhaité prendre des responsabilités nous disent quelles difficultés elles ont rencontrées, car dans le tennis de table, je fais partie de la commission fédérale pour le développement de la pratique féminine.
Mme DECHAVANNE
On rejoint ce que disait Gaëlle ABILY au niveau de l’emploi. Si on le lui propose, un homme sans beaucoup de formation en peinture en bâtiment dira quand même « j’y vais »
Une femme ne pourra pas agir ainsi et devra passer par une formation.
Je crois que les femmes sont plus
perfectionnistes, qu’elles soient bénévoles ou professionnelles.
Quand on leur laisse le champ, dans la politique par exemple, quand elles ont
appris à faire, elles y sont. Dans le sport il faudra prendre la même méthode
pour pouvoir y arriver.
P. ROCHER
On doit se poser 2 questions.
comment les femmes peuvent-elles être élues ?comment les aider après ?
Voici 2 citations tirées des travaux précédents :
«Les femmes doivent prouver 2 fois plus leurs compétences, sinon leurs discours ne paient pas »
« Les femmes doivent prouver leurs capacités bien plus que les hommes », dit encore la 1ère femme élue à la Fédération Française de rugby.
Un homme qui est élu, c’est un but qui est atteint. Il a abouti.
Une femme ne va pas se présenter juste pour
être élue mais pour réussir ce qu’elle doit faire.
Au lendemain de son élection, elle ne va donc
pas faire de discours sur des choses qu’elle ne connaît pas – alors qu’un
homme en est capable (rire général).
C’est vrai qu’après leurs élections, les femmes doivent prouver doublement leurs compétences. Je pense par exemple à une adjointe aux affaires scolaires que j’ai perçue plus compétente dans l’approfondissement des dossiers que les élus précédents. Comment faire pour que les femmes soient élues et comment faire ensuite pour les aider dans leurs tâches ?
On devrait le faire aussi pour les hommes, mais ils ne le souhaitent pas en général, car « ils sont déjà compétents », du moins le pensent-ils.
Une participante,Peut-on revenir sur un point ? C’est l’accès des femmes au sport qui va faire qu’elles vont s’impliquer ou non. Elles sont moins carriéristes que les hommes.
J’avais moi-même envie de faire quelque chose. Le fait d’être élue n’était pas mon but. Pour avancer il n’y avait pas de choix.
Une autre participante,Sur le Finistère il y a quand même des femmes qui sont parvenues à de hauts niveaux sportifs sans pour autant avoir pris de responsabilités. Il n’y a pas que la pratique sportive, il y autre chose.
J’ai moi-même fait beaucoup de sport dans des disciplines différentes. J’ai été élue municipale récemment. Je me suis proposée pour être adjointe aux sports. Je n’ai pas été nommée. On a nommé un monsieur qui ne pratiquait pas de sport du tout.
Une participante,Il y a les grands sports traditionnels qui prennent toute la place.
P. ROCHER
Mme DECHAVANNE l’a dit ce matin, on a un retard sur les pratiques. Il y a un travail à faire, à la suite de ce que disait Mme LE GAD au niveau des jeunes.
On devrait essayer d’impliquer plus les jeunes, pour qu’ils soient responsables de leurs associations . Le secteur scolaire les implique par le fait d’être juge ou arbitre dans les matchs, le fait d’encadrer certaines activités dès 13-14 ans, le fait de prendre des responsabilités.en UNSS par exemple. Dans certains statuts d’associations, des jeunes de plus de 16 ans peuvent voter dans les A.G. Pour l’instant ils ne peuvent pas prendre légalement de responsabilités au niveau des bureaux.
Gisèle BILLON,Dans certains statuts de fédérations, il y a nécessairement un jeune de moins de 25 ans.
P. ROCHER,Est-ce que l’on peut faire baisser encore cette tranche d’âge au profit de jeunes à partir de 16 ou 18 ans ?
Est-ce que l’on peut imposer qu’il y ait des commissions jeunes par exemple, cela se fait de plus en plus ?
Yvon CLEGUER
Je crois qu’il y a une piste intéressante émise par le CNOSF. Il s’agit de faire des comités départementaux et des conseils d’administrations jeunes, mixtes, faciles à mettre en place. Ce serait des organes de propositions. On pourrait ainsi faire remonter plus haut ce goût des responsabilités au niveau des adolescents filles ou garçons. Ce n’est pas facile car le plus souvent, en dehors de la pratique sportive, on ne les revoit plus.
UNE PARTICIPANTE
Je ne pense pas que les jeunes aient peur de
prendre des responsabilités car on voit bien que les secrétaires et
trésoriers dans les clubs sont en première ligne...et il y a beaucoup de
femmes.
On a bien dit que diriger une association, c’est
comme une entreprise mais c’est au niveau représentativité, à des niveaux
plus élevés que cela « coince ». C’est là qu’il y a un
décalage. On les a tellement imbriquées dans ces rôles de secrétaires et de
trésorières… Est-ce qu’on les incite à sortir de ces rôles là ?
Gisèle BILLONJe pense que c’est peut être ces femmes là qui se sont déjà impliquées dans ces rôles, qui sont le plus à même de franchir le pas. Elles savent de quoi il s’agit et comment traiter les problèmes, surtout quand il y a des salariés comme maintenant.
Une participante,Je fais un constat.Je ne pense pas que les femmes rencontrent plus de problèmes que les hommes à quelque niveau que ce soit.Le gros problème, c’est l’âge. Quelles que soient les fédérations, il faut souvent un certain âge pour être admis par les anciens et pour faire partie des instances supérieures. Les plus jeunes ne comptent pas pour eux.
Pour ma part, je ne vais pas attendre 60 ou 70 ans pour parvenir plus haut et me faire accepter. J’estime que beaucoup de gens ont des bonnes idées quel que soit leur âge. Il y a également une grande différence suivant les ligues et les fédérations entre les gens de terrain et les gens qui gèrent. On ne peut pas travailler l’un sans l’autre, mais les gens qui sont sur le terrain et au contact des jeunes ont une expérience que nos « administratifs » n’ont pas. Et bien souvent, en réunion, on n’est pas écouté à cause de l’âge. Quand vous regardez les bureaux des Fédés dans la presse, des gens de moins de 50 ans, il n’y en a pas beaucoup. Ce n’est pas du tout péjoratif.
Je sais qu’au niveau de notre fédération, il y a une nouvelle loi. Ils vont instaurer un schéma spécifique pour les prochaines élections. Avant, c’était d’office les présidents de ligue qui faisaient partie de la fédé, maintenant ce seront les gens des clubs qui seront élus au niveau de la fédération. Je trouve que c’est beaucoup plus représentatif car dans les clubs on est tous bénévoles.Même si je suis B.E. je suis peut être à 90% bénévole et à 10% rémunérée pour ce que je fais.
On est certainement plus au cœur des problèmes que les gens qui volent dans les hautes sphères et qui sont en décalage complète avec ce que l’on fait sur le terrain.
C’est au-delà du débat homme/femme.Il faudrait plus écouter les gens de la base qui oeuvrent pour leur sport, pour son développement.
UN PARTICIPANT Mme DECHAVANNE disait ce matin que les femmes et les hommes devaient travailler ensemble dans ce domaine là. C’est vrai.
Les hommes sont majoritaires actuellement dans la plupart des comités directeurs. Il nous appartient d’aider les femmes et surtout les jeunes à s’insérer.
Par exemple, dans le tennis de table, je suis impliqué au niveau fédéral. Cela n’empêche pas que sur le plan départemental,c’est une toute jeune femme qui est ma supérieure et je considère que mon travail est de l’épauler et de faire en sorte que le plus vite possible, elle soit capable de voler de ses propres ailes.
Mme DECHAVANNE ,Peut être aussi que pour « faire le renouvellement », il y a le problème de la limitation des mandats. Quand je vois des présidents de fédés qui ont 18 ans de présidence, je me pose des questions (rire)
Moi j’ai assumé à peine deux mandats. J’avais des idées pour deux, mais pas pour 4 mandats, je ne me serais pas assez renouvelée.
P. ROCHER ,Concernant les élections au niveau des fédérations, la loi 2000 sur le sport évoque certaines modalités non encore définies. Mme la Ministre, quand elle est venue à RENNES à l’invitation du CROS, a précisé qu’il y aurait sans doute une sorte de tronc commun pour toutes les fédérations et qu’ensuite chacune préserverait une certaine marge de liberté, dans une forme de démocratie à respecter.
Un participant, Il y a une représentation des féminines imposée par la loi.
P. ROCHER,Tout à fait. On s’aperçoit que pour avancer il faut que ce soit imposé par la loi.
Je voudrais revenir sur certaines pistes déjà évoquées.
Doit-on encourager par exemple l’implication des jeunes dans les associations scolaires ?
La création d’associations juniors leur permet ainsi de devenir président avant 18 ans ou d’avoir un compte à gérer, sous l’égide de la F.O.L. ou de l’UFOLEP je crois.
Est-ce que l’on doit aller jusqu’à aider financièrement des associations, des fédérations, des comités qui déclarent dans leurs statuts favoriser l’entrée des femmes ou des jeunes aux postes à responsabilités?
Ensuite, la question de la limitation des mandats, je l’ai notée aussi. C’est vrai que 4 ans semble une bonne durée. Est-ce que dans certaines associations, on peut limiter le poste de président à un mandat voire 2. Serait-ce une avancée ?
On a des propositions à faire. Essayons d’éclaircir ces réflexions.
Par rapport à l’implication des jeunes et l’accès des femmes aux responsabilités, vous avez dit ce matin, Mme DECHAVANNE, que le CNOSF envisageait pour les prochaines élections 5 postes pour les femmes, c’est à dire 10% et peut-être jusqu’à 20% mais pas de parité.
Mme DECHAVANNE
Monsieur SERANDOUR s’était engagé, s’il n’y avait pas de femme, à aller les chercher. C’était une grande démarche, mais le Conseil Constitutionnel n’a pas donné la réponse. Et comme il faut une réponse et que l’A.G. est le 10 mai…Pour une fois qu’on avait réussi à leur faire voter cela !
P. ROCHER, Il y a donc déjà des idées que nous devons traduire en propositions concrètes.
Comment favoriser ceux qui proposent ?
Par rapport à l’implication des jeunes, peut-on soutenir les structures qui inscrivent des proportions (tant de femmes au CA…)dans leurs statuts ?
Yvon CLEGUER
Dans le Finistère il y a actuellement 22% de femmes dans les conseils d’administrations des comités départementaux. C’est très très peu. Et 15 C.D. n’ont aucune femme dans leurs C.A.
P. ROCHER
Doit-on les « inciter fortement » à changer ou non ?
Yvon CLEGUER
C’est vrai que les directions ministérielles pourraient aider. C’est vrai aussi que les Fédés sont toutes puissantes dans les textes qui redescendent ensuite dans les départements.
Il y a des Fédés très machistes qui n’ont pas envie d’avoir des femmes dans leurs structures . C’est clair.
Il y a des Fédés qui imposent un certain nombre de femmes, mais pas toutes. C’est vrai aussi qu’après, il faut trouver des volontaires.
Un participant
Cela suppose aussi qu’une action se fasse au niveau local, au niveau du club, simplement de façon qu’il y ait des personnes motivées car des personnes motivées spontanément comme Mme LE BORGNE, il n’y en a peut être pas énormément.
P. ROCHER
Est-ce que l’on peut favoriser des associations, et comment peut-on considérer qu’elles favorisent l’accès des femmes aux responsabilités ?
Que faudrait-il faire concrètement ?
Yvon CLEGUER
Il faudrait peut être aussi prendre le relais du sport scolaire.
UN PARTICIPANT (tennis de table)
C’est un travail de longue haleine. Je vois chez nous par exemple, on constate que des poussines et des benjamines, on en a très peu.
L’action de très longue durée serait d’essayer d’avoir davantage de licenciés dans cette catégorie-là, de les accompagner et les former à l’arbitrage vers 11-12 ans, les amener à prendre des responsabilités et encourager celles qui sont les plus motivées.
Mais le problème n’est pas nouveau.
J’ai lu récemment dans une revue de tennis de table, un article de 1942-1943 qui parlait déjà du problème des féminines à peu près dans les termes actuels.
Gisèle BILLON
Je pense aussi qu’il y a peut être des mentalités qui ont changé. Dans la discipline Gym pour tous, sport pour tous, les gens deviennent de plus en plus consommateurs.
Cela fait 25 ans que je suis dans le même club. On retrouve au niveau des candidats aux A.G. et des responsables, de moins en moins de gens à vouloir s’investir.
D’une part les femmes travaillent, elles ont de moins en moins de temps libre.
D’autre part leurs enfants ont eux aussi des activités. Elles doivent souvent les y conduire. Elles prennent quelquefois des responsabilités au niveau des associations qui accueillent leurs enfants.
Une participante
Je crois qu’au niveau légal, quand on connaît les responsabilités qui incombent à un Président qui peut se retrouver en prison, de même que le trésorier ou le brevet d’état, on hésite.
Gisèle BILLON
Le bénévolat, on ne le favorise pas, on ne l’aide pas. L’association aussi petite soit-t-elle, c’est une entreprise maintenant.
P. ROCHER
Tout à l’heure vous en parliez du stéréotype « être secrétaire, c’est un travail de femme »
Celui qui a les responsabilités au niveau légal, au niveau politique, c’est le président.
Est-ce qu’il faut faciliter l’accès aux décisions et aux prises de responsabilités pour les femmes qui ont effectué des tâches matérielles pendant plusieurs années ?
Gisèle BILLON
Au niveau du CROS Bretagne, il y a des formations pour les dirigeants et les élus qui sont « au top ». Elles sont « extra », mais cela fait 3 ans que j’y suis et on voit toujours les mêmes personnes.
P. ROCHER
Dans ces formations participent des femmes déjà élues. La question primordiale est de permettre aux femmes d’être élues.
Gisèle BILLON
C’est au niveau des clubs qu’il faut faire ce travail.
Une représentante du droit des femmes
Est-ce qu’il n’y a pas un défaut de communication ? Je suis directrice dans un centre de droit des femmes. Je n’ai aucun renseignement en ce qui concerne le sport et ses formations. Chez nous, il passe environ 9 000 femmes par an. Au moins la moitié doit faire du sport, mais il y a un défaut de communication et d’information.
Si on plaçait ces informations sur les murs ou en plaquettes, on pourrait peut-être intéresser les gens.
Moi je n’avais jamais entendu dire qu’il y avait des formations pour être dirigeant sportif. Il y a sans doute un défaut de communication.
Gisèle BILLON
Ces femmes là, si elles font de la gym ou du sport, et bien tous les clubs ont une A.G mais les gens ne vont pas aux A.G.
P. ROCHER
Je crois qu’améliorer la communication est une piste concrète mais il faut cibler le type d’informations à donner.
Une représentante du droit des femmes
On a des groupes de paroles de femmes qui sont par exemple, soit en recherche d’emploi, soit isolées. Si on leur donnait ces idées, soit de bénévolat, soit de responsable, peut-être qu’elles iraient, mais on ne leur donne pas ces informations. C’est peut être une idée à creuser. Je n’en sais rien.
P. ROCHER
Moi, j’en reviens à la prise de responsabilités.
Est-ce que l’on peut favoriser par exemple des initiatives au niveau des associations scolaires ?
Et la parité dans le sport ?
Est-ce que la parité doit être imposée comme au niveau des élections municipales ?
Est-ce que, dans une activité où la pratique est majoritairement féminine, il doit y avoir plus de femmes élues dans les instances dirigeantes?
La parité impose 50/50 mais dans certaines communes où la population de femmes est supérieure à la population d’hommes, est-ce logique ?
Dans des associations où il y a 70 % de femmes, devrait-il y avoir 70% de femmes élues ?
Une participante
Je pense qu’il faudrait surtout dire aux filles que le sport c’est aussi pour elles, que la compétition, c’est aussi pour les filles.
Il y a certaines sports qui sont prêts à les y amener.
Il y a aussi quelques sports collectifs pour les filles -volley et basket- où cela fait partie des mœurs.
Le hand dans le Finistère aussi, ce n’est pas si mal que cela. C’est quand même un département où le hand féminin est très fort.
Mais très souvent il n’y a pas la « dominante fille » pour les sports collectifs, alors qu’il y aurait sans doute beaucoup de filles à s’y intéresser.
Je pense que pour la mixité, on dit toujours que « les filles, c’est différent ». Mais au niveau scolaire, elles ont gagné la mixité dans les établissements.
Une participante
Elle est rediscutée actuellement au niveau du second cycle.
La participante précédente
Au niveau du collège jusqu’à 14-15 ans, elle n’a pas l’air de poser trop de problèmes.
Une autre
Elle ne profite pas aux filles.
Une autre
Au contraire, je dirais que souvent cela les écrase. Ma fille est en 6ème. Ils font de la lutte actuellement. C’est garçons contre filles. Les filles à force de se faire « tomber » par les garçons, elles arrêtent.
Mme DECHAVANNE
En ce qui concerne la fédé de gym sportive, j’ai les statistiques. Il y a 79% d’adhérentes et 40% de femmes au comité directeur.
P. ROCHER
Donc c’est une vraie question.
Mme DECHAVANNE
Oui tout à fait.
Mais je ne sais pas s’il faut rentrer dans
les chiffres d’une façon rigide, moi je préfère les fourchettes.
Si vous avez 20% de femmes par exemple vous devez avoir entre 10% et 30% d’élues.
Une jeune femme
Peut-être un mot sur la parité, car nous la vivons en politique. Il ne faut pas la considérer comme une fin en soi mais comme une étape. A mon sens, l’obligation a vocation à être dépassée très vite. Par contre, pour que les femmes accèdent à des responsabilités, à mon avis, il faut en passer par-là, cela me semble indispensable, car l’exemple que je connais en politique ne me satisfait pas forcément .
Ceci dit, on essaie de se battre depuis des années pour qu’il y ait des femmes et il n’y en a pas.
Et c’est du jour où il y a obligation qu’enfin il y a accès aux femmes. Je pense que pour le sport c’est un peu la même chose.
Si la parité est appliquée dans le sport, il faudra travailler sur les moyens. Comment permettre à plus de femmes d’accéder, et puis quelle souplesse mettre en place une fois que les choses seront rentrées dans les habitudes ?
Yvon CLEGUER
Vous avez vécu la parité en politique dans les grandes villes. Moi je l’ai vécue dans un petit village. Je peux vous dire que c’est une « galère ».
Il y a une démarche vers les hommes aussi. Il faut aussi aller les chercher, mais c’est compliqué.
Bon, c’est nouveau. Il a fallu que chacun s’adapte. Peut-être que cela sera plus naturel la prochaine fois. Je le souhaite.
Une participante
Oui cela dépend des cas. Pour ma part j’ai été adjointe .
J’étais enseignante d’EPS auparavant. Donc un peu par tradition, on m’a dit « les affaires sportives d’abord ». J’ai refusé en répondant que c’était les travaux qui m’intéressaient ».
J’ai choqué tout le monde. Quand j’ai eu les travaux on m’a dit « vous ferez l’embellissement et la propreté de la ville !».
Bien sûr on est maintenant 8 femmes et 11 hommes dans le conseil municipal et on n’est pas là parce qu’on était venus nous chercher. On est venu parce qu’on s’intéressait à la vie publique. On allait assister à des réunions, on lisait les journaux et on débattait ensemble avant d’avoir tout projet de changement communal. On n’est pas venu nous chercher, cela ne s’est pas passé comme chez vous, on y est allé.
Une participante
Je voudrais ajouter quelque chose à propos de
la parité. Je suis d’accord avec Mme ABILY. Les 50%, il faut les prendre
comme un repère, mais ce n’est pas gagné partout.
C’est d’autant moins gagné que la parité, c’est dans les villes de plus
de 3 500 habitants. Or le nombre de communes de moins de 3 500 habitants est
considérable. Là il y a encore tout un travail à faire.
Que les habitudes aient été bouleversées, et qu’il ait fallu aller chercher les femmes, moi je trouve cela très bien.
On dit toujours qu’il faut changer les mentalités mais je crois que la modification des institutions est un bon moyen de peser sur le changement dans une démocratie. Ceci dit, vous parliez tout à l’heure de favoriser les Fédés par exemple qui donneraient de l’élan à la promotion des femmes dans les responsabilités.
Là, je crois qu’il faudrait toute la souplesse dont parlait Mme ABILY. Et j’ai l’exemple de notre Fédé - il s’agit du Gouren- qui a une structure féminine depuis 14 ans.
Les filles partent plus facilement et reviennent moins vite que les garçons à ce sport. J’ai déjà eu l’occasion de remarquer cela, rien qu’en 14 ans. Celles qui ont entrepris la démarche, et ce n’est pas facile de monter sur un tas de sciure sous le regard de gens qui ne sont pas habitués à y voir les filles, ont eu le mérite en plus de se former.
Nous avons une forte proportion de femmes arbitres, y compris du second degré, ce qui leur permet d’arbitrer des tournois internationaux, et de monitrices. Et pourtant notre brevet fédéral n’est pas du tout facile.
Nous avons donc proportionnellement plus de cadres sportifs femmes, monitrices et arbitres, que de garçons, surtout à un âge comparable.
Ceci dit, quand on commence à leur parler de responsabilités au niveau du fonctionnement de la Fédé, tout de suite, les hommes sont intéressés
Favoriser les Fédés qui prennent des responsabilités en faveur des filles, oui sûrement, mais que ce soit très large et très souple, c’est à dire que l’on prenne en compte : le plan sportif, le plan technique, l’arbitrage, la formation des cadres sportifs ou les responsabilités administratives à proprement parler, mais j’ai peur que le combat s’arrête faute de combattants. Il ne faut pas écraser les gens.
P. ROCHER
On parle de médiatiser le sport féminin mais est-ce que le fait de mettre en avant des femmes qui ont pris des responsabilités et qui réussissent est possible. Il suffirait peut-être d’avoir un journal qui accepte de le faire et qu’il y ait une page régulière sur le sport féminin, qui mette en valeur des femmes pratiquantes, dirigeantes…
Je suis arrivé l’an dernier en septembre mais je crois qu’il y a eu l’année dernière des remises de récompenses féminines.
Une participante
Peut-être que là aussi on a à être offensive, comme le droit des femmes de s’insurger contre certaines publicités montrant des femmes dans des situations peu favorables.
Il faudrait que les femmes, mais aussi les Fédés, fassent bouger les médias.
Je regardais l’autre jour un très beau match de tennis à la télé –HINGIS contre une des sœurs WILLIAMS- c’était un match de très haut niveau, vraiment très beau et le commentateur de la chaîne a dit « mais quel beau match d’hommes ! » Pour lui ce n’était pas « un très beau match de femmes ».
Je crois que là aussi les Fédés ont peut-être à interdire des publicités ou des commentaires peu flatteurs et à faire évoluer les situations qui ne sont pas valorisantes pour les femmes.
Une autre participante
Oui par exemple la publicité qui annonce « vous avez gagné une femme ! »
Un participant
Et pourtant, je suis persuadé que le journaliste était très admiratif. Je suis persuadé aussi que l’on regarde bien plus le tennis féminin qu’il y a 10-15 ans.
La participante spectatrice précédente
Oui, mais j’aurais aimé qu’il dise « c’était un très beau match de femmes et non pas un match d’hommes ».
Une participante
Il y en avait encore une l’autre jour, c’était un homme qui poussait une femme aux fesses en disant « il faut bien que je m’essuie les mains parce que je viens de manger du chocolat ». Elle a été interdite, mais il faut le faire ?
Si le ministre n’avait pas interdit cette publicité de façon spectaculaire, il y aurait eu d’autres publicités bien pire.
Il faut interdire cela et faire du bruit autour, et c’est ainsi qu’on arrivera à faire évoluer les mentalités.
P. ROCHER
Inversons cette publicité Mme DECHAVANNE, ou plutôt utilisons cette publicité pour dire « poussons les femmes vers les responsabilités » (rire)
Il nous reste ¼ d’heure.
Je voulais énoncer les actions qui ont été proposées à la suite de la journée du CNOSF.
Mme DECHAVANNE
Il faudrait un ou plutôt plusieurs groupes de travail comme ceci.
P. ROCHER
Donner la priorité au plan local. Finalement, le CNOSF aimerait que ce soit nous, localement, qui démarrions les choses. C’est pour cela que je parlais de favoriser, par exemple, telle association qui dirait et qui écrirait dans les statuts « on veut 10% de femmes dans notre comité directeur ». Ce sont de petites choses mais qui font avancer. Et nous, instutions, face à cela, on soutient.
Favoriser les actions en direction des jeunes hommes et femmes : on en a parlé.
Créer un réseau
Il faudrait peut- être qu’il n’y ait pas que le Président qui ait des responsabilités mais qu’elles soient
partagées entre plusieurs personnes.
Mme DECHAVANNE
Non, mais simplement que l’on connaisse localement telle ou telle femme dans sa structure. Au cas où la Fédération de Judo par exemple cherche quelqu’un avec tel profil, que le réseau local puisse dire au comité directeur « madame untelle est sportive avec tel profil, on peut lui demander », en somme avoir un carnet d’adresses au cas où on cherche quelqu’un pour faire quelque chose. C’est là l’idée.
Une participante
Et qui est-ce qui ferait ce carnet ?
Mme DECHAVANNE
Et bien, dans notre association féministe on essaie de commencer à le faire, mais on aimerait que cela s’organise. Peu importe qui.
P. ROCHER
Est-ce que le point de départ ne serait pas un état des lieux que l’on pourrait faire, nous, Jeunesse et Sports et le mouvement sportif sur l’état du sport féminin.
Mme DECHAVANNE
On a commencé à le faire. Il existe déjà.
Où sont les femmes dirigeantes dans votre département ?
Une participante
Vous aviez parlé de 22 femmes
Yvon CLEGUER
C’est déjà dépassé. Par rapport à certaines disciplines, on connaît les chiffres.
P. ROCHER
On peut l’écrire de façon plus formelle.
Passons à la tenue d’assises départementales et régionales femmes et sport.
Mme DECHAVANNE
Cela commence à bien marcher.
P. ROCHER
La mise en place d’actions de formation. Comment amener les femmes à être dirigeantes ?
La réalisation de documents : mais je ne sais pas ce que vous vouliez réaliser.
Mme DECHAVANNE
Pour nous la réalisation de documents, c’est aussi la collection de tout ce qui se fait partout, et, il y a beaucoup de choses qui commence à se faire sur « femmes et sport ».
Par exemple, si vous faites un compte-rendu de tout ceci, moi j’aimerais qu’il soit répertorié au Comité Olympique.
Moi, j’aimerais faire un livre blanc de toutes les inégalités, mais il faudrait que tout le monde me rapporte et m’envoie des petites histoires.
Ces inégalités portent par exemple sur :
les nominations de cadres techniques
les différences dans les emplois
certaines différences comme celles concernant les équipes nationales de basket
·
masculine qui est logée dans un hôtel 5 étoiles·
et féminine qui est logée dans un hôtel 2 étoiles.
C’est bizarre, mais des petites choses comme cela !
P. ROCHER
Le financement de 2 équipes au même niveau national n’est pas le même pour une équipe masculine ou féminine.
Mme DECHAVANNE
J’aimerai un livre blanc de tout cela : montrer les inégalités.
Yvon CLEGUER
Il y a quand même des efforts.
Dans le judo, le budget concernant l’équipe de France féminine est supérieur au budget de l’équipe de France masculine.
Une participante
Et dans le Judo, on me l’a dit, les prix sont les mêmes.
Mme DECHAVANNE
J’avais noté certains prix dans un tournoi par exemple.
La femme avait un aspirateur et l’homme une boîte à outils. J’étais suffoquée.
C’était gentil, dans l’idée, comme tout à l’heure, mais quand on a vu cela!
Une participante
Est-ce que vous savez combien il y a de femmes qui vivent de leur sport par rapport au nombre d’hommes ?
Mme DECHAVANNE
Non !On vient de créer à TOULOUSE une association qui a l’objectif de faire une étude sur les professionnels, moi je suis plutôt le bénévolat, mais cette association se crée avec une championne. Elle a mis en place les statuts il y a un mois. Dans notre prochaine publication on donnera l’information. C’est plus sur les professionnels.
P. ROCHER
Vous avez noté aussi dans les ressources, le rapprochement du mouvement sportif avec les mouvements scolaires et universitaires.
Mme DECHAVANNE
Un peu dans le sens dont vous parliez d’organiser des regroupements garçons et filles sur les connaissances minimales pour être dirigeant. Comment faire une réunion quand on est jeune ? On les met en situation d’animer une réunion, à 15 ans c’est intéressant.
P. ROCHER
L’orientation du FNDS
On favorise les initiatives – on le fait déjà car il y a un dispositif femmes et sport – pour valoriser et mettre en place de nouvelles actions.
Pourquoi ne pas aider les associations qui vont favoriser l’entrée des femmes dans leur comité directeur ? Donc aider à leur formation : qu’elles soient plus soutenues, qu’on réfléchissent d’avantage à cette formation.
Mme DECHAVANNE
L’idée que l’on avait au Comité Olympique était de réunir maintenant des femmes qui sont déjà dirigeantes dans les clubs, et de leur demander à elles-mêmes leurs besoins de formation.
P. ROCHER
C’est le soutien, mais aussi le recensement des formations.
Une participante
Je voudrais rajouter quelque chose au niveau des villes : c’est inciter les collectivités à prévoir un critère de subvention lié à la présence féminine aux postes de responsabilité ou à la place des femmes dans l’association.
P. ROCHER
Mais nous, nous n’avons pas de pouvoir sur les collectivités.
Une participante
Non, mais suggérer comme vous pouvez le faire à Jeunesse et Sports sur d’autres thèmes.
P. ROCHER
Oui, suggérer par l’intermédiaire de l’Office des Sports par exemple. Donc simplement un petit mot de nos invités témoins pour conclure : Mme LE BORGNE, vous allez continuer sans problème ?
Mme LE BORGNE
Pour l’instant oui, mais après 2 mandats de dirigeants, je pense que c’est assez…
Mme LE GAD
Je pars à RENNES en compétition demain encadrer mes enfants, mais c’est aussi par plaisir.
P. ROCHER
Mme SEVIN, les prochains J.O ?
Mme SEVIN
On verra, il reste 3 ans à attendre. C’est vrai que cela vient vite, mais enfin il peut se passer beaucoup de choses aussi. Je continue de m’entraîner. On verra si les dirigeants de la Fédé me font encore confiance et si je suis encore compétitive.
P. ROCHER
Et 2008 à PARIS ?
Mme SEVIN
En supporter oui !
Yvon CLEGUER
Il y avait 38% de participation féminine à SYDNEY, donc objectif 50% à PARIS en 2008.
P. ROCHER
Je vous remercie. On va essayer de mettre un peu en forme ces propositions pour faire avancer comme on le pourra, et avec nos partenaires, le sport au féminin.
SYNTHESE
Les échanges verbaux entre les invités témoins et la salle ou entre participants ont permis de mettre en exergue les difficultés et obstacles liés à la prise de responsabilités par les femmes dans les associations.
Faire le constat actuel et énoncer un certain nombre d’évidences (difficultés à mener de front des activités associatives et le rôle de mère de famille, dévalorisation des pratiques féminines…) était une étape indispensable.
L’objectif de ce groupe de réflexion à l’intérieur de ce colloque « Femmes et Sport » étant de proposer des pistes d’actions à mettre en place dans l’avenir, la discussion a donc permis d’émettre quelques hypothèses :
·
effectuer un recensement des besoins en formation (pour les femmes déjà impliquées ou souhaitant s’impliquer) et réfléchir aux aides (particulières?) qui pourraient être proposées (financières…),·
favoriser les initiatives tendant à permettre aux jeunes de prendre des responsabilités,·
développer l’information, la communication sur le sport au féminin,·
valoriser médiatiquement, en liaison avec la presse locale, les actions menées par des femmes,·
proposer (au CDOMS par ex.) une réflexion sur la mise en place éventuelle, dans le cadre des subventions municipales, d’un critère concernant l’importance donnée aux féminines dans les associations,·
relayer localement les propositions faites par Mme Dechavanne d’un carnet d’adresses, d’un livre blanc des inégalités et plus généralement d’un réseau des femmes agissant dans le domaine du Sport.
En conclusion, et pour concrétiser ses propositions, il serait intéressant de créer une commission (un groupe de travail…) composée de différents partenaires intéressés : institutions (DDJS…), collectivités territoriales(Conseil Général, Conseil Régional par la présence de Mlle Gaëlle Abily, conseillère régionale participante au colloque…), mouvement sportif (CDOS,OMS…)…
SANTE-PHYSIOLOGIE de l’EXERCICE
Physiologie et spécificité féminine
Madame GRIJOL Marianne – Médecin Généraliste MORLAIX
Trésorière de l’Office des Sports
Présidente de l’Office des Sports pendant 4 ans
Pratique Tir à l’Arc
Arbitre
Formation Médecine du Sport
Son passé de dirigeante, de pratiquante et médecine générale
D. MADOUAS – nouvelle vient de s’installer – médecin du sport
mi-temps Equipe « CASINO »
Traumatologie Spécifiquement cyclisme – j’encadre une équipe de niveau National – prévention. Suivi médical par une femme.
Madame FONLUP UREPS RENNES
Ex Présidente EPGV d’Honneur
Personnes Agées en perte d’équilibre et d’autonomie
Docteur GARO - Centre Médico Sportif depuis quelques années
Dans le débat aujourd’hui intéressé – statistiques 1 fille pour 3 garçons en moyenne.
A l’automne – entraîneurs pour ceux qui avaient des filles et des femmes
Avant un débat formation en interne avec une consœur rennaise – d’où son intérêt.
Frédéric LE GOFF DDJS 29
Madame DELAMARCHE excusée
Animatrices : Madame FONLUP – Madame ROBERT Conseiller Technique DDJS 29 et co-organisatrice de cette journée.
De la salle – dirigeante spécialité Judo
La sélection et les catégories de poids 13-14 ans.
L’obligation de régime chez les jeunes a-t-il les mêmes conséquences chez les filles que les garçons ?
Peut-on avoir des conseils sur les régimes selon les âges (en appui sur le débat du matin sur la nutrition)
A quel moment peut-on parler de pratique intensive du sport – en quantitatif
Nombre d’heures d’entraînement, etc…
De la salle – un dirigeant du GOUREN
Une pratique régulière développant la fonction métabolique, la fonction cardiaque, etc… donc des effets positifs une pratique de haut niveau d’après les propos de Madame DELARMACHE était plutôt négative et perturbait la fonction hormonale et la reproduction. Où s’arrête la pratique régulière et ou commence la pratique de haut niveau ?
Au niveau anatomique, en ce qui concerne la mixité, faut-il envisager des sports séparés, des catégories séparées (ossature, souplesse, musculation)
Influence sur la morphologie du pratiquant ?
Travailler à partir de la morphologie - choix de l’activité, la fonction de l’organe ou l’organe créé la fonction ?
A partir hommes-femmes, on organise des compétitions séparées ou mixtes
Ou certains sports masculins.
Exemple la boxe… Le Gouren
Certains pays hommes femmes se rencontrent (compétition)
Ou alors des catégories séparées.
Joëlle GUILLERM – Présidente de la commission football féminin au district Nord Finistère
Foot la mixité jusqu’à 14 ans
On dit : une fille de 9 ans ne peut pas jouer avec des garçons.
Ont-ils les même capacités ? Est-ce vrai ? puisqu ils jouent ensemble
Par rapport aux filles les parents réticents – développement de la morphologie.
Trouver des arguments pour répondre aux parents.
Docteur GARO – 1er niveau de réponse
La notion de régime dans la tranche d’âge évoquée est rarement visée. Pas de régime chez les jeunes. La régulation du poids ne se fait pas vis à vis du sport mais de l’individu. Prise en compte des catégories d’âges et de poids difficile à 13-14 ans, d’un côté déjà des femmes, de l’autre des petits garçons. Pour les sports de catégories de poids (judo, sports de combat et sports à haute exigence énergétique) éviter de parler de régime mais gestion alimentaire ponctuelle, ça se fait dans le temps.
En seniors certains perdent du poids 3 ou 4 kilos, 8 jours avant la compétition (boxe). Pour l’enfant c’est extrêmement dangereux, voire toxique c’est plus à voir avec les parents qu’avec le médecin (responsabilité des parents)
Si un enfant de 13 ans fille ou garçon a un morphotype donné vaut mieux une gestion sur le moyen terme de ce poids que l’excès ou l’inverse une gestion de ce poids sur plusieurs mois ou plusieurs années quitte a essuyer quelques revers sportifs au début.
Ça pourrait faire l’objet d’un débat
On a tendance à exploiter les qualités de surcharge de poids dans certaines disciplines par rapport à l’âge
Ne pas employer la notion de régime chez l’enfant en général et sportif en particulier.
De la salle –dirigeante Judo
Le retard de puberté lié à une pratique intensive telle que la gymnastique ou un autre sport existe-t-il ?
Y-a-t-il déjà dérèglement hormonal dès 13-14 ans ?
Docteur GARO
Oui bien sûr. On n’est pas dans le même registre que le votre. La catégorie gymnastique faut avoir un gabarit léger, vous vous avez droit à des catégories multiples et diverses en fonction des morphotypes, c’est totalement différent et le « régime » qui a été évoqué à propos de la GRS et la gymnastique c’est encore un autre monde.
De toute façon un régime sur trois jours NON
Gestion sur plusieurs mois à visée compétition OUI
Une gestion sur plusieurs mois ou années à visée régulation de ce poids par rapport au morphotype, pas de problème – si c’est fait dans le cas d’un suivi médical.
Frédéric LE GOFF
Valable pour tous les sports. Il ne faut pas perturber la croissance (en fonction de chaque individu)
Arrivée à 20 ans on ne peut pas revenir sur les dégâts du passé (les micro traumatismes et ses conséquences)
Docteur GARO – la pratique intensive
Il y a quelques années, l’académie de médecine situait le seuil d’entraînement intensif précoce à 6 heures semaine en plus des 3 ou 4 heures officielles au niveau collège en fonction des disciplines. Il faut prendre en compte 6 heures de travail effectif. – 6 heures c’est beaucoup pour certains moins pour d’autres en fonction des disciplines en fonction du style d’entraînement, 6 heures de natation ce sont 6 heures de pratique, 6 heures de gymnastique ce n’est plus la même chose (changement d’ateliers, on tourne, etc…). En sport collectif même chose, on joue et on regarde les autres joueurs 3h/3h. Tout est possible dans les 6 heures. Donc il n’y a rien d’officiel, c’est 6 heures plus le sport scolaire.
A BREST. A partir d’une enquête réalisée sur la base 16-20 en volume d’activité.
12 h la gym, la GRS – le patinage sur glace
sport collectif 6 heures : 2 à 3 entraînements semaine et le match.
Tous les problèmes qui ont été soulevés ce matin concernant le retard pubertaire, la croissance différée, le pic de croissance différé, on sait où ils pourraient survenir sur BREST et la région.
En gymnastique avant que les problèmes n’arrivent c’est minimum 12 heures par semaine – donc 6 entraînements de 2 heures.
Sur BREST et la région on ne dépasse pas les 10 heures. En GRS, je ne connais pas assez.
A voir d’autres activités qui à côté de çà sont peu exigeantes en matière de volume de travail et d’intensité.
On dédramatise donc déjà cette idée de pratique intensive je précise à BREST.
De la salle :
Vous parlez d’une enquête faite par rapport à l’âge à lequel on a débuté la pratique intensive. Qu’observez-vous ?
Docteur GARO
Bien sûr là où çà se passe on observe retard statural, retard pondéral, si le haut niveau commencé là jeune. On est en retraite à 20 ans.
Les traumatismes interviennent sur des corps en grande fragilité. Les études le montrent.
De la salle
Est-ce que l’entraînement progressif continu ne diminuent pas les traumatismes ?
Docteur GARO
Est-ce que çà existe ?
Théoriquement oui, mais si des potentiels existent est-ce que le mouvement sportif ne va pas demander à doubler ou tripler l’entraînement 6h 8h etc.
C’est le problème de la gestion et l’évolution des pratiques des individus.
Le monde sportif ne nous demande pas dans ces cas là, quel espoir se dessine à tel âge , c’est exponentiel.
Il y a des sports à maturité tardive, où on peut devenir champion à trente ans, donc obligatoirement progressif.
En gym sportive, en GRS, c’est exponentiel dès l’âge de 6 ans.
De la salle
Est-ce la même chose pour les garçons et les filles. Le même effet ?
Docteur GARO
Pareil jusqu’à 12-13 ans.
Après, tout se modifie, tout ce qui a été dit ce matin va se mettre en place avec les effets négatifs.
A 10-12 il y a plus de maladies de croissance chez les garçons que chez les filles. Mais vous verrez que ce n’est pas dans le club que se fait l’activité principale (rue, jardin, cour) çà n’arrête pas de bouger.
Problèmes de croissance (genou, talon, dos). Les garçons déclenchent des signes d’alarme dans une pratique pas particulièrement encadrée. Par contre pour les filles c’est plus sournois parce que les filles ne vont pas faire du foot dans la rue, du tennis, parce qu’il y a du tennis à la télé, ça va rester beaucoup plus cadré. Ça c’est l’entraînement intensif précoce, c’est purement formel.
Jo ROBERT
Si BREST n’est pas concerné, par rapport à la pratique intensive d’après les connaissances actuelles, en faisant l’hypothèse que la situation change, est-ce qu’on peut imaginer la mise en place d’un suivi médical départemental par discipline comme cela se fait dans les régions avec un docteur régional par ligue.
Docteur GARO
Le suivi médical se passe à différents niveaux. Ça commence à la signature du certificat de non contre indication qui peut se faire auprès de n’importe quel médecin de la médecine du sport ou non mais intéressé par la discipline jusqu’à la prise en charge des traumatismes très en aval.
Pour toutes les disciplines représentées ici, au niveau national toutes les fédérations ont une commission médicale nationale. Ces commissions médicales sont chargées d’élaborer le règlement médical fédéral qui est soumis au Ministère Jeunesse et Sports pour information – puis retour dans les fédérations pour redescendre ensuite dans les ligues et les départements quand il y a des commissions à chaque niveau.. Vous savez maintenant depuis les dernières olympiades que des médecins peuvent être élus au niveau départemental et régional et national dans les disciplines au niveau du CNOSF, ces disciplines ont des structures pyramidales tout fait bien opérationnelles (foot et les disciplines bien structurées) et des disciplines dont la prise en charge faute de médecins, faute de bonne volonté, mais aussi à l’image de la discipline mal structurée, il manque de bénévoles, d’arbitres, de tout.
La médecine étant toujours la dernière roue de la charrette.
Mais je crois que notre règlement médical au niveau régional par exemple, peut être en place dans vos disciplines respectives. Vous voyez comment çà se passe au niveau régional et après on descend d’un cran pour ceux qui ont des exigences départementales et il y a des médecins départementaux dans certaines disciplines.
De la salle
C’est leur choix… pour les médecins de médecine sportive.
Madame MADOUAS suit un club, elle n’est pas médecin départemental cyclisme.
Docteur GARO
Moi je suis médecin régional de voile
Le milieu de la voile découvre qu’il peut exister une médecine de la voile, et tout reste à faire. Ça se met en place pour la voile légère, ça pourrait se mettre en place pour la course au large, il y a un travail monstre à faire.
Autant au niveau des arbitres, qu’au niveau des médecins. Ça pourrait être un domaine à explorer.
J. FONLUP
Le cas de la ligue d’aviron.
Çà fait 4 ans qu’on attend. Heureusement qu’au niveau national on a une bonne structure
qui nous aide mais de loin et c’est difficile. Ce n’est pas que le sport ne soit pas structuré, mais des médecins on n’en trouve pas.
Frédéric LE GOFF
On est dans la situation d’une démarche de bénévoles et s’il n’y a pas de candidat…
Mais il y a une obligation sur le plan des textes. Situation insoluble
Les médecins ne peuvent pas être sur toutes les disciplines, ce qui se passe dans les instances statutaires est que les médecins qui ont des affinités avec telle ou telle discipline se portent candidats mais doivent déjà être dans les Instances dirigeantes de telle discipline. C’est déjà une avancée importante.
Les médecins qui ont déjà le certificat de médecine du sport c’est récent, maintenant il y en a de + en +
De la salle
Retour sur l’entraînement
En natation les enfants qui font 20 heures n’ont-il pas un suivi médical particulier
Docteur GARO
Si, à partir du moment ou ces enfants ont un entraînement important et sont dans des structures anciennes, classes Etudes, Pôle Espoirs, Pôle France, il y a obligatoirement un suivi médical pris en charge par le ministère.
Dr GARO
Un suivi c’est quasiment vivre avec.
Des disciplines comme la gym où le matin ce sont les cours théoriques, l’après midi l’activité pour un médecin c’est tous les soirs. A partir du moment ou les jeunes sont dans des structures c’est déjà un bon point. Le problème c’est des gens qui sont en clubs non structurés et qui visent un certain niveau qui bloquent sur l’emploi du temps scolaire, la situation géographique et éventuellement la bonne volonté d’un médecin qui veut bien venir au club ou l’inverse c’est pas évident encore faut-il avoir des affinités avec la discipline concernée.
Madame GRIJOL et le tir à l’arc.
Activité très méconnue sur le plan médical. On ne connaît pas vraiment les pathologies si on admet que les pathologies de l’épaule soit fréquentes.
Il n’y a pas de médecin au niveau de la ligue de bretagne. Ma position au niveau de la région en tant qu’arbitre est à l’origine de cette demande. Il faut en effet des médecins intéressés et connaissant la discipline. Si on me questionne sur le judo c’est quelque chose que je ne connais pas sur les problèmes spécifiques.
En qualité de médecin généraliste, quand on me demande de délivrer un certificat de non contre-indication pour une discipline que je ne connais, j’envoie au centre médico-sportif. Au tir à l’arc je commence à comprendre les choses. Il y a des contre-indications que je ne maîtrisais pas, j’avais du mal à cerner le pourquoi de la contre-indication d’une cardiopathie ou d’une insuffisance respiratoire, une apnée et puisque l’apnée a des contre-indications. Pour ce genre de chose il faut des gens qui connaissent et que l’on fasse des études sur le sujet.
Assurer un suivi médical c’est découvrir la discipline et l’analyser.
Il y a des nouvelles disciplines aussi qu’on ne connaît pas et qu’on ne maîtrise pas.
De la salle
Le tir à l’arc est une activité qui se féminise ou pas ?
C’est une discipline mixte qui a des classements séparés mais qui est une pratique complète mixte hommes femmes, et jeunes et âgés.
Un concours de tir à l’arc on verra des gamins de 8 ans tirer avec des gens de 70 ans.
Effectivement un enfant entouré soutenu par des enfants de son âge, par des gens + âgés c’est un esprit totalement différent en compétition
Entouré de tous âges, tout sexe.
J. FONLUP
Est-ce qu’il n’y a pas d’autres systèmes pour vérifier l’intensité ? Des études sur les métabolismes, des examens plus pointus en laboratoire par exemple ?
Dr GARO
Oui en laboratoire : sur le cœur, soit des enregistrements du cœur, soit sur d’autres paramètres biologiques. C’est déjà lourd. Souvent c’est fait dans des structures bien organisées par des équipes médicales bien structurées qui font des études par rapport à ce public. On en tire les enseignements. Le problème c’est qu’on sacrifie une génération pour appliquer les bonnes recettes médicales.
De la salle
Un enfant qui fait de la natation pendant 20 heures/semaine est dans une structure dans un club.
Docteur GARO
Le CNB est le club brestois de référence. Ceux qui sont listés avec le niveau CNB sont dans la structure « Pôle France Natation ». Pour la natation c’est simple à BREST.
Question : il est suivi médicalement ?
Docteur GARO
Avant de rentrer en 6ème en classe étude et 2 fois par an.
Y a pas de problème, on commence à l’école.
La voile c’est pareil.
De la salle
Retour sur le public féminin, un exemple.
Docteur GARO
On peut prendre le hand ball féminin. Le sport Etude Féminin, quand elles rentrent dans la structure elles sont 20
Dans un public déjà spécifique parce qu’elles ont 16 ans – 6 par niveau scolaire. Là c’est intéressant mais ce que l’on souhaiterait nous, c’est les prendre avant, parce que beaucoup de choses sont déjà jouées à 16 ans. En bien ou en mal. En bien c’est qu’elles ont déjà leur statut d’adultes et en mal elles ont déjà des blessures récurrentes ou rédhibitoires (chevilles, épaules et autres)
Ce que l’on voudrait au niveau des clubs, des comités, c’est une démarche vis à vis du milieu médical un accompagnement, on ne parle pas de suivi mais d’accompagnement. On avait commencé l’année dernière sur l’année avant c’est à dire celles qui étaient susceptibles d’intégrer le sport étude, et on avait déjà puisé une source importante de renseignements. çà il faudrait le faire tous les ans et même descendre. On rentre en sport études en seconde, on avait pris les 3ème, il faudrait descendre en 4ème, on sera déjà sur un public de filles et non plus de femmes. C’est la ligue, c’est le comité, la Fédé qui nous donne les moyens.
De la salle
les recherches de dosage hormonaux existent-t-elles ?
Docteur GARO
Pas de ce sport là.
De la salle
10 heures d’entraînement, donc on reste dans le raisonnable pour une handballeuse.
De la salle : Quelqu’un qui ne fait pas une pratique intensive, peut-il y avoir un suivi médical.
Docteur GARO
Tout dépend de son statut en terme de santé. Même si le jeune ne fait pas beaucoup et pratique et n’est pas en bonne santé, il doit être suivi.
De la salle
Et la personne qui est en bonne santé ?
Docteur GARO
Il y a le certificat médical de non contre-indication pour tout le monde. Pour la pratique du sport en association ou en club.
J. FONLUP
Le docteur GARO a parlé tout à l’heure des accidents : anatomie, cheville etc..
Est ce qu’il y a en hand Ball comme en GR, une morphologie « préférée » ? Est-ce qu’on décèle très tôt qui sera hand Balleuse.
Docteur GARO
Ici le Hand Ball est une culture locale.
Pas de gabarit, de morphotype pour rentrer en sport étude.
Il va de soi qu’avec la médiatisation de ce sport les fédérations vont définir un profil type. Chaque fille devra faire 1m80, 80 Kg… les clubs le font déjà au niveau pro.
A nous de mettre les garde-fous.
De la salleEn lutte – est-qu’il y a des compétitions regroupées ou séparées ?
Un responsable de la lutte bretonne
Mixte jusqu’à la catégorie benjamins et ensuite séparée.
Séparées filles et garçons.
J’ai recherché sur internet – la lutte en général. Aux Etats Unis c’est mixte en compétition universitaire. C’est assez récent l’arrivée des filles en catégorie 3.
Docteur GARO
Il y a 15 cm d’écart entre les filles et garçons pour le même poids. Vous avez dit que c’était mixte jusqu’en benjamin, c’est logique.
Jo ROBERT
Pourquoi jusqu’à 13 ans on peut-on faire une activité mixte et qu’après ce n’est plus possible ? Est-ce que c’est anatomique, physiologique ou est-ce que c’est le mouvement sportif qui dit que…
Docteur GARO
Tous les garçons et les filles du CM2 ont un morphotype équilibré, sachant que les moyennes sont importantes. On a fait une étude sur le CM2, sur les 10 ans, ça va de 1m21 à 1m61, garçons et filles, mais la moyenne était de 1m38,05 pour tout le monde en taille à 10 ans et après c’est sûr que ça se majore, ça se majore surtout sur le versant en poids, sachant qu’en gabarit il y a de tout.
Dans les sports de contact attention, il y a des sports comme le vélo, des cadets courent avec des cadettes, (des mixages possibles) où les filles « bien développées avec un bon entraînement sont meilleures que les garçons, parce qu’elles ont pris de l’avance. L’année dernière on a réussi à faire tourner deux filles avec 22 gars. Cette année on a décidé d’arrêter parce que les derniers chronos ont montré que les garçons passés 16-17 ans « larguaient » complètement les filles. C’est tard mais un moment donné la physiologie prouvait que les filles pouvaient être devant. Les garçons étaient encore des petits garçons. Il faut être très prudent avant de mélanger les gens car il y a d’autres phénomènes qui viennent interférer sur la physiologie qui sont peut être encore plus dangereux que le contact et les morphotypes dans les sports à haute exigence physiologique.
Je ne parle pas du tout de la natation où il y a des lignes d’eau, c’est le chrono le seul juge, ici faire la course cycliste filles et garçons ce ne sont pas des contacts mais il y a un rapport de force, ainsi que de physiologie.
J. FONLUP
Jadis on a vu qu’il n’y avait pas de compétition féminine et que petit à petit les femmes s’emparaient de certaines disciplines et allaient jusqu’aux compétitions.
Est-ce qu’actuellement il y a des sports qui sont encore interdits aux femmes. Puisqu’on parle de la féminisation du sport est-ce qu’il n’y a pas des disciplines qui leur sont interdites et pourquoi ? Comme jadis les femmes n’avaient pas le droit de faire du foot, du rugby, maintenant cela existe mais… est-ce qu’on peut tout conquérir nous les femmes ?
De la salle
Est-ce que c’est pas le droit de faire du foot ou bien parce que ce n’est pas organisé ?
J. FONLUP
Je pense au triple saut, à l’athlétisme
Docteur GARO
C’est vrai que la perche n’était pas pratiquée.
De la salle
Est-ce qu’on peut faire exactement la même version pour les hommes comme pour les femmes, ou bien faut-il adapter… Je crois savoir qu’en gymnastique les épreuves ne sont pas les mêmes, les agrès non plus.
On parle du soft Ball pour les filles, du base Ball pour les garçons.
F. LE GOFF
Il y a en gymnastique par rapport à la morphologie des exercices que les garçons ne feront jamais (exemple les enroulés de barre).
Si les agrès sont différents, les féminines ont fait évoluer leurs mouvements en comparaison avec ce que font les masculins, on retrouve sur les barres asymétriques les mouvements transposés faits sur la barre fixe.
J. FONLUP
Vous ne pensez pas qu’on est un peu rétrograde. Maintenant à l’école les classes sont mixtes, en sport ça ne pourrait pas être mixte aussi ? Avec effectivement des niveaux différents chez les garçons et les filles par rapport à leur morphologie ?
J’ai des très jeunes basketteurs – gagner contre des seniors en Basket.
Docteur GARO
L’école avait devancé çà. L’EPS au lycée, à l’école mélange les gars et les filles au rugby. Çà plaît beaucoup aux filles. Au rugby, en précisant de ne pas « plaquer » une fille.
J. FONLUP
Rappel sur l’intervention de Mme DELAMARCHE, la santé chez les jeunes champions.
Question. Il y a plus de problèmes chez les jeunes- filles dans les sports collectifs que chez les garçons.
Docteur GARO
Du fait des modifications évoquées ce matin (hormonales) on sait qu’il y a une laxité plus importante chez les filles qui entraîne automatiquement des entorses.(laxité ligamentaire) A l’opposé il y a moins de problèmes musculaires, claquages, types de blessures musculaires. Le fait de moins forcer entraîne moins de problèmes tendineux. Donc il y a une balance qui se fait chez les garçons et les hommes.
Chez la fille il y aura des problèmes sur le plan entorse à différents niveaux : de la cheville jusqu’au genou – problèmes aussi au niveau de l’axe rachidien – entorse lombo sacrée.
C’est plutôt dans le registre ligamentaire qu’on va avoir des problèmes.
Est-ce qui a été évoqué ce matin, ce sur quoi il faut peut être rebondir, ce sont les fameuses fractures de fatigue dont on parle beaucoup… en rencontre de plus en plus souvent. Ce ne sont pas des vraies fractures comme on en trouve au foot, au ski mais ce sont des fêlures, des fissures, mais qui ont le même devenir si on ne s’en occupe pas.
Elles sont dues à cette carence calcique chez la jeune et l’ostéoporose chez les moins jeunes. Il faut être très vigilent à tous les signaux d’appel qui sont précurseurs de ces traumatismes.
Jo ROBERT
Quand on est responsable de clubs, entraîneurs, quand on est responsable d’enfants on doit être très attentif à leurs douleurs. On rejoint aussi le problème de l’alimentation qui doit être équilibrée et répondre aux besoins de l’organisme. C’est valable aussi pour les adultes pour éviter les fractures de fatigue, sans choc, sans chute et pourtant bien réelles.
A partir de ce que l’on vient d’entendre, les aprioris des gens sur la fragilité féminine, qu’est ce qu’on pourrait imaginer ou proposer pour qu’on n’ai plus la même image des filles qui jouent au foot, qui jouent au rugby pour montrer qu’à 13 ans ou après on peut continuer à pratiquer plus ces activités traditionnellement masculins. Quelles adaptations, quels aménagements si nécessaire ? Quelles propositions pourriez-vous faire ?
Mme GRIJOL
Je pense qu’on pourrait déjà faire découvrir les différentes disciplines aux enfants. Effectivement dans la réalité c’est le foot pour les garçons, la gymnastique pour les filles. Elles ne connaissent pas le saut à la perche parce qu’elles n’ont pas l’occasion de le pratiquer.
Je vais parler de la commune de PLOURIN qui a développé depuis 1996 des écoles de sport qui s’adressaient à des enfants de 6 ans, maintenant 4 ans jusqu’à 16 ans avec la diversité de disciplines sportives qui sont pratiquées d’une façon ludique à titre de découverte, d’apprentissage. On a des gamines qui vont découvrir des sports qui sont catalogués masculins, et que le faite peut être qu’on leur ai proposé la discipline va entraîner une demande et la création de sections féminines dans les différentes spécialités.
En fait il faut sortir de la classification, activités pour les filles, activités pour les garçons.
J. FONLUP
Le problème c’est qu’il y a 90 disciplines sportives. On est brimé par le matériel, on fait avec ce que l’on a et on ne peut pas tout faire découvrir.
Retour sur la santé
Gilbert LE BOULCH- Professeur d’EPS en SUAPS
Sur une information récente, boire beaucoup de lait avait une action néfaste sur les tendons, les ligaments. Il y avait plus de rupture de tendon d’Achille et autre..
Chez l’enfant jamais trop, chez l’ado idem
Comment doit-on gérer chez l’athlète de + ou moins haut niveau
L’état de grossesse, avant, pendant, après ?
Mme GRIJOL
En tir à l’arc déjà par rapport au changement morphologique la femme doit porter un plastron et après la grossesse c’est aussi une contre indication.
L’énergie décuplée quand la femme est enceinte réelle ou pas ?
Docteur GARO
On augmente la masse sanguine donc réelle.
Judo
Il y a une dizaine d’années en judo, en compétition il fallait fournir un certificat de non grossesse, tous les 3 mois – maintenant çà n’existe plus.
Mme GRIJOL
Les risques de fausses couches qui peuvent être liés à la discipline, la natation et l’équitation ce n’est pas la même chose.
Par contre la reprise ne se conçoit pas d’une façon intensive en période d’allaitement. On peut reprendre une activité sportive normale. Attention à la sangle abdominale. Il peut y avoir risque d’incontinence urinaire d’effort. Il ne faut pas refaire des abdominaux les semaines après avoir accouché. Il faut insister sur la rééducation du post-partum.
J. FONLUP
Le rôle de la gym douce – reprendre conscience de son corps.
Mme GRIJOL
Valable pour les femmes après l’accouchement, valable pour les personnes + âgées pour la reprise après un accident, une maladie à condition de se donner ses propres limites. Attention aux phénomènes d’émulation.
De la salle
C’est souvent le problème dans les clubs. Les jeunes qui se blessent et qui reprennent trop vite les matchs, les entraînements, parce qu’on en a besoin d’eux et qu’il faut gagner les matchs. Donc des jeunes qui retournent sur le terrain alors qu’ils ne sont pas guéris et des blessures qui récidivent.
De la salle
Et les problèmes d’étirement.
Les étirements ne sont pas faits après les matchs. On ne récupère pas. Les coachs ne le font pas.
Jo ROBERT
On voit bien en effet qu’il y a des carences. Cependant dès qu’on arrive à un certain niveau les étirements sont utilisés au moins les temps de récupération.
Dans certaines pratiques tous est lié aussi au temps de l’activité 1 heure de tennis par exemple pour faire un match n’est pas suffisant. Donc on rentre tout de suite dans l’activité et à la fin on rentre vite fait à la maison parce qu’il est 22 heures. C’est vrai qu’au bout d’un certain temps et l’âge aidant çà finit par « casser ». Même dans des pratiques de loisirs, on doit pouvoir gérer sa santé.
De la salle
Çà vient. On voit les petits s’entraîner comme des pros.
Humour (salle)
En tennis à partir d’un certain âge dans le 1er set on joue en s’échauffant.
Jo ROBERT
Conclusion
A partir des informations du matin par rapport au développement de l’enfant, il y a une prise de conscience collective.
Dans les comportements ensuite, il faudra que tout çà se concrétise.
Une synthèse sur ce thème sera réalisée et communiquée à toutes les structures représentées aujourd’hui avec l’objectif d’extraire quelques pistes d’actions applicables rapidement pour améliorer les modes de pratiques et faire en sorte que cette journée ait apporté quelques réponses aux questions posées.