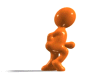 Créée
en mai 2000 à l’occasion de la célébration du 70è anniversaire de
l’Office des Sports, la randonnée, gratuite, de l’Office des Sports offrait
un parcours culturel sur le secteur de Recouvrance/St Pierre (+ de 150
personnes). En 2001, c’était le secteur de St Marc/Moulin Blanc (+ 400
personnes). En 2002 : Lambézellec (+ 400 personnes). En 2003 :
Bellevue (350 personnes).
Créée
en mai 2000 à l’occasion de la célébration du 70è anniversaire de
l’Office des Sports, la randonnée, gratuite, de l’Office des Sports offrait
un parcours culturel sur le secteur de Recouvrance/St Pierre (+ de 150
personnes). En 2001, c’était le secteur de St Marc/Moulin Blanc (+ 400
personnes). En 2002 : Lambézellec (+ 400 personnes). En 2003 :
Bellevue (350 personnes).
En
2004, Ville / Port de Commerce (400 personnes). En
A l’année prochaine sur le quartier de St MARC…
Rand’Office 2001
A la découverte du vieux Saint-Marc
Océanopolis
Ce centre de culture scientifique dédié à la faune et la flore marine date de 1990 et a été conçu dans sa première version par l’architecte Jacques Rougerie. Outre les expositions qui drainent un nombreux public, Océanopolis représente 60% de la recherche océanographique en partenariat scientifique avec notamment IFREMER, le CNRS et l’UBO. La visite d’aquariums géants peuplés d’une faune bigarrée permet de concrétiser un objectif pédagogique, en direction des jeunes notamment. Face à son succès croissant, Océanopolis fut vite à l’étroit dans son unique pavillon de 2600m2, disposé en 3 iveaux.. Une extension du centre s’avérait nécessaire …. Ce fut chose faîte le 29 mai 2000. A coté du premier pavillon, 2 autres ont été réalisés. La nouvelle répartition de ces 3 pôles d’exposition se décompose de la façon suivante : Le pavillon tempéré, le pavillon polaire et le pavillon tropical. Le pavillon tempéré nous fait découvrir notamment des phoques évoluant dans un bassin rénovée de 300 m3. Le pavillon tropical met en valeur les coraux et la faune marine de la Polynésie Française, de l’Océan Indien et des Caraïbes. Dans le pavillon polaire la transition est complète, les manchots et autres pingouins évoluent dans leur climat de prédilection.
Le vallon du Stang-Alard
Au creux de ce magnifique vallon aménagé en jardin et en circuit de promenade coule le Dourgwen, un paisible ruisseau d’eau claire surnommé de ce fait : Eau Blanche. Ce ruisseau qui se jette dans l’anse du Moulin Blanc prend sa source dans le quartier de Kergonan, appelé également : Eau Blanche. Le vallon du Stang-Alard s’étire tout en longueur sur une superficie de 40 hectares. Au sud dans sa partie basse, depuis 1975, a été aménagé sur 25 hectares de jardins et d’étangs le Conservatoire Botanique de Brest qui a pour mission de protéger les plantes les plus rares, dont certaines sont en voie de disparition. Le vallon recèle également d’anciennes carrières de pierres, ainsi certaines parois verticales brutes de taille sont encore décelables du côté de Guipavas Le nom de Stang-Alard pourrait signifier selon certains linguistes bretons : L’étang du cygne.
Station de pompage
L’eau de la Dourgwen étant réputée saine, une station de pompage fut installée au bas de la rampe du Stang-Alard en 1873 et fut exploitée par la Compagnie des Eaux.
La place Vinet
Cette place porte le nom de Jacques Joseph Vinet, en hommage à ce riche négociant qui fut de 1830 à 1846, durant les municipalités de Jacques Colin , conseiller municipal de Saint-Marc. Ce propriétaire fortuné avait acheté en 1803 le manoir de Kerjean aux descendants de la famille de Dupleix (Joseph François) qui fut célèbre en son temps comme Gouverneur général de la Compagnie des Indes. Il fit également l’acquisition, à la même famille, des terres de Kervéguen situées au nord de sa propriété. A sa mort survenu en 1858, sa veuve, qui se trouvait à la tête d’une grande fortune, fit don à la commune d’un champ appelé : Goarem Poulbriquen ( garenne de la mare sur la montagne) situé sur la colline, au dessus du vieux bourg, avec comme souhait d’y faire construire une nouvelle église. Cette opportunité était intéressante d’autant que les travaux d’extension jusqu’à Brest de la voie du chemin de fer, prévus pour 1862, allait en traversant le vieux bourg perturber la vie communale. Malgré certaines hésitations dues aux attaches anciennes , il devenait urgent de prévoir le transfert du bourg, sur la hauteur à l’écart de la voie ferrée. Le terrain cédé par madame Vinet permit de concrétiser cet projet devenu incontournable.
Les maires honorés
Bien que la paroisse de Saint-Marc ne fut admise comme cure indépendante de la paroisse mère de Lambézellec, qu’en 1823, par contre la qualité de commune lui était reconnue depuis 1790. Des nombreux maires œuvrèrent à son développement durant ses 155 ans d’existence. Saint-Marc au même titre que Saint-Pierre Quilbignon et Lambézellec fut annexé par Brest en 1945. Les noms donnés à certaines rues de Saint-Marc nous rappellent que plusieurs maires marquèrent au cours de leur mandat la vie de leur commune, devenue aujourd’hui un quartier de Brest. Il s’agit notamment d’honorer la mémoire de : Guillaume Kéraudy, Nicolas Labat, Jérôme Jouveau-Dubreuil, Jules Collières et de Yves Jaouen qui fut le dernier maire de Saint-Marc. Les 3 premiers furent non seulement les témoins des mutations intervenues durant la seconde moitié du XIXème siècle, mais surtout les acteurs avisés d’une reconversion réussie. Jules Collières (1868-1921), entrepreneur de son état fut élu maire de Saint-Marc en 1919, au lendemain de la grande guerre qui fit de nombreuses victimes parmi ses enfants. Très estimé de la population il s’efforça jusqu’à sa mort survenue en 1921 de secourir les plus défavorisés qui faisait prendre en charge par le bureau de bienfaisance. La scolarité des jeunes était une de ses préoccupations prioritaires qui l’incita à œuvrer pour le développement des écoles laïques et des cantines scolaires. Sa rue longeant le cimetière s’appelait auparavant : rue du Coadic (rue du petit bois). La commune honore également son dernier maire : Yves Jaouen (1900-1976). Conseiller municipal de Saint-Marc depuis 1929, il fut élu maire en 1935 suite au retrait de Jean Floch. Durant la guerre, toujours au service de la population, il est révoqué par le gouvernement de vichy pour son attitude peu collaboratrice avec les forces d’occupation. A la libération il participe avec Jules lullien à la gestion du grand Brest, incorporant outre Saint-Marc, Lambézellec et Saint-Pierre Quilbignon. En 1947 il est conseiller municipal auprès de Chupin, maire de Brest. Elu maire de Brest en 1953, il le restera jusqu’en décembre 1958. Il fut également président du Conseil Général de 1945 à 1949 et sénateur de 1946 à 1959. Il fut élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur et décoré de la Croix de Guerre au titre de la résistance.
L’Eglise
C’est donc sur ce terrain que débuta en 1862 la construction de la nouvelle église de Saint-Marc ainsi que l’installation du nouveau bourg avec mairie et école. Les plans furent établis par le jeune architecte brestois Jules Boudais (1835-1915), qui devait devenir célèbre quelques années plus tard pour son projet d’aménagement du Trocadéro à Paris. Dans la foulée il réalisa également le plan régulateur du nouveau bourg de Saint-Marc. L’église fut construite par l’entreprise Kerautret selon une technique révolutionnaire pour l’époque. Cette technique permit le mariage du béton armé et moulé avec la recherche de l’harmonie des lignes, réalisant à travers ce nouveau matériau un édifice gothique d’une moderne beauté. Cette méthode de travail sera généralisée et améliorée quelques décennies plus tard par les frères Freyssinet (Aimé et Eugène) notamment. L’église fut inaugurée le 29 août 1865 par Monseigneur Sergent, évêque de Quimper. A partir de ces années la population de Saint-Marc qui était modeste ( 1379 habitants en 1850) fut en progression constante, atteignant 3600 habitants en 1900 ( 3409 au recensement de 1896). L’ancienne église paroissiale rénovée par l’abbé Paul Cocaign deviendra la chapelle de Notre-Dame du Bon Port. En 1901 le bourg fut relié à l’Arsenal, par une ligne de tramway, via le Petit Paris.
Les rues nouvelles
L’ordonnance du 27 avril 1945 (avec effet rétroactif au 3 octobre 1944) concernant le rattachement de Saint-Marc au grand Brest, fit apparaître une difficulté concernant le nom des rues ayant déjà la même appellation à Brest, Lambézellec ou Saint-Pierre Quilbignon. Il y avait par exemple une rue Jean Jaurés dans chacune de ces communes, soit 3 de trop. Une commission dépendant de la nouvelle municipalité dirigée par Jules Lullien eut la charge de contourner la difficulté. Suite aux délibérations de cette commission les noms des rues suivantes de Saint-Marc furent changées :
Anciens noms Nouveaux noms
Rue Brizeux……………………rue Kéruel
rue Chateaubriand……………..rue Ronsard
rue du Docteur Calmette………rue Claude Bernard
rue Paul Doumer……………….rue Jacques Cartier
rue des Forts …………………...rue Georges Melou
rue du Gaz……………………...rue Pierre Sémard
rue Jean Jaurès……………………rue La Bruyère
rue Laënnec……………….…..rue Abbé de l’Epée
rue Lamartine……………..…..rue de Sévigné
rue Anatole Le Braz …………rue Alfred de Musset
rue Maréchal Lyautey ………rue de Maleyssie
rue Pascal …………………rue d’Estienne d’Orves
rue du Docteur Roux ………...rue de Tunisie
rue Albert Thomas ………...rue Charles Vuillemin
Le Guelmeur
Ce lieu, sur la hauteur dominant la rade, signifie en breton, vue immense. La topographie favorable de cet endroit le fit choisir pour construire un fort qui avait pour mission de défendre l’accès au port militaire de Brest, contre toutes interventions terrestres ennemies. Le fort du Guelmeur qui fut terminé en 1864 vint renforcer le dispositif défensif de Brest, avec notamment à l’ouest de la ville les forts du Portzic, de Montbarey, de Kéranroux, du Questel-Bras et de Penfeld. Cette ligne de défense avancée devait en principe être complétée par les forts de Pen-ar-Créac’h, de Pen-ar-Chleuz, de Pen-ar-Valy et du Bergot. L’arrivée en 1917 des américains fit de Brest une zone de transit et d’hébergement. Le plus important de leur camp fut établi à Pontanézen, mais Saint-Marc fut également un lieu de casernement, au fort du Guelmeur notamment. Plus au sud, vers Dourbian un autre camp portait le nom de président Lincoln. Au sud ouest de ce fort 3 hameaux portaient le nom de Forestou, qui désignait à l’origine une zone couverte par plusieurs forêts. S’étalant sur la pente du plateau il y avait : Forestou Huella (du haut), Forestou Creis (du milieu), Forestou Izella ( du bas). Le pont reliant Brest à Saint-Marc, passant au dessus du vallon menant à Poul-ar-Bachet, s’appelle le pont du Forestou.
Les aviateurs célèbres
Dans ce quartier du Forestou à la limite du Guelmeur se concentrent quelques rues dédiées à des aviateurs célèbres, comme Joseph Le Brix (1899-1931), Georges Guynemer (1894-1917) ou Alberto Santos-Dumont (1873-1932). Le premier originaire de Baden dans le Morbihan fit carrière dans l’aéronautique en qualité d’officier de marine. Dans les années 1925/1926 il participa avec son escadrille à la guerre du Rif, au Maroc où il s’illustra brillamment. Mais Le Brix est surtout connu pour avoir accompli en 1927/1928 avec Costes le tour du monde aérien, le menant de Paris à Rio de Janeiro, San Francisco et Tokyo. En 1931, Le Brix réalisa la performance de totaliser 8 records mondiaux, dont celui de la distance et de la durée en circuit fermé (10372 km). Durant son séjour à Brest où il enseigna la science aéronautique aux élèves de l’Ecole Navale, il fut le président de l’Aéroclub du Finistère. En 1931, pris dans une tempête de neige son avion qui effectuait la liaison Paris-Tokyo, s’écrasa dans l’Oural provoquant sa mort et celle de son mécanicien. Georges Guynemer s’illustra durant la guerre 14-18 comme commandant de l’escadrille « Les Cigognes ». Il était titulaire de 53 victoires lorsqu’il fut abattu au dessus de la Belgique le 11 septembre 1917. Il n’avait pas encore 23 ans. Son héroïsme a fait de lui une figure légendaire de l’aviation française . Alberto Santos Dumont fut de 1898 à 1905 le créateur de plusieurs modèles de ballons dirigeables. Comprenant vite que l’avenir était dans le développement de l’aviation, il en devint l’un des pionniers.
Le château de Ker-Stears
Il fut construit dans le milieu du XIXème siècle à l’initiative de l’industriel écossais John Burnett-Stears sur la hauteur de Forestou-Izella. Sur son perchoir rocheux le château dominait l’usine à gaz que Burnett-Stears avait fait construire pied de la falaise en 1841. Ce château fut le théâtre en 1906 d’une histoire sulfureuse concernant le vol d’un diamant, appartenant à la comtesse Rodellec du Portzic. Cette dernière, veuve depuis 1888 du fils de John Burnett-Stears, avait épousé en seconde noce le Comte Olivier-Marie-Joseph de Rodellec du Portzic de 25 ans son cadet. Une rue de Saint-Marc, proche du château, honore la mémoire de la comtesse de Maleyssie, petite fille de la comtesse de Rodellec du Portzic. La comtesse de Maleyssie eut une conduite courageuse durant la dernière guerre, s’occupant notamment des familles de prisonniers. Elle mourut tragiquement, le 9 septembre 1944, dans l’explosion de l’abri Sadi-Carnot. Au siècle dernier, la rue Pierre Sémard s’appelait la route ou rampe du gaz. En 1865 la rue du gaz forma la nouvelle limite de séparation entre Brest et Saint-Marc. C’est à cette date que les terrains concernés par cette usine du gaz furent de ce fait annexés par la ville de Brest au détriment de Saint-Marc. Le gaz produit par cette usine servait au chauffage et à l’éclairage public des rues de la ville de Brest. Stears avait pour associé un certain monsieur Pitty. Aujourd’hui le domaine de Ker-Stears abrite un établissement d’enseignement privé secondaire, le lycée technologique : Fénelon. Fénelon écrivit en son temps un traité sur l’éducation des filles. Ceci expliquant cela. C’est en 1946 que les héritiers de comtesse de Maleyssie vendirent Kerstears à la Congrégation des sœurs de la Retraite d’Angers.
L’extension du port de commerce
Au sud de Forestou Izella, au pied de la falaise, à la limite haute de la grève, fut créé en 1897 le casino de Kermor qui attira à Saint-Marc une nombreuse clientèle brestoise. Ce casino fondé par monsieur Gabriel Hérodote, Directeur de la Compagnie des tramways électriques brestois fonctionna jusqu’en 1918. La voie ferrée marchande passant à cet endroit et la gare de marchandises toute proche, mirent un terme à son existence. Afin de répondre à de nouvelles activités, cette zone épargnée jusqu’à lors par l’extension du port de commerce fut aménagée après la guerre de 1945, et progressivement étendue vers l’est. La construction d’un terre-plein et d’un quai pour les minéraliers firent de ce secteur à partir des années 60, un important port relais charbonnier, puis cimentier. L’anse de Saint-Marc fut également comblé entre 1962 et 1964 constituant avec son extension au sud (1976/1977) une zone de 50 hectares à vocation industrielle. En prévision d’un hypothétique essor de l’activité pétrolière du port de commerce, des formes de radoub pour réparation des pétroliers géants furent mises en service en 1968 (2ème bassin) et 1980 (3ème bassin) sur un espace gagné sur la mer. Le 1er bassin de radoub du port de commerce commencé en 1903 fut achevé en 1908. Afin de l’agrandir les travaux reprirent en 1909 et c’est en 1913 que fut inaugurée la forme définitive, longue de 223 mètres, soit une dimension impressionnante pour l’époque.
La rue brigadier Le Cann
Ce nom a été donné en hommage au sous-brigadier de police Albert Le Cann qui, en service commandé, fut abattu le 17 août 1973 par des gangsters venant d’opérer un hold-up dans l’agence du Crédit Industriel de l’Ouest de la place de Strasbourg à Brest. C’est au cours de la poursuite qui s’en suivi et qui amena les malfaiteurs à se réfugier à Saint-Marc, qu’Albert Le Cann fut tué à bout portant en tentant de les intercepter. Par la suite les gangsters se cachèrent dans un pavillon de la rue de la Montagne, prenant sa propriétaire en otage. Durant 48 heures les malfaiteurs tentèrent de négocier leur fuite, laissant à la brigade anti-gang de Paris le temps pour intervenir efficacement. Au cours de l’assaut final, un des malfaiteurs se donna la mort, tandis que l’autre blessé se rendit. C’est cette rue, autrefois de la Montagne, surplombant la rade de Brest, qui porte aujourd’hui le nom d’Albert Le Cann, brigadier à titre posthume.
A ce niveau, la vue sur la presqu’île de Plougastel est magnifique. Avant 1962, date du début du comblement de l’anse de Saint-Marc, les promeneurs pouvaient admirer la plage et son plongeoir flottant ou entendre la musique de la guinguette toute proche. A la fin du XIXème siècle ,au pied de la falaise, longeant la route du vieux Saint-Marc, se situait le bassin de Tritshler. Ce nom nous rappelle que la participation, de cet architecte et entrepreneur de travaux publics, à la construction et au développement du port de commerce, créé à partir de 1860/61 (décision 1859), dans l’anse de Porstrein, avait été déterminante et efficace.
La rampe du vieux Saint-Marc, la chapelle
Cette rampe qui fait la liaison entre le vieux et le nouveau bourg de Saint-Marc est évocatrice du passé et des événements qui contraignirent les édiles municipaux du XIX siècle à transférer le centre vital de la commune sur les hauteurs dominant la vieille chapelle. Les registres attestent que ce lieu de culte est ancien et était autrefois connu sous le nom de Trénivez. Selon les interprétations ce nom désignerait la trêve de saint Ignace (Sant Nivez) ou la trêve neuve (Trénévez). A l’intérieur de la chapelle une statue de saint Ignace tendrait à prouver la première version . Le nom de Saint-Marc n’apparaît sur les registres qu’à partir de 1769. Une trêve désignait autrefois un territoire religieux qui dépendait d’une autorité supérieure pouvant être une paroisse mère, comme ce fut le cas de Lambézellec qui fut la tutrice de Saint-Marc de 1781 à 1823. Avant 1781 Trénivez dépendait de l’église des sept saints à Brest, elle même prieuré de l’abbaye de Saint-Mathieu. En 1823 le premier recteur de la paroisse désormais reconnue en qualité de cure indépendante fut l’abbé Allançon auquel succéda l’abbé Richou. A la fin de 1937 l’abbé Paul Cocaign (1806-1873) fut nommé comme nouveau recteur. Durant 35 ans il allait participer, sous le mandat de 5 maires successifs ( Jacques Colin, Guillaume Kéraudy, Bilhon du Forestou, Nicolas Labat et Jérôme Jouveau-Dubreuil ) à la vie, à la mutation et à l’essor de sa paroisse. On lui doit la rénovation de l’église du vieux bourg qui était délabrée à son arrivée. Après la construction de la nouvelle église, l’ancienne dite du vieux bourg, fut transformée en chapelle. Il défendit avec acharnement les intérêts de sa paroisse, dans le contexte difficile de l’expropriation par les chemins de fer d’une partie de sa cure (le cimetière notamment) et assura la continuité religieuse durant le transfert de son ministère vers la nouvelle église.
Le chemin de fer
Le désenclavement du port militaire de Brest, ainsi que celui du port de commerce décidé en 1959, nécessitait une rapide extension jusqu’à Brest de la ligne de chemin de fer qui ne dépassait pas Rennes. Le baron Lacrosse, sénateur du Finistère fut auprès de Napoléon III l’intermédiaire avisé pour la réussite de plusieurs projets dont la construction du pont tournant, du port de commerce dans l’anse de Porstrein et l’extension de la voie ferrée de Rennes à Brest. Le premier train entra en gare de Brest le 25 avril 1865.
Dans la seconde moitié du XIXème siècle le chemin de fer fut pour la commune la source de nombreux soucis, mais aussi l’annonce d’une nouvel espoir en l’avenir. En dédommagement de l’expropriation de son cimetière, la Direction des Chemins de fer offre 17000 F à la commune, soit environ 22% du prix de la nouvelle église. Les Chemins de fer acceptent également un arrêt de train à la gare du Rody.
Le manoir de Kerjean
Au XVIIIème siècle le domaine de Kerjean fut attaché à la famille Dupleix, elle même alliée aux Choquet du Lindu. Ici résida la sœur du prestigieux Dupleix, mariée à Jacques Desnos, Commissaire de la Marine à Brest. Leur fils, Monsieur Desnos de Kerjean, maréchal de camp et gouverneur de Pondichéry, fut l’un des plus actifs lieutenant de son oncle Dupleix dans la conquête de l’Inde. Le domaine fut acquis en 1803 par la famille Vinet
Une école des filles fut créée sur le domaine de Kerjean dans le milieu du XIX ème siècle à l’initiative des sœurs de l’ordre de Saint-Joseph de Cluny, fondé par Anne-Marie Javouhey. Mais cet établissement, comportant également un noviciat, ne prospéra pas. Après le départ des sœurs, le domaine fut acquis par Jouveau-Dubreuil qui y installa une chocolaterie dite du Grand Kerjean qui fera faillite en 1884
Le général De Gaulle y séjourna